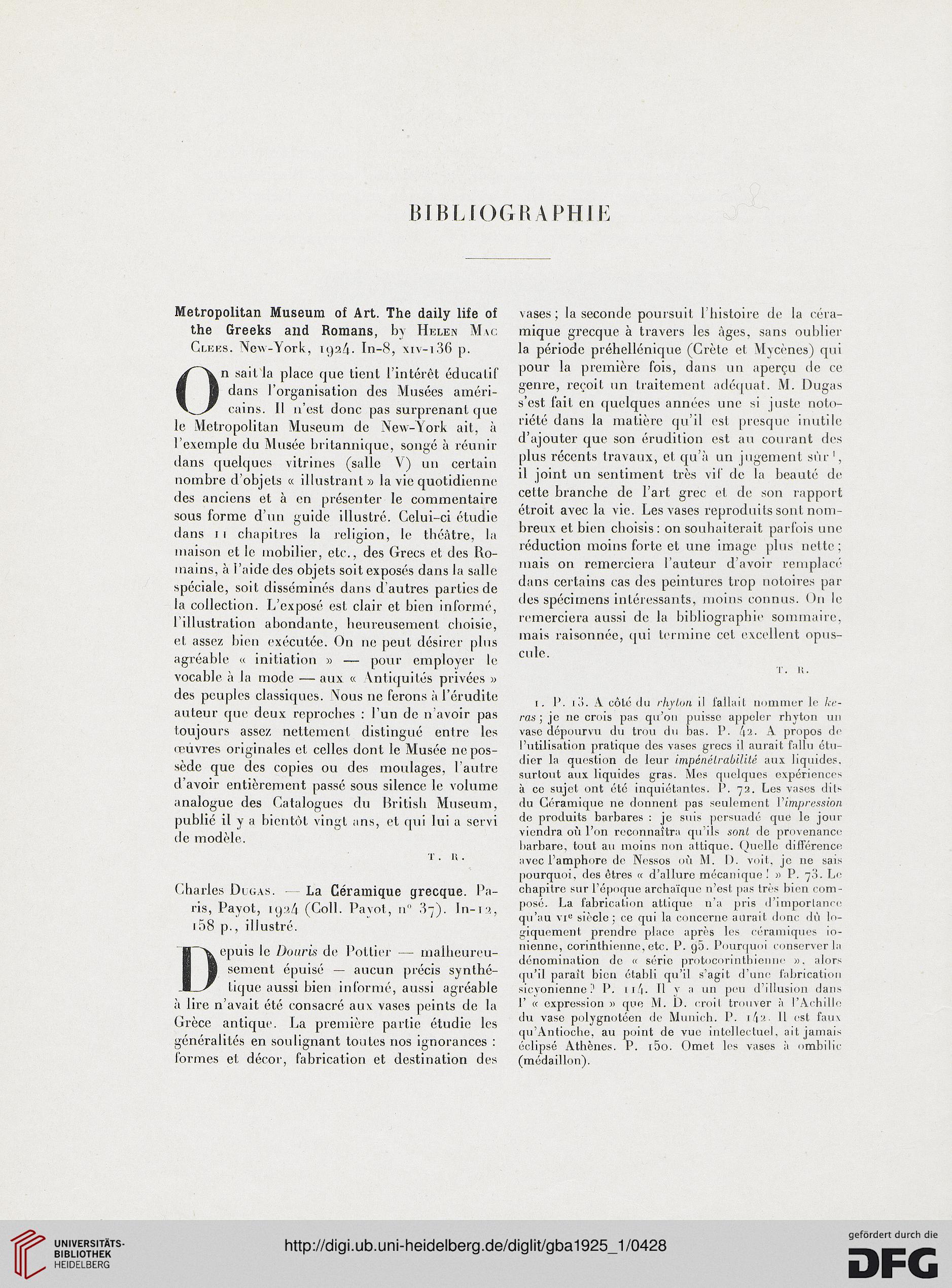BIBLIOGRAPHIE
Metropolitan Muséum of Art. The daily life of
the Greeks and Romans, by Hblen Mac
Cubes. New-York, upé- In-8, xiv-i36 p.
On sait, la place que tient l’intérêt éducatif
dans l’organisation des Musées améri-
cains. Il u’est donc pas surprenant que
le Metropolitan Muséum de New-York ait, à
l’exemple du Musée britannique, songé à réunir
dans quelques vitrines (salle V) un certain
nombre d’objets « illustrant » la vie quotidienne
des anciens et à en présenter le commentaire
sous forme d’un guide illustré. Celui-ci étudie
dans i i chapitres la religion, le théâtre, la
maison et le mobilier, etc., des Grecs et des Ro-
mains, à l’aide des objets soit exposés dans la salle
spéciale, soit disséminés dans d autres parties de
la collection. L’exposé est clair et bien informé,
l’illustration abondante, heureusement choisie,
et assez bien exécutée. On ne peut désirer plus
agréable « initiation » — pour employer le
vocable à la mode — aux « Antiquités privées »
des peuples classiques. Nous ne ferons à l’érudite
auteur que deux reproches : l’un de n’avoir pas
toujours assez nettement distingué enlre les
œuvres originales et celles dont le Musée ne pos-
sède que des copies ou des moulages, l’autre
d’avoir entièrement passé sous silence le volume
analogue des Catalogues du British Muséum,
publié il y a bientôt vingt ans, et qui lui a servi
de modèle.
r. a.
Charles Dugas. La Céramique grecque. Pa-
ris, Payot, iga4 (Coll. Pavot, n" 37). ln-12,
1 r>8 p., illustré.
Depuis le Doaris de Pottier — malheureu-
sement épuisé — aucun précis synthé-
tique aussi bien informé, aussi agréable
à lire n’avait été consacré aux vases peints de la
Grèce antique. La première partie étudie les
généralités en soulignant toutes nos ignorances :
formes et décor, fabrication et destination des
vases ; la seconde poursuit l’histoire de la céra-
mique grecque à travers les âges, sans oublier
la période préhellénique (Crète et Mycènes) qui
pour la première fois, dans un aperçu de ce
genre, reçoit un traitement adéquat. M. Dugas
s’est fait en quelques années une si juste noto-
riété dans la matière qu’il est presque inutile
d’ajouter que son érudition est au courant des
plus récents travaux, et, qu’à un jugement sur ',
il joint un sentiment très vil de la beauté de
cette branche de l’art grec et de son rapport
étroit avec la vie. Les vases reproduits sont nom-
breux et bien choisis : on souhaiterait parfois une
réduction moins forte et une image plus nette ;
mais on remerciera l’auteur d’avoir remplacé
dans certains cas des peintures trop notoires par
des spécimens intéressants, moins connus. On le
remerciera aussi de la bibliographie sommaire,
mais raisonnée, qui termine cet excellent opus-
cule.
t. 11.
1. P. 10. A côté du rhyton il fallait nommer le fe-
ras; je ne crois pas qu’on puisse appeler rhyton un
vase dépourvu du trou du bas. P. h'i. A propos de
l’utilisation pratique des vases grecs il aurait fallu étu-
dier la question de leur impénétrabilité aux liquides,
surtout aux liquides gras. Mes quelques expériences
à ce sujet ont été inquiétantes. P. 72. Les vases dits
du Céramique ne donnent pas seulement l'impression
de produits barbares : je suis persuadé que le jour
viendra où l’on reconnaîtra qu’ils sont de provenance
barbare, tout au moins non attique. Quelle différence
avec l’amphore de Nessos où M. I). voit, je ne sais
pourquoi, des êtres « d’allure mécanique ! » P. 73. Le
chapitre sur l’époque archaïque n’est pas très bien com-
posé. La fabrication attique n’a pris d’importance
qu’au vie siècle; ce qui la concerne aurait donc dù lo-
giquement prendre place après les céramiques io-
nienne, corinthienne, etc. P. g5. Pourquoi conserver la
dénomination de « série protocorinthienne », alors
qu’il parait bien établi qu’il s’agit d’une fabrication
sicyonienne ? P. n4. Il y a un peu d’illusion dans
1’ « expression» que M. D. croit trouver à l’Achille
du vase polygnotéen de Munich. P. 14 2 • 11 est faux
qu’Antioche, au point de vue intellectuel, ait jamais
éclipsé Athènes. P. i5o. Omet les vases à ombilic
(médaillon).
Metropolitan Muséum of Art. The daily life of
the Greeks and Romans, by Hblen Mac
Cubes. New-York, upé- In-8, xiv-i36 p.
On sait, la place que tient l’intérêt éducatif
dans l’organisation des Musées améri-
cains. Il u’est donc pas surprenant que
le Metropolitan Muséum de New-York ait, à
l’exemple du Musée britannique, songé à réunir
dans quelques vitrines (salle V) un certain
nombre d’objets « illustrant » la vie quotidienne
des anciens et à en présenter le commentaire
sous forme d’un guide illustré. Celui-ci étudie
dans i i chapitres la religion, le théâtre, la
maison et le mobilier, etc., des Grecs et des Ro-
mains, à l’aide des objets soit exposés dans la salle
spéciale, soit disséminés dans d autres parties de
la collection. L’exposé est clair et bien informé,
l’illustration abondante, heureusement choisie,
et assez bien exécutée. On ne peut désirer plus
agréable « initiation » — pour employer le
vocable à la mode — aux « Antiquités privées »
des peuples classiques. Nous ne ferons à l’érudite
auteur que deux reproches : l’un de n’avoir pas
toujours assez nettement distingué enlre les
œuvres originales et celles dont le Musée ne pos-
sède que des copies ou des moulages, l’autre
d’avoir entièrement passé sous silence le volume
analogue des Catalogues du British Muséum,
publié il y a bientôt vingt ans, et qui lui a servi
de modèle.
r. a.
Charles Dugas. La Céramique grecque. Pa-
ris, Payot, iga4 (Coll. Pavot, n" 37). ln-12,
1 r>8 p., illustré.
Depuis le Doaris de Pottier — malheureu-
sement épuisé — aucun précis synthé-
tique aussi bien informé, aussi agréable
à lire n’avait été consacré aux vases peints de la
Grèce antique. La première partie étudie les
généralités en soulignant toutes nos ignorances :
formes et décor, fabrication et destination des
vases ; la seconde poursuit l’histoire de la céra-
mique grecque à travers les âges, sans oublier
la période préhellénique (Crète et Mycènes) qui
pour la première fois, dans un aperçu de ce
genre, reçoit un traitement adéquat. M. Dugas
s’est fait en quelques années une si juste noto-
riété dans la matière qu’il est presque inutile
d’ajouter que son érudition est au courant des
plus récents travaux, et, qu’à un jugement sur ',
il joint un sentiment très vil de la beauté de
cette branche de l’art grec et de son rapport
étroit avec la vie. Les vases reproduits sont nom-
breux et bien choisis : on souhaiterait parfois une
réduction moins forte et une image plus nette ;
mais on remerciera l’auteur d’avoir remplacé
dans certains cas des peintures trop notoires par
des spécimens intéressants, moins connus. On le
remerciera aussi de la bibliographie sommaire,
mais raisonnée, qui termine cet excellent opus-
cule.
t. 11.
1. P. 10. A côté du rhyton il fallait nommer le fe-
ras; je ne crois pas qu’on puisse appeler rhyton un
vase dépourvu du trou du bas. P. h'i. A propos de
l’utilisation pratique des vases grecs il aurait fallu étu-
dier la question de leur impénétrabilité aux liquides,
surtout aux liquides gras. Mes quelques expériences
à ce sujet ont été inquiétantes. P. 72. Les vases dits
du Céramique ne donnent pas seulement l'impression
de produits barbares : je suis persuadé que le jour
viendra où l’on reconnaîtra qu’ils sont de provenance
barbare, tout au moins non attique. Quelle différence
avec l’amphore de Nessos où M. I). voit, je ne sais
pourquoi, des êtres « d’allure mécanique ! » P. 73. Le
chapitre sur l’époque archaïque n’est pas très bien com-
posé. La fabrication attique n’a pris d’importance
qu’au vie siècle; ce qui la concerne aurait donc dù lo-
giquement prendre place après les céramiques io-
nienne, corinthienne, etc. P. g5. Pourquoi conserver la
dénomination de « série protocorinthienne », alors
qu’il parait bien établi qu’il s’agit d’une fabrication
sicyonienne ? P. n4. Il y a un peu d’illusion dans
1’ « expression» que M. D. croit trouver à l’Achille
du vase polygnotéen de Munich. P. 14 2 • 11 est faux
qu’Antioche, au point de vue intellectuel, ait jamais
éclipsé Athènes. P. i5o. Omet les vases à ombilic
(médaillon).