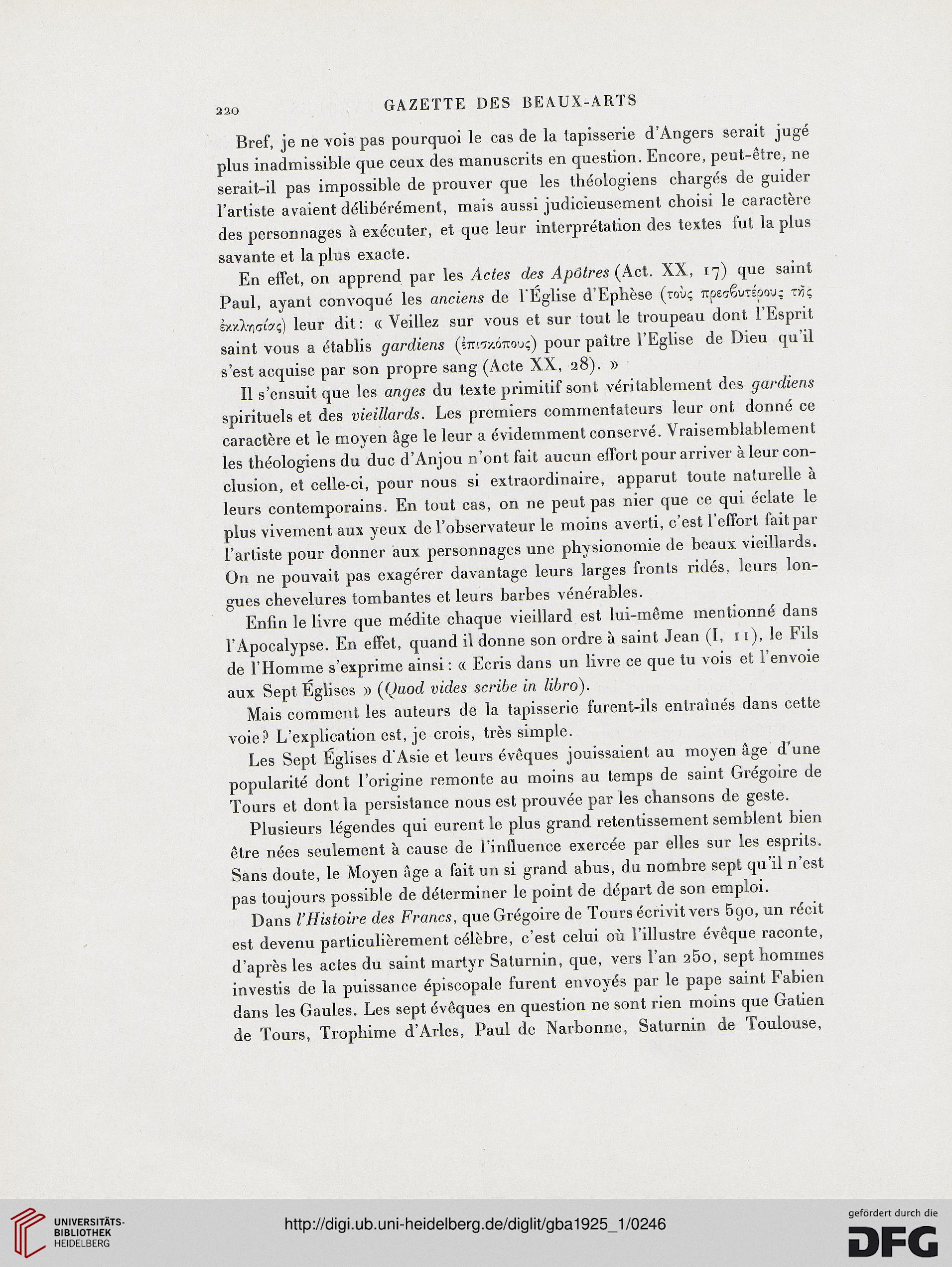220
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Bref, je ne vois pas pourquoi le cas de la tapisserie d’Angers serait jugé
plus inadmissible que ceux des manuscrits en question. Encore, peut-être, ne
serait-il pas impossible de prouver que les théologiens chargés de guider
l’artiste avaient délibérément, mais aussi judicieusement choisi le caractère
des personnages à exécuter, et que leur interprétation des textes fut la plus
savante et la plus exacte.
En effet, on apprend par les Actes des Apôtres (Act. XX, 17) que saint
Paul, ayant convoqué les anciens de l Eglise d’Ephèse (roùç irpesêvrépov; rëç
l/x.ÀYjctV;) leur dit: « Veillez sur vous et sur tout le troupeau dont l’Esprit
saint vous a établis gardiens (imay.omoi) pour paître l’Eglise de Dieu qu’il
s’est acquise par son propre sang (Acte XX, 28). »
Il s’ensuit que les anges du texte primitif sont véritablement des gardiens
spirituels et des vieillards. Les premiers commentateurs leur ont donné ce
caractère et le moyen âge le leur a évidemment conservé. Vraisemblablement
les théologiens du duc d’Anjou n’ont fait aucun effort pour arriver à leur con-
clusion, et celle-ci, pour nous si extraordinaire, apparut toute naturelle à
leurs contemporains. En tout cas, on ne peut pas nier que ce qui éclate le
plus vivement aux yeux de l’observateur le moins averti, c’est l’effort fait par
l’artiste pour donner aux personnages une physionomie de beaux vieillards.
On ne pouvait pas exagérer davantage leurs larges fronts ridés, leurs lon-
gues chevelures tombantes et leurs barbes vénérables.
Enfin le livre que médite chaque vieillard est lui-même mentionné dans
l’Apocalypse. En effet, quand il donne son ordre à saint Jean (I, 11), le Fils
de l’Homme s’exprime ainsi : « Ecris dans un livre ce que tu vois et l’envoie
aux Sept Eglises » (Quod vides scribe in libro).
Mais comment les auteurs de la tapisserie furent-ils entraînés dans cette
voie? L’explication est, je crois, très simple.
Les Sept Églises d'Asie et leurs évêques jouissaient au moyen âge d’une
popularité dont l’origine remonte au moins au temps de saint Grégoire de
Tours et dont la persistance nous est prouvée par les chansons de geste.
Plusieurs légendes qui eurent le plus grand retentissement semblent bien
être nées seulement à cause de l’influence exercée par elles sur les esprits.
Sans doute, le Moyen âge a fait un si grand abus, du nombre sept qu’il n’est
pas toujours possible de déterminer le point de départ de son emploi.
Dans l’Histoire des Francs, que Grégoire de Tours écrivit vers 590, un récit
est devenu particulièrement célèbre, c’est celui où l’illustre évêque raconte,
d’après les actes du saint martyr Saturnin, que, vers l’an 25o, sept hommes
investis de la puissance épiscopale furent envoyés par le pape saint Fabien
dans les Gaules. Les sept évêques en question ne sont rien moins que Gatien
de Tours, Trophime d’Arles, Paul de Narbonne, Saturnin de Toulouse,
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Bref, je ne vois pas pourquoi le cas de la tapisserie d’Angers serait jugé
plus inadmissible que ceux des manuscrits en question. Encore, peut-être, ne
serait-il pas impossible de prouver que les théologiens chargés de guider
l’artiste avaient délibérément, mais aussi judicieusement choisi le caractère
des personnages à exécuter, et que leur interprétation des textes fut la plus
savante et la plus exacte.
En effet, on apprend par les Actes des Apôtres (Act. XX, 17) que saint
Paul, ayant convoqué les anciens de l Eglise d’Ephèse (roùç irpesêvrépov; rëç
l/x.ÀYjctV;) leur dit: « Veillez sur vous et sur tout le troupeau dont l’Esprit
saint vous a établis gardiens (imay.omoi) pour paître l’Eglise de Dieu qu’il
s’est acquise par son propre sang (Acte XX, 28). »
Il s’ensuit que les anges du texte primitif sont véritablement des gardiens
spirituels et des vieillards. Les premiers commentateurs leur ont donné ce
caractère et le moyen âge le leur a évidemment conservé. Vraisemblablement
les théologiens du duc d’Anjou n’ont fait aucun effort pour arriver à leur con-
clusion, et celle-ci, pour nous si extraordinaire, apparut toute naturelle à
leurs contemporains. En tout cas, on ne peut pas nier que ce qui éclate le
plus vivement aux yeux de l’observateur le moins averti, c’est l’effort fait par
l’artiste pour donner aux personnages une physionomie de beaux vieillards.
On ne pouvait pas exagérer davantage leurs larges fronts ridés, leurs lon-
gues chevelures tombantes et leurs barbes vénérables.
Enfin le livre que médite chaque vieillard est lui-même mentionné dans
l’Apocalypse. En effet, quand il donne son ordre à saint Jean (I, 11), le Fils
de l’Homme s’exprime ainsi : « Ecris dans un livre ce que tu vois et l’envoie
aux Sept Eglises » (Quod vides scribe in libro).
Mais comment les auteurs de la tapisserie furent-ils entraînés dans cette
voie? L’explication est, je crois, très simple.
Les Sept Églises d'Asie et leurs évêques jouissaient au moyen âge d’une
popularité dont l’origine remonte au moins au temps de saint Grégoire de
Tours et dont la persistance nous est prouvée par les chansons de geste.
Plusieurs légendes qui eurent le plus grand retentissement semblent bien
être nées seulement à cause de l’influence exercée par elles sur les esprits.
Sans doute, le Moyen âge a fait un si grand abus, du nombre sept qu’il n’est
pas toujours possible de déterminer le point de départ de son emploi.
Dans l’Histoire des Francs, que Grégoire de Tours écrivit vers 590, un récit
est devenu particulièrement célèbre, c’est celui où l’illustre évêque raconte,
d’après les actes du saint martyr Saturnin, que, vers l’an 25o, sept hommes
investis de la puissance épiscopale furent envoyés par le pape saint Fabien
dans les Gaules. Les sept évêques en question ne sont rien moins que Gatien
de Tours, Trophime d’Arles, Paul de Narbonne, Saturnin de Toulouse,