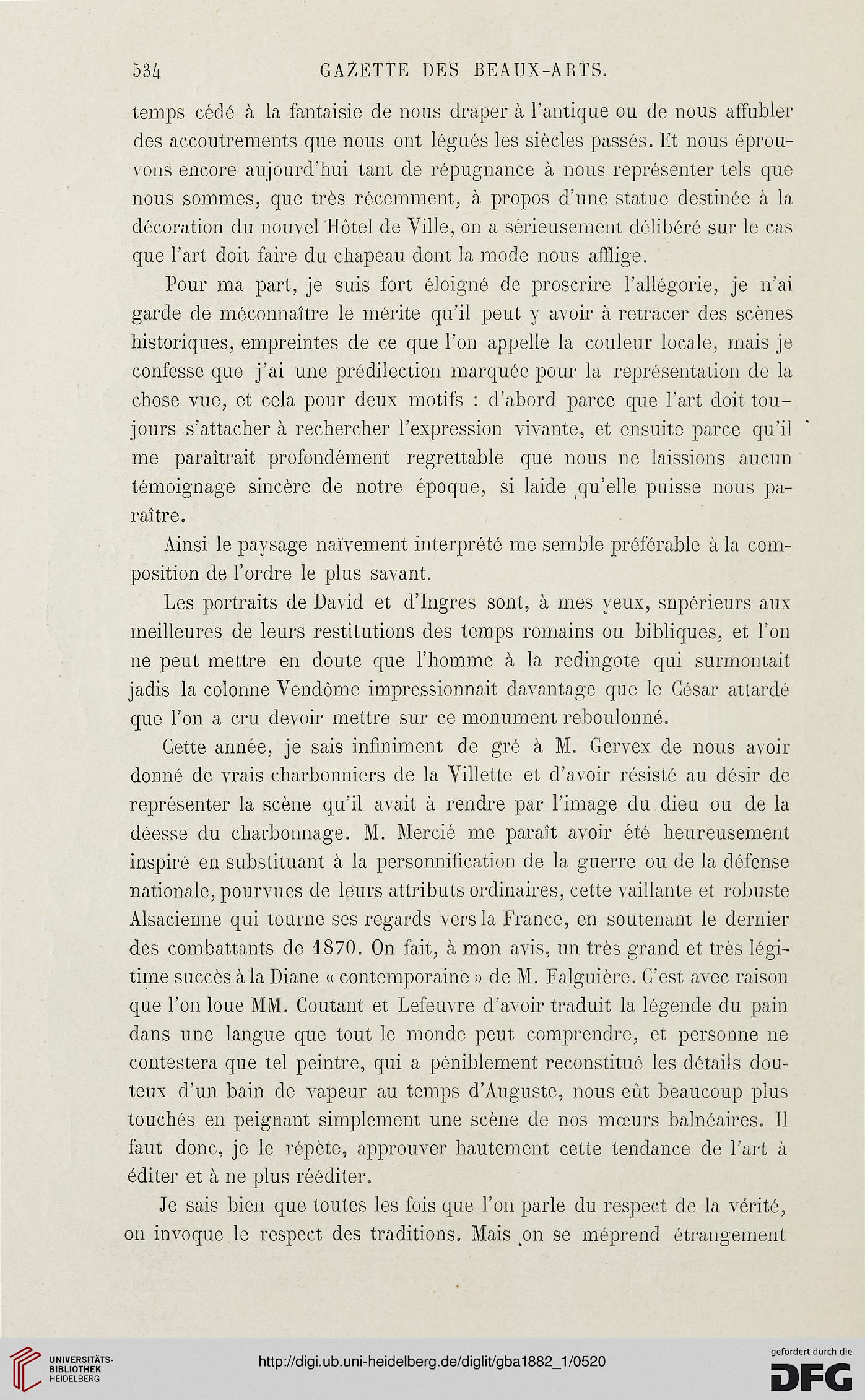534
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
temps cédé à la fantaisie de nous draper à l’antique ou de nous affubler
des accoutrements que nous ont légués les siècles passés. Et nous éprou-
vons encore aujourd’hui tant de répugnance à nous représenter tels que
nous sommes, que très récemment, à propos d’une statue destinée à la
décoration du nouvel Hôtel de Ville, on a sérieusement délibéré sur le cas
que l’art doit faire du chapeau dont la mode nous afflige.
Pour ma part, je suis fort éloigné de proscrire l’allégorie, je n’ai
garde de méconnaître le mérite qu'il peut y avoir à retracer des scènes
historiques, empreintes de ce que l’on appelle la couleur locale, mais je
confesse que j’ai une prédilection marquée pour la représentation de la
chose vue, et cela pour deux motifs : d’abord parce que l’art doit tou-
jours s’attacher à rechercher l’expression vivante, et ensuite parce qu’il
me paraîtrait profondément regrettable que nous ne laissions aucun
témoignage sincère de notre époque, si laide qu’elle puisse nous pa-
raître.
Ainsi le paysage naïvement interprété me semble préférable à la com-
position de l’ordre le plus savant.
Les portraits de David et d’Ingres sont, à mes yeux, supérieurs aux
meilleures de leurs restitutions des temps romains ou bibliques, et l’on
ne peut mettre en doute que l’homme à la redingote qui surmontait
jadis la colonne Vendôme impressionnait davantage que le César attardé
que l’on a cru devoir mettre sur ce monument reboulonné.
Cette année, je sais infiniment de gré à M. Gervex de nous avoir
donné de vrais charbonniers de la Villette et d’avoir résisté au désir de
représenter la scène qu’il avait à rendre par l’image du dieu ou de la
déesse du charbonnage. M. Mercié me paraît avoir été heureusement
inspiré en substituant à la personnification de la guerre ou de la défense
nationale, pourvues de leurs attributs ordinaires, cette vaillante et robuste
Alsacienne qui tourne ses regards vers la France, en soutenant le dernier
des combattants de 1870. On fait, à mon avis, un très grand et très légi-
time succès à la Diane « contemporaine » de M. Falguière. C’est avec raison
que l’on loue MM. Coûtant et Lefeuvre d’avoir traduit la légende du pain
dans une langue que tout le monde peut comprendre, et personne ne
contestera que tel peintre, qui a péniblement reconstitué les détails dou-
teux d’un bain de vapeur au temps d’Auguste, nous eût beaucoup plus
touchés en peignant simplement une scène de nos mœurs balnéaires. 11
faut donc, je le répète, approuver hautement cette tendance de l’art à
éditer et à ne plus rééditer.
Je sais bien que toutes les fois que l’on parle du respect de la vérité,
on invoque le respect des traditions. Mais kon se méprend étrangement
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
temps cédé à la fantaisie de nous draper à l’antique ou de nous affubler
des accoutrements que nous ont légués les siècles passés. Et nous éprou-
vons encore aujourd’hui tant de répugnance à nous représenter tels que
nous sommes, que très récemment, à propos d’une statue destinée à la
décoration du nouvel Hôtel de Ville, on a sérieusement délibéré sur le cas
que l’art doit faire du chapeau dont la mode nous afflige.
Pour ma part, je suis fort éloigné de proscrire l’allégorie, je n’ai
garde de méconnaître le mérite qu'il peut y avoir à retracer des scènes
historiques, empreintes de ce que l’on appelle la couleur locale, mais je
confesse que j’ai une prédilection marquée pour la représentation de la
chose vue, et cela pour deux motifs : d’abord parce que l’art doit tou-
jours s’attacher à rechercher l’expression vivante, et ensuite parce qu’il
me paraîtrait profondément regrettable que nous ne laissions aucun
témoignage sincère de notre époque, si laide qu’elle puisse nous pa-
raître.
Ainsi le paysage naïvement interprété me semble préférable à la com-
position de l’ordre le plus savant.
Les portraits de David et d’Ingres sont, à mes yeux, supérieurs aux
meilleures de leurs restitutions des temps romains ou bibliques, et l’on
ne peut mettre en doute que l’homme à la redingote qui surmontait
jadis la colonne Vendôme impressionnait davantage que le César attardé
que l’on a cru devoir mettre sur ce monument reboulonné.
Cette année, je sais infiniment de gré à M. Gervex de nous avoir
donné de vrais charbonniers de la Villette et d’avoir résisté au désir de
représenter la scène qu’il avait à rendre par l’image du dieu ou de la
déesse du charbonnage. M. Mercié me paraît avoir été heureusement
inspiré en substituant à la personnification de la guerre ou de la défense
nationale, pourvues de leurs attributs ordinaires, cette vaillante et robuste
Alsacienne qui tourne ses regards vers la France, en soutenant le dernier
des combattants de 1870. On fait, à mon avis, un très grand et très légi-
time succès à la Diane « contemporaine » de M. Falguière. C’est avec raison
que l’on loue MM. Coûtant et Lefeuvre d’avoir traduit la légende du pain
dans une langue que tout le monde peut comprendre, et personne ne
contestera que tel peintre, qui a péniblement reconstitué les détails dou-
teux d’un bain de vapeur au temps d’Auguste, nous eût beaucoup plus
touchés en peignant simplement une scène de nos mœurs balnéaires. 11
faut donc, je le répète, approuver hautement cette tendance de l’art à
éditer et à ne plus rééditer.
Je sais bien que toutes les fois que l’on parle du respect de la vérité,
on invoque le respect des traditions. Mais kon se méprend étrangement