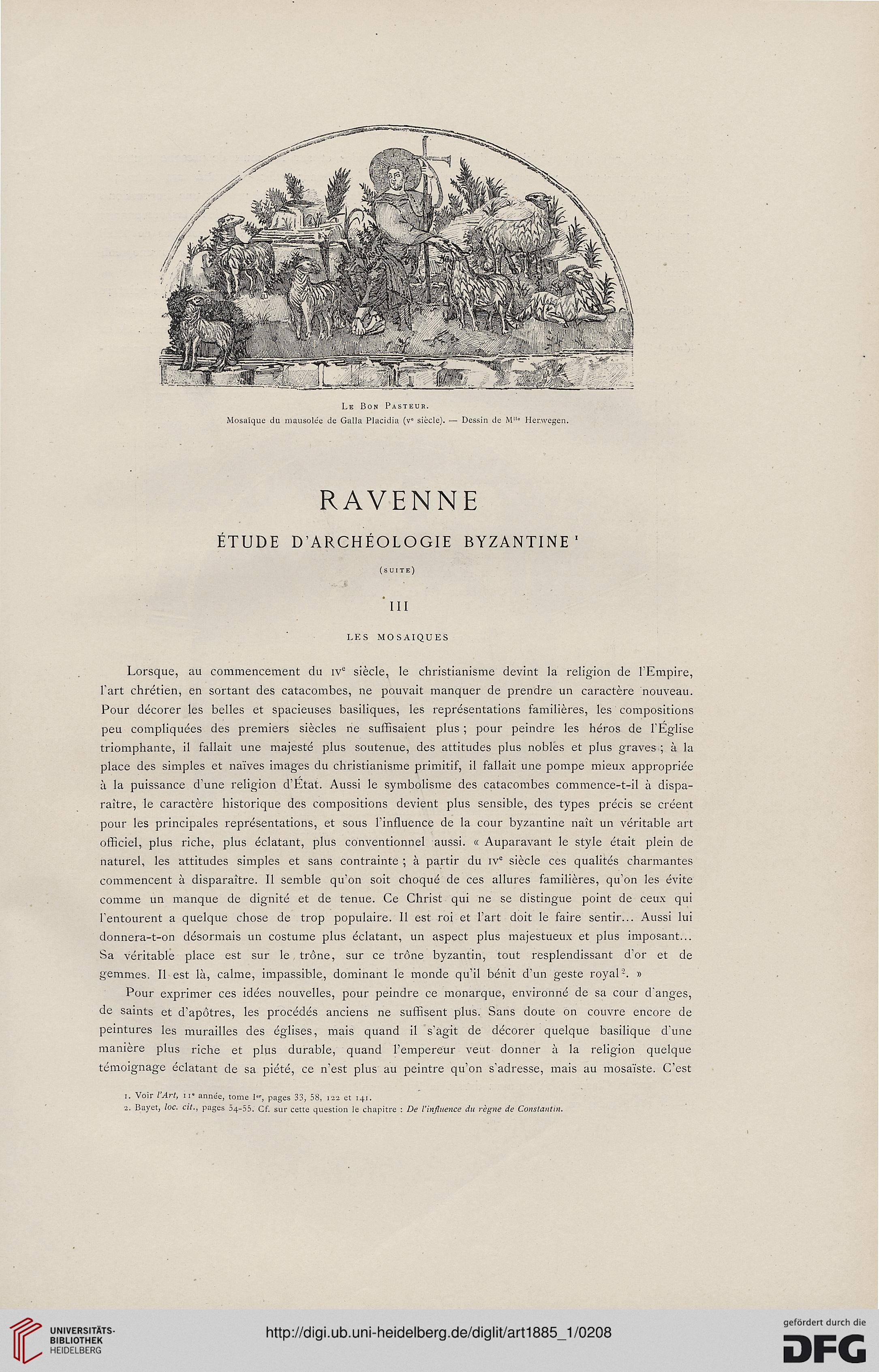Le Bon Pasteur.
Mosaïque du mausolée île Galla Placidia (v° siècle). —
Dessin de M"" Henvvegen.
RAVENNE
ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE BYZANTINE"
(suite)
*III
LES MOSAÏQUES
Lorsque, au commencement du iv e siècle, le christianisme devint la religion de l'Empire,
l'art chrétien, en sortant des catacombes, ne pouvait manquer de prendre un caractère nouveau.
Pour décorer les belles et spacieuses basiliques, les représentations familières, les compositions
peu compliquées des premiers siècles ne suffisaient plus ; pour peindre les héros de l'Eglise
triomphante, il fallait une majesté plus soutenue, des attitudes plus nobles et plus graves ; à la
place des simples et naïves images du christianisme primitif, il fallait une pompe mieux appropriée
à la puissance d'une religion d'Etat. Aussi le symbolisme des catacombes commence-t-il à dispa-
raître, le caractère historique des compositions devient plus sensible, des types précis se créent
pour les principales représentations, et sous l'influence de la cour byzantine naît un véritable art
officiel, plus riche, plus éclatant, plus conventionnel aussi. « Auparavant le style était plein de
naturel, les attitudes simples et sans contrainte ; à partir du iv e siècle ces qualités charmantes
commencent à disparaître. Il semble qu'on soit choqué de ces allures familières, qu'on les évite
comme un manque de dignité et de tenue. Ce Christ qui ne se distingue point de ceux qui
l'entourent a quelque chose de trop populaire. 11 est roi et l'art doit le faire sentir... Aussi lui
donnera-t-on désormais un costume plus éclatant, un aspect plus majestueux et plus imposant...
Sa véritable place est sur le trône, sur ce trône byzantin, tout resplendissant d'or et de
gemmes. Il est là, calme, impassible, dominant le monde qu'il bénit d'un geste royal-. »
Pour exprimer ces idées nouvelles, pour peindre ce monarque, environné de sa cour d'anges,
de saints et d'apôtres, les procédés anciens ne suffisent plus. Sans doute on couvre encore de
peintures les murailles des églises, mais quand il s'agit de décorer quelque basilique d'une
manière plus riche et plus durable, quand l'empereur veut donner à la religion quelque
témoignage éclatant de sa piété, ce n'est plus au peintre qu'on s'adresse, mais au mosaïste. C'est
1. Voir l'Art, ii" année, tome I", pages 33, 58, 122 et 141.
2. Bayet, loc. cit., pages 54-55. Cf. sur cette question le chapitre : De l'influence du règne de Constantin.
Mosaïque du mausolée île Galla Placidia (v° siècle). —
Dessin de M"" Henvvegen.
RAVENNE
ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE BYZANTINE"
(suite)
*III
LES MOSAÏQUES
Lorsque, au commencement du iv e siècle, le christianisme devint la religion de l'Empire,
l'art chrétien, en sortant des catacombes, ne pouvait manquer de prendre un caractère nouveau.
Pour décorer les belles et spacieuses basiliques, les représentations familières, les compositions
peu compliquées des premiers siècles ne suffisaient plus ; pour peindre les héros de l'Eglise
triomphante, il fallait une majesté plus soutenue, des attitudes plus nobles et plus graves ; à la
place des simples et naïves images du christianisme primitif, il fallait une pompe mieux appropriée
à la puissance d'une religion d'Etat. Aussi le symbolisme des catacombes commence-t-il à dispa-
raître, le caractère historique des compositions devient plus sensible, des types précis se créent
pour les principales représentations, et sous l'influence de la cour byzantine naît un véritable art
officiel, plus riche, plus éclatant, plus conventionnel aussi. « Auparavant le style était plein de
naturel, les attitudes simples et sans contrainte ; à partir du iv e siècle ces qualités charmantes
commencent à disparaître. Il semble qu'on soit choqué de ces allures familières, qu'on les évite
comme un manque de dignité et de tenue. Ce Christ qui ne se distingue point de ceux qui
l'entourent a quelque chose de trop populaire. 11 est roi et l'art doit le faire sentir... Aussi lui
donnera-t-on désormais un costume plus éclatant, un aspect plus majestueux et plus imposant...
Sa véritable place est sur le trône, sur ce trône byzantin, tout resplendissant d'or et de
gemmes. Il est là, calme, impassible, dominant le monde qu'il bénit d'un geste royal-. »
Pour exprimer ces idées nouvelles, pour peindre ce monarque, environné de sa cour d'anges,
de saints et d'apôtres, les procédés anciens ne suffisent plus. Sans doute on couvre encore de
peintures les murailles des églises, mais quand il s'agit de décorer quelque basilique d'une
manière plus riche et plus durable, quand l'empereur veut donner à la religion quelque
témoignage éclatant de sa piété, ce n'est plus au peintre qu'on s'adresse, mais au mosaïste. C'est
1. Voir l'Art, ii" année, tome I", pages 33, 58, 122 et 141.
2. Bayet, loc. cit., pages 54-55. Cf. sur cette question le chapitre : De l'influence du règne de Constantin.