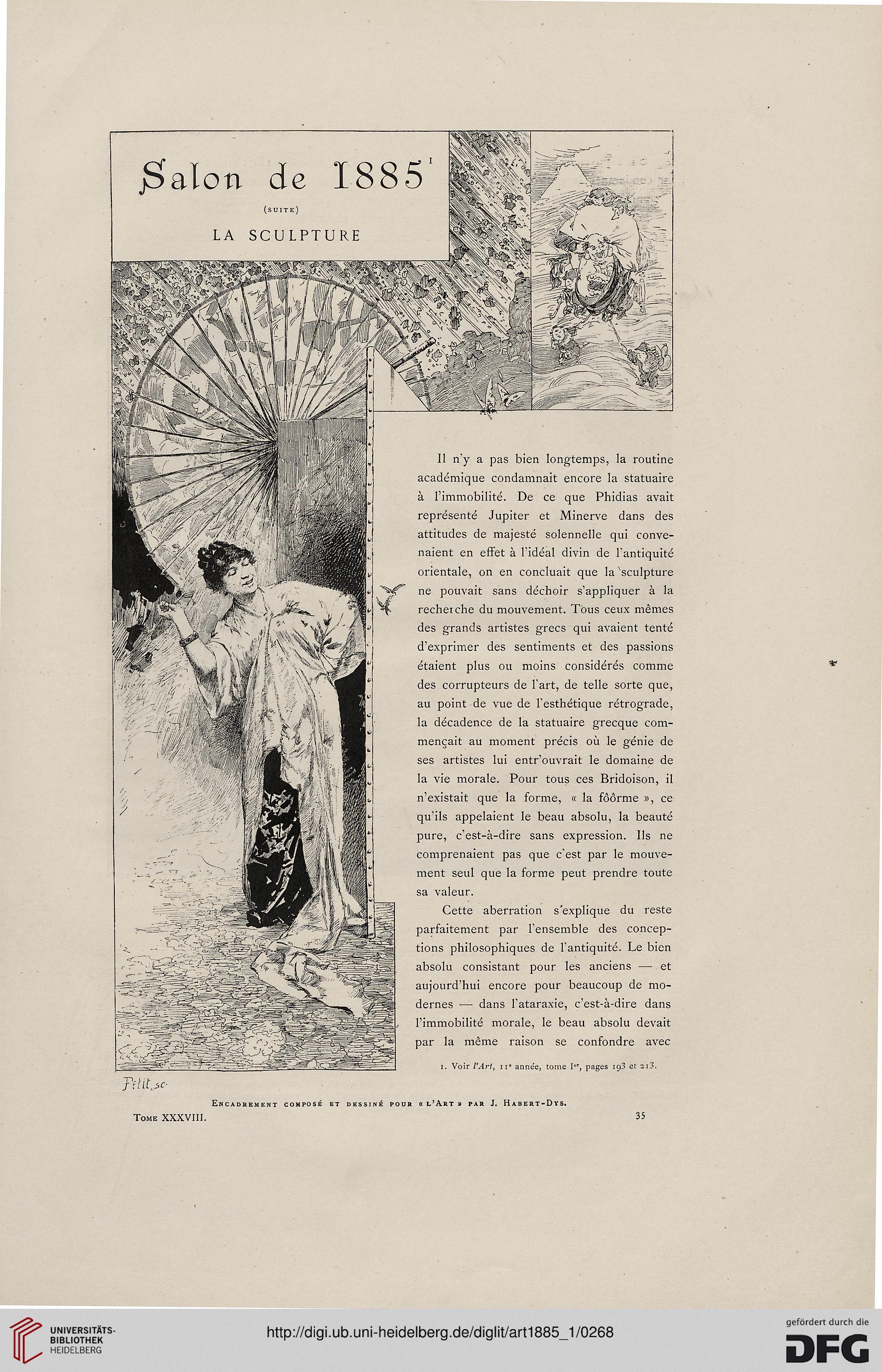alon de 1885
11 n'y a pas bien longtemps, la routine
académique condamnait encore la statuaire
à l'immobilité. De ce que Phidias avait
représenté Jupiter et Minerve dans des
attitudes de majesté solennelle qui conve-
naient en effet à l'idéal divin de l'antiquité
orientale, on en concluait que la sculpture
ne pouvait sans déchoir s'appliquer à la
rechet che du mouvement. Tous ceux mêmes
des grands artistes grecs qui avaient tenté
d'exprimer des sentiments et des passions
étaient plus ou moins considérés comme
des corrupteurs de l'art, de telle sorte que,
au point de vue de l'esthétique rétrograde,
la décadence de la statuaire grecque com-
mençait au moment précis où le génie de
ses artistes lui entr'ouvrait le domaine de
la vie morale. Pour tous ces Bridoison, il
n'existait que la forme, « la fôôrme », ce
qu'ils appelaient le beau absolu, la beauté
pure, c'est-à-dire sans expression. Us ne
comprenaient pas que c'est par le mouve-
ment seul que la forme peut prendre toute
sa valeur.
Cette aberration s'explique du reste
parfaitement par l'ensemble des concep-
tions philosophiques de l'antiquité. Le bien
absolu consistant pour les anciens — et
aujourd'hui encore pour beaucoup de mo-
dernes •— dans l'ataraxie, c'est-à-dire dans
l'immobilité morale, le beau absolu devait
par la même raison se confondre avec
i. Voir l'Art, i r année, tome I", pages io,3 et 2i3.
Encadrement composé et dessiné pour «l'Art» par j. Habert-Dys.
Tome XXXVIII. 35
11 n'y a pas bien longtemps, la routine
académique condamnait encore la statuaire
à l'immobilité. De ce que Phidias avait
représenté Jupiter et Minerve dans des
attitudes de majesté solennelle qui conve-
naient en effet à l'idéal divin de l'antiquité
orientale, on en concluait que la sculpture
ne pouvait sans déchoir s'appliquer à la
rechet che du mouvement. Tous ceux mêmes
des grands artistes grecs qui avaient tenté
d'exprimer des sentiments et des passions
étaient plus ou moins considérés comme
des corrupteurs de l'art, de telle sorte que,
au point de vue de l'esthétique rétrograde,
la décadence de la statuaire grecque com-
mençait au moment précis où le génie de
ses artistes lui entr'ouvrait le domaine de
la vie morale. Pour tous ces Bridoison, il
n'existait que la forme, « la fôôrme », ce
qu'ils appelaient le beau absolu, la beauté
pure, c'est-à-dire sans expression. Us ne
comprenaient pas que c'est par le mouve-
ment seul que la forme peut prendre toute
sa valeur.
Cette aberration s'explique du reste
parfaitement par l'ensemble des concep-
tions philosophiques de l'antiquité. Le bien
absolu consistant pour les anciens — et
aujourd'hui encore pour beaucoup de mo-
dernes •— dans l'ataraxie, c'est-à-dire dans
l'immobilité morale, le beau absolu devait
par la même raison se confondre avec
i. Voir l'Art, i r année, tome I", pages io,3 et 2i3.
Encadrement composé et dessiné pour «l'Art» par j. Habert-Dys.
Tome XXXVIII. 35