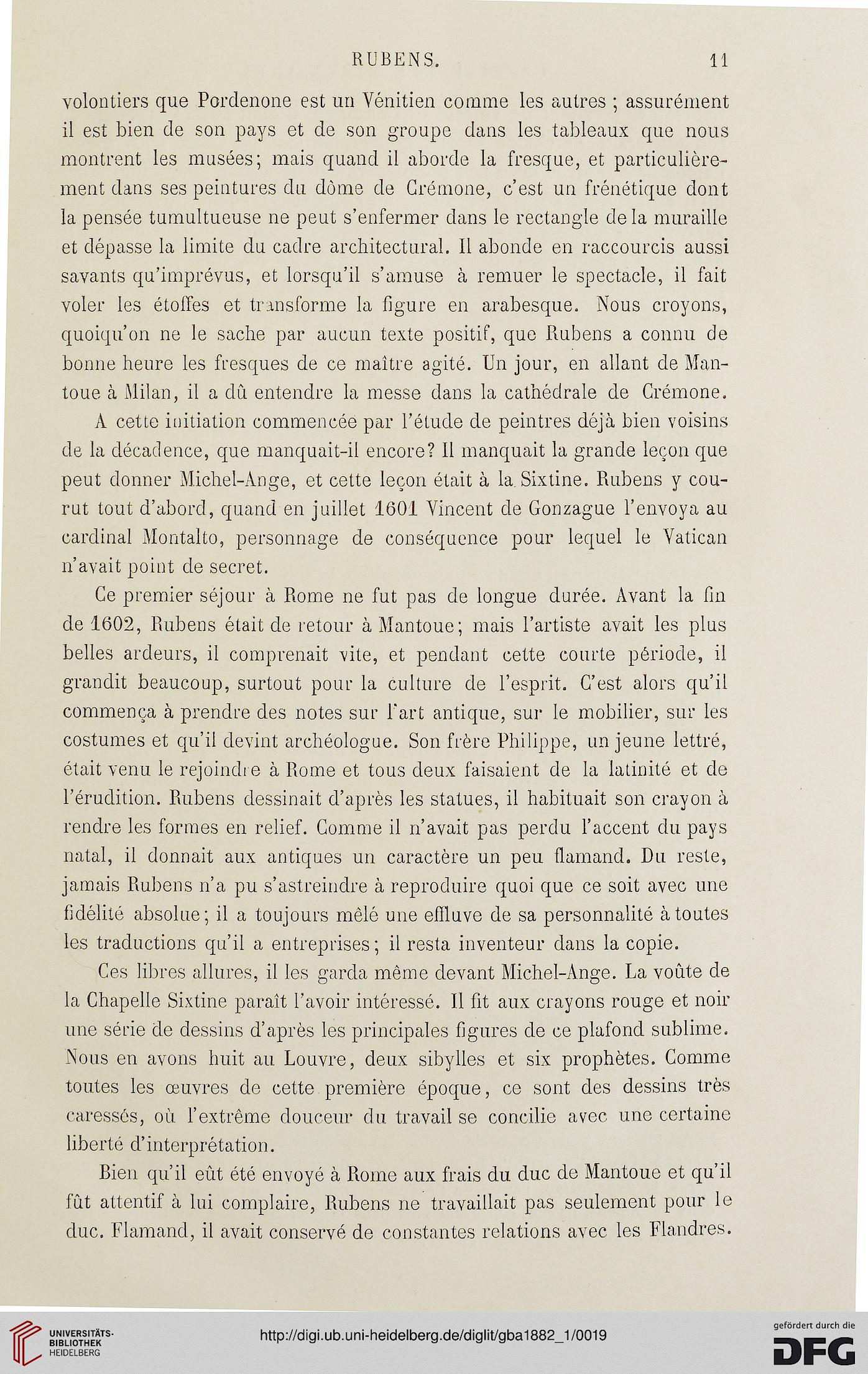RUBENS.
11
volontiers que Pordenone est un Vénitien comme les autres ; assurément
il est bien de son pays et de son groupe dans les tableaux que nous
montrent les musées; mais quand il aborde la fresque, et particulière-
ment dans ses peintures du dôme de Crémone, c’est un frénétique dont
la pensée tumultueuse ne peut s’enfermer dans le rectangle de la muraille
et dépasse la limite du cadre architectural. Il abonde en raccourcis aussi
savants qu’imprévus, et lorsqu’il s’amuse à remuer le spectacle, il fait
voler les étoffes et transforme la figure en arabesque. Nous croyons,
quoiqu’on ne le sache par aucun texte positif, que Rubens a connu de
bonne heure les fresques de ce maître agité. Un jour, en allant de Man-
toue à Milan, il a dû entendre la messe dans la cathédrale de Crémone.
A cette initiation commencée par l’étude de peintres déjà bien voisins
de la décadence, que manquait-il encore? Il manquait la grande leçon que
peut donner Michel-Ange, et cette leçon était à la. Sixtine. Rubens y cou-
rut tout d’abord, quand en juillet 1601 Vincent de Gonzague l’envoya au
cardinal Montalto, personnage de conséquence pour lequel le Vatican
n’avait point de secret.
Ce premier séjour à Rome ne fut pas de longue durée. Avant la fin
de 1602, Rubens était de retour àMantoue; mais l’artiste avait les plus
belles ardeurs, il comprenait vite, et pendant cette courte période, il
grandit beaucoup, surtout pour la culture de l’esprit. C’est alors qu’il
commença à prendre des notes sur l'art antique, sur le mobilier, sur les
costumes et qu’il devint archéologue. Son frère Philippe, un jeune lettré,
était venu le rejoindre à Rome et tous deux faisaient de la latinité et de
l’érudition. Rubens dessinait d’après les statues, il habituait son crayon à
rendre les formes en relief. Comme il n’avait pas perdu l’accent du pays
natal, il donnait aux antiques un caractère un peu flamand. Du reste,
jamais Rubens n’a pu s’astreindre à reproduire quoi que ce soit avec une
fidélité absolue; il a toujours mêlé une ellluve de sa personnalité à toutes
les traductions qu’il a entreprises; il resta inventeur dans la copie.
Ces libres allures, il les garda même devant Michel-Ange. La voûte de
la Chapelle Sixtine paraît l’avoir intéressé. 11 fit aux crayons rouge et noir
une série de dessins d’après les principales figures de ce plafond sublime.
Nous en avons huit au Louvre, deux sibylles et six prophètes. Comme
toutes les œuvres de cette première époque, ce sont des dessins très
caressés, où l’extrême douceur du travail se concilie avec une certaine
liberté d’interprétation.
Bien qu’il eût été envoyé à Rome aux frais du duc de Mantoue et qu’il
fût attentif à lui complaire, Rubens ne travaillait pas seulement pour le
duc. Flamand, il avait conservé de constantes relations avec les Flandres.
11
volontiers que Pordenone est un Vénitien comme les autres ; assurément
il est bien de son pays et de son groupe dans les tableaux que nous
montrent les musées; mais quand il aborde la fresque, et particulière-
ment dans ses peintures du dôme de Crémone, c’est un frénétique dont
la pensée tumultueuse ne peut s’enfermer dans le rectangle de la muraille
et dépasse la limite du cadre architectural. Il abonde en raccourcis aussi
savants qu’imprévus, et lorsqu’il s’amuse à remuer le spectacle, il fait
voler les étoffes et transforme la figure en arabesque. Nous croyons,
quoiqu’on ne le sache par aucun texte positif, que Rubens a connu de
bonne heure les fresques de ce maître agité. Un jour, en allant de Man-
toue à Milan, il a dû entendre la messe dans la cathédrale de Crémone.
A cette initiation commencée par l’étude de peintres déjà bien voisins
de la décadence, que manquait-il encore? Il manquait la grande leçon que
peut donner Michel-Ange, et cette leçon était à la. Sixtine. Rubens y cou-
rut tout d’abord, quand en juillet 1601 Vincent de Gonzague l’envoya au
cardinal Montalto, personnage de conséquence pour lequel le Vatican
n’avait point de secret.
Ce premier séjour à Rome ne fut pas de longue durée. Avant la fin
de 1602, Rubens était de retour àMantoue; mais l’artiste avait les plus
belles ardeurs, il comprenait vite, et pendant cette courte période, il
grandit beaucoup, surtout pour la culture de l’esprit. C’est alors qu’il
commença à prendre des notes sur l'art antique, sur le mobilier, sur les
costumes et qu’il devint archéologue. Son frère Philippe, un jeune lettré,
était venu le rejoindre à Rome et tous deux faisaient de la latinité et de
l’érudition. Rubens dessinait d’après les statues, il habituait son crayon à
rendre les formes en relief. Comme il n’avait pas perdu l’accent du pays
natal, il donnait aux antiques un caractère un peu flamand. Du reste,
jamais Rubens n’a pu s’astreindre à reproduire quoi que ce soit avec une
fidélité absolue; il a toujours mêlé une ellluve de sa personnalité à toutes
les traductions qu’il a entreprises; il resta inventeur dans la copie.
Ces libres allures, il les garda même devant Michel-Ange. La voûte de
la Chapelle Sixtine paraît l’avoir intéressé. 11 fit aux crayons rouge et noir
une série de dessins d’après les principales figures de ce plafond sublime.
Nous en avons huit au Louvre, deux sibylles et six prophètes. Comme
toutes les œuvres de cette première époque, ce sont des dessins très
caressés, où l’extrême douceur du travail se concilie avec une certaine
liberté d’interprétation.
Bien qu’il eût été envoyé à Rome aux frais du duc de Mantoue et qu’il
fût attentif à lui complaire, Rubens ne travaillait pas seulement pour le
duc. Flamand, il avait conservé de constantes relations avec les Flandres.