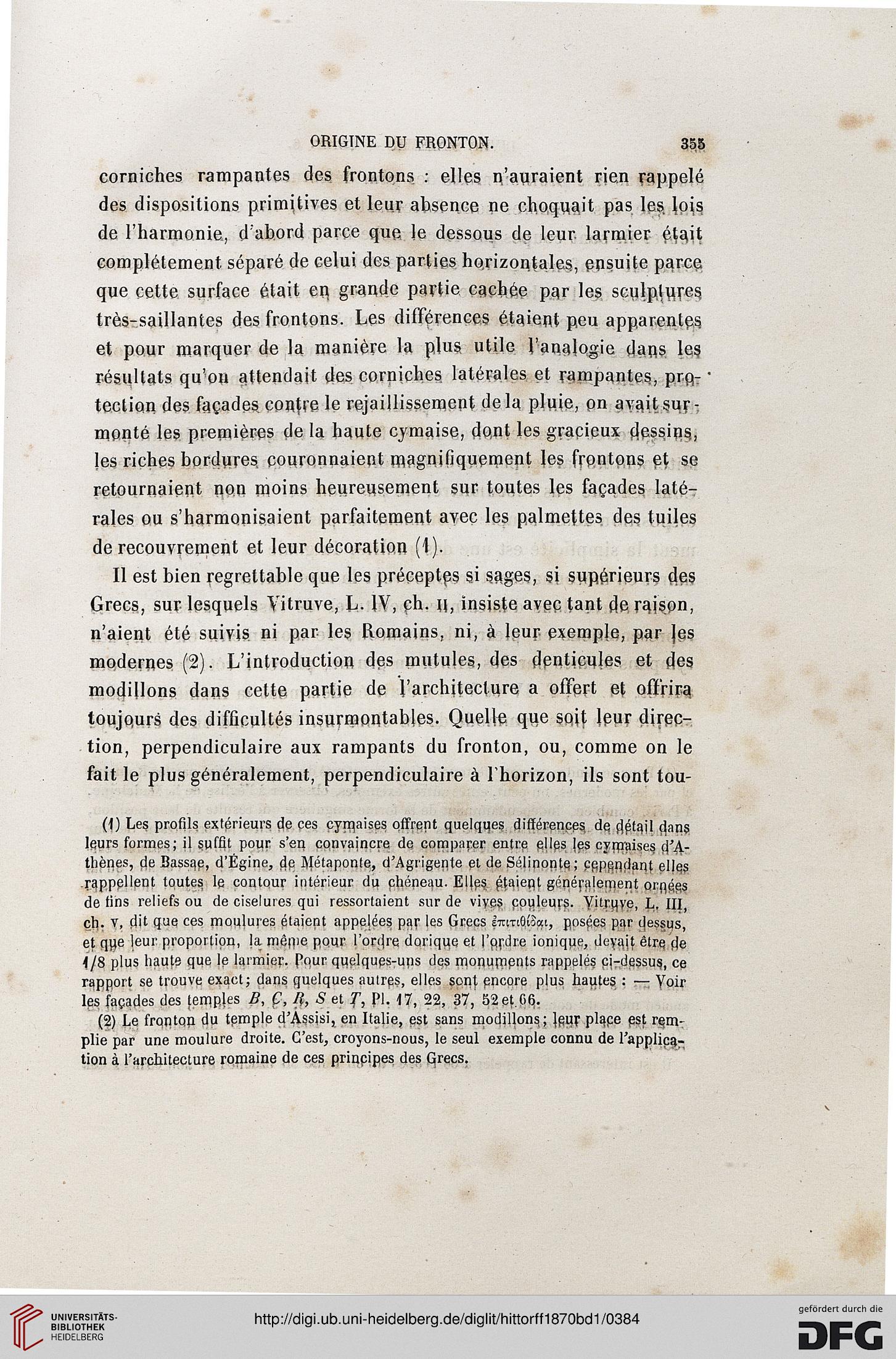ORIGTNE DU FRONTON. 355
corniches rampantes des frontons : elles n'auraient rien rappelé
des dispositions primitives et leur absence ne choquait pas les. lois
de l'harmonie., d'abord parce que le dessous de leur, larmier éÇa,it
complètement séparé de celui des parties horizontales, ensuite parce,
que cette, surface était en, grande partie cachée par les scylp.tu.res,
très-saillantes des frontons. Les différences étaient peu apparentes
et pour marquer de la manière la plus, utile l'analogie dans les
résultats qu'on attendait des corniches latérales et rampantes, prfir '
tection des façades.çonfre le rejaillissement delà pluie, pn ava.it sur 7
monté les premières de la haute cymaise, do,nt les gracieux dessins,,
les riches bordures, couronnaient inagnifiquemept les frontons eÇ se
retournaient non moins heureusement sur toutes les façades, laté^
raies ou s'harmonisaient parfaitement avec les palmettes des tuiles
de recouvrement et leur décoration (1).
Il est bien regrettable que les préceptes si sages, si supérieurs des
Grecs, sur- lesquels Vitruve, L- IV, çh. \\, insiste avec tant de raispn,
n'aient été suivis ni par les Romains, ni, à leur, exemple, par les
modernes (2). L'introduction des mutules, des dentieuîes et des
modillons dans cette partie de l'architecture a offert et offrira
toujqurs des difficultés insurmontables. Quelle que soit leur direc-
tion, perpendiculaire aux rampants du fronton, ou, comme on le
fait le plus généralement, perpendiculaire à l'horizon, ils sont tou-
(1) Les profils, extérieurs de ces çyrqaises offrent quelqqes différences, de. fjgtajï ejans.
leurs formes; il suffit pour s'en convaincre; de comparer entre elles (es cyrfraises d'A-
thèiies, de Bassqe, d'Égine, de l^létaponte, d'Agrigente et de Séjinonte; pfipefldaqt ellqs
rappellent toutes le contour intérieur du çhéneau. Elles, paient généralernent Qrqéss
de fins reliefs ou de ciselures qui ressortaient sur de vives couleurs. YHr.Hye, L, m
çh. v, dit que ces moulures élajent appelées par les Grecs |7ctTi9i'Sai, posées pjç dessus,
et que leur proportion, la, mênie pour l'ordre dorique et l'ordre ionique, deyajt êtr.q de
4/8 plus haute que le larmier, pour quelques-uns des monuments rappelés cj-dessus, ce
rapport se trouve exact; dans quelques autres, elles sont encore plus hautes : — Yoir
les façades des ternpks B, Ç, % S et f, pi. 47, 22, 37, ^2et.C>6. '
(2) Le fronton du temple d'Assisi, en Italie, est sans modillons; Je,ur plqçe pst rem-
plie par une moulure droite. C'est, croyons-nous, le seul exemple connu de l'applica-
tion à l'architecture romaine de ces principes des Qrecs.
corniches rampantes des frontons : elles n'auraient rien rappelé
des dispositions primitives et leur absence ne choquait pas les. lois
de l'harmonie., d'abord parce que le dessous de leur, larmier éÇa,it
complètement séparé de celui des parties horizontales, ensuite parce,
que cette, surface était en, grande partie cachée par les scylp.tu.res,
très-saillantes des frontons. Les différences étaient peu apparentes
et pour marquer de la manière la plus, utile l'analogie dans les
résultats qu'on attendait des corniches latérales et rampantes, prfir '
tection des façades.çonfre le rejaillissement delà pluie, pn ava.it sur 7
monté les premières de la haute cymaise, do,nt les gracieux dessins,,
les riches bordures, couronnaient inagnifiquemept les frontons eÇ se
retournaient non moins heureusement sur toutes les façades, laté^
raies ou s'harmonisaient parfaitement avec les palmettes des tuiles
de recouvrement et leur décoration (1).
Il est bien regrettable que les préceptes si sages, si supérieurs des
Grecs, sur- lesquels Vitruve, L- IV, çh. \\, insiste avec tant de raispn,
n'aient été suivis ni par les Romains, ni, à leur, exemple, par les
modernes (2). L'introduction des mutules, des dentieuîes et des
modillons dans cette partie de l'architecture a offert et offrira
toujqurs des difficultés insurmontables. Quelle que soit leur direc-
tion, perpendiculaire aux rampants du fronton, ou, comme on le
fait le plus généralement, perpendiculaire à l'horizon, ils sont tou-
(1) Les profils, extérieurs de ces çyrqaises offrent quelqqes différences, de. fjgtajï ejans.
leurs formes; il suffit pour s'en convaincre; de comparer entre elles (es cyrfraises d'A-
thèiies, de Bassqe, d'Égine, de l^létaponte, d'Agrigente et de Séjinonte; pfipefldaqt ellqs
rappellent toutes le contour intérieur du çhéneau. Elles, paient généralernent Qrqéss
de fins reliefs ou de ciselures qui ressortaient sur de vives couleurs. YHr.Hye, L, m
çh. v, dit que ces moulures élajent appelées par les Grecs |7ctTi9i'Sai, posées pjç dessus,
et que leur proportion, la, mênie pour l'ordre dorique et l'ordre ionique, deyajt êtr.q de
4/8 plus haute que le larmier, pour quelques-uns des monuments rappelés cj-dessus, ce
rapport se trouve exact; dans quelques autres, elles sont encore plus hautes : — Yoir
les façades des ternpks B, Ç, % S et f, pi. 47, 22, 37, ^2et.C>6. '
(2) Le fronton du temple d'Assisi, en Italie, est sans modillons; Je,ur plqçe pst rem-
plie par une moulure droite. C'est, croyons-nous, le seul exemple connu de l'applica-
tion à l'architecture romaine de ces principes des Qrecs.