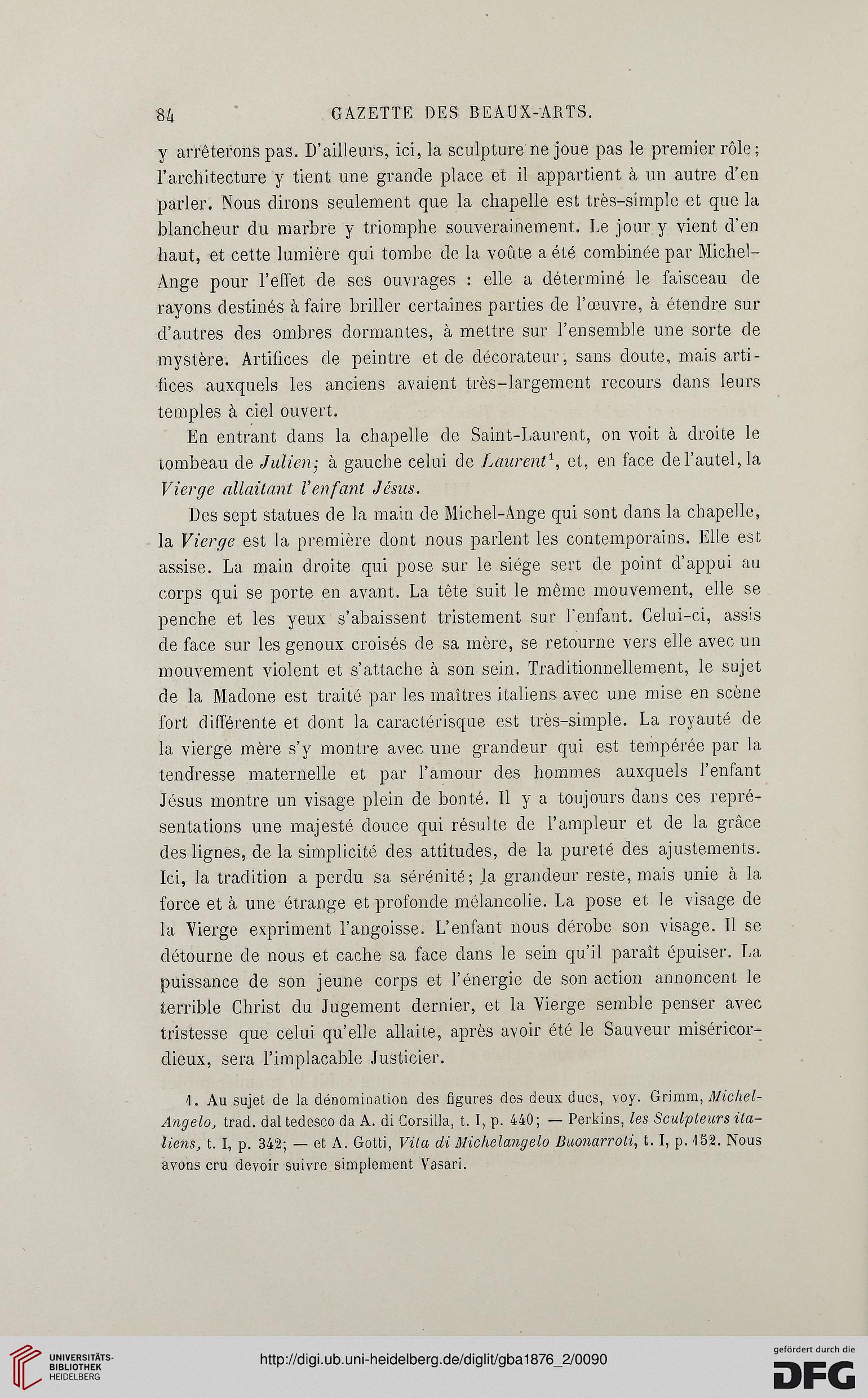GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
U
y arrêterons pas. D’ailleurs, ici, la sculpture ne joue pas le premier rôle;
l’architecture y tient une grande place et il appartient à un autre d’en
parler. Nous dirons seulement que la chapelle est très-simple et que la
blancheur du marbre y triomphe souverainement. Le jour y vient d’en
haut, et cette lumière qui tombe de la voûte a été combinée par Michel-
Ange pour l’effet de ses ouvrages : elle a déterminé le faisceau de
rayons destinés à faire briller certaines parties de l’œuvre, à étendre sur
d’autres des ombres dormantes, à mettre sur l’ensemble une sorte de
mystère. Artifices de peintre et de décorateur, sans doute, mais arti-
fices auxquels les anciens avaient très-largement recours dans leurs
temples à ciel ouvert.
En entrant dans la chapelle de Saint-Laurent, on voit à droite le
tombeau de Julien • à gauche celui de Laurenti, et, en face de l’autel, la
Vierge allaitant Venfant Jésus.
Des sept statues de la main de Michel-Ange qui sont dans la chapelle,
la Vierge est la première dont nous parlent les contemporains. Elle est
assise. La main droite qui pose sur le siège sert de point d’appui au
corps qui se porte en avant. La tête suit le même mouvement, elle se
penche et les yeux s’abaissent tristement sur l’enfant. Celui-ci, assis
de face sur les genoux croisés de sa mère, se retourne vers elle avec un
mouvement violent et s’attache à son sein. Traditionnellement, le sujet
de la Madone est traité par les maîtres italiens avec une mise en scène
fort différente et dont la caractérisque est très-simple. La royauté de
la vierge mère s’y montre avec une grandeur qui est tempérée par la
tendresse maternelle et par l’amour des hommes auxquels l’enfant
Jésus montre un visage plein de bonté. Il y a toujours dans ces repré-
sentations une majesté douce qui résulte de l’ampleur et de la grâce
des lignes, de la simplicité des attitudes, de la pureté des ajustements.
Ici, la tradition a perdu sa sérénité; la grandeur reste, mais unie à la
force et à une étrange et profonde mélancolie. La pose et le visage de
la Vierge expriment l’angoisse. L’enfant nous dérobe son visage. Il se
détourne de nous et cache sa face dans le sein qu’il paraît épuiser. La
puissance de son jeune corps et l’énergie de son action annoncent le
terrible Christ du Jugement dernier, et la Vierge semble penser avec
tristesse que celui qu’elle allaite, après avoir été le Sauveur miséricor-
dieux, sera l’implacable Justicier.
1. Au sujet de la dénomination des figures des deux ducs, voy. Grimm, Michel-
Angelo, trad. dal tedosco da A. di Corsilla, t. I, p. 440; — Perkins, les Sculpteurs ita-
liens, t. I, p. 342; — et A. Gotti, Vila cli Michelangelo Buonarroti, t. I, p. -152. Nous
avons cru devoir suivre simplement Vasari.
U
y arrêterons pas. D’ailleurs, ici, la sculpture ne joue pas le premier rôle;
l’architecture y tient une grande place et il appartient à un autre d’en
parler. Nous dirons seulement que la chapelle est très-simple et que la
blancheur du marbre y triomphe souverainement. Le jour y vient d’en
haut, et cette lumière qui tombe de la voûte a été combinée par Michel-
Ange pour l’effet de ses ouvrages : elle a déterminé le faisceau de
rayons destinés à faire briller certaines parties de l’œuvre, à étendre sur
d’autres des ombres dormantes, à mettre sur l’ensemble une sorte de
mystère. Artifices de peintre et de décorateur, sans doute, mais arti-
fices auxquels les anciens avaient très-largement recours dans leurs
temples à ciel ouvert.
En entrant dans la chapelle de Saint-Laurent, on voit à droite le
tombeau de Julien • à gauche celui de Laurenti, et, en face de l’autel, la
Vierge allaitant Venfant Jésus.
Des sept statues de la main de Michel-Ange qui sont dans la chapelle,
la Vierge est la première dont nous parlent les contemporains. Elle est
assise. La main droite qui pose sur le siège sert de point d’appui au
corps qui se porte en avant. La tête suit le même mouvement, elle se
penche et les yeux s’abaissent tristement sur l’enfant. Celui-ci, assis
de face sur les genoux croisés de sa mère, se retourne vers elle avec un
mouvement violent et s’attache à son sein. Traditionnellement, le sujet
de la Madone est traité par les maîtres italiens avec une mise en scène
fort différente et dont la caractérisque est très-simple. La royauté de
la vierge mère s’y montre avec une grandeur qui est tempérée par la
tendresse maternelle et par l’amour des hommes auxquels l’enfant
Jésus montre un visage plein de bonté. Il y a toujours dans ces repré-
sentations une majesté douce qui résulte de l’ampleur et de la grâce
des lignes, de la simplicité des attitudes, de la pureté des ajustements.
Ici, la tradition a perdu sa sérénité; la grandeur reste, mais unie à la
force et à une étrange et profonde mélancolie. La pose et le visage de
la Vierge expriment l’angoisse. L’enfant nous dérobe son visage. Il se
détourne de nous et cache sa face dans le sein qu’il paraît épuiser. La
puissance de son jeune corps et l’énergie de son action annoncent le
terrible Christ du Jugement dernier, et la Vierge semble penser avec
tristesse que celui qu’elle allaite, après avoir été le Sauveur miséricor-
dieux, sera l’implacable Justicier.
1. Au sujet de la dénomination des figures des deux ducs, voy. Grimm, Michel-
Angelo, trad. dal tedosco da A. di Corsilla, t. I, p. 440; — Perkins, les Sculpteurs ita-
liens, t. I, p. 342; — et A. Gotti, Vila cli Michelangelo Buonarroti, t. I, p. -152. Nous
avons cru devoir suivre simplement Vasari.