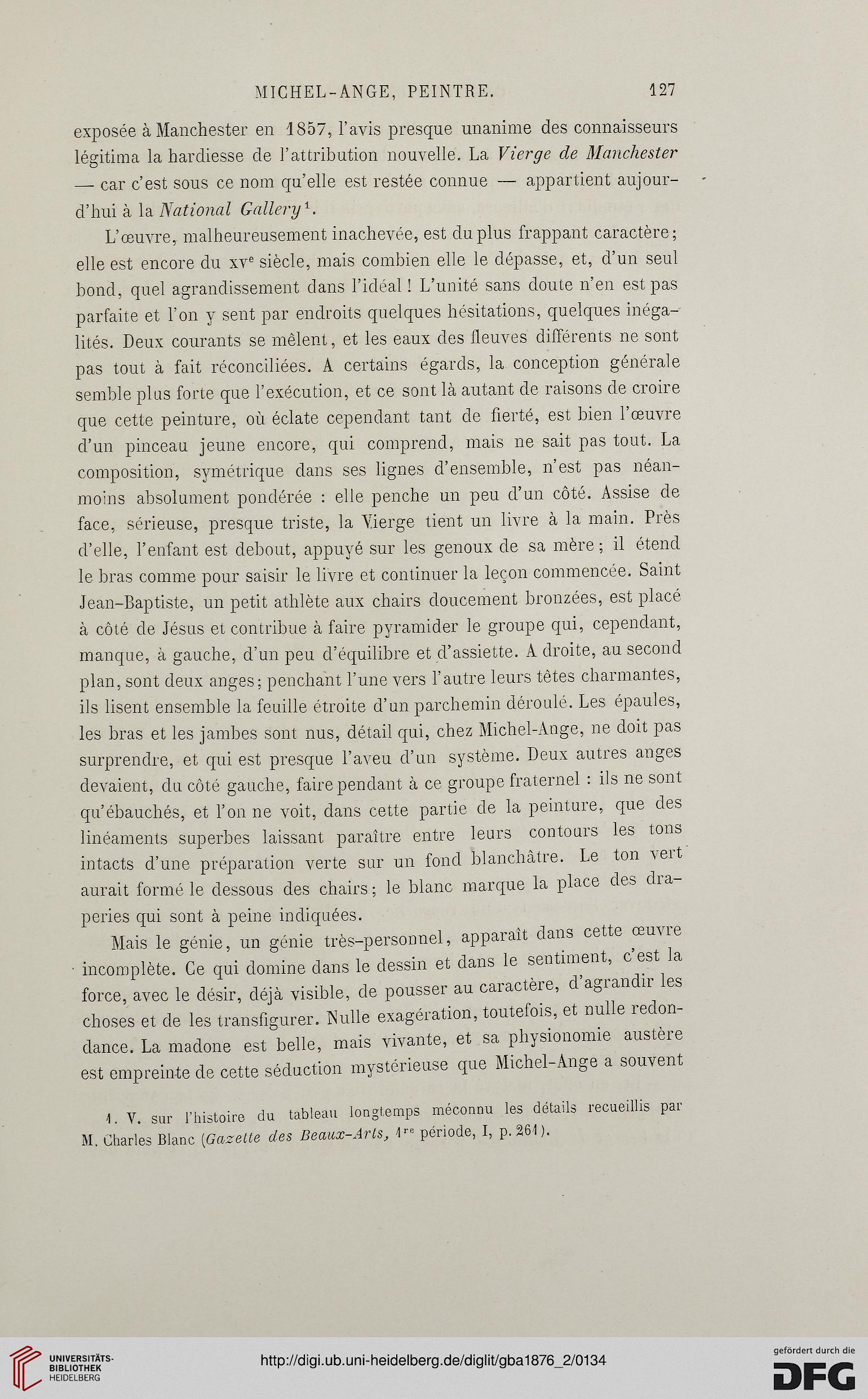MICHEL-ANGE, PEINTRE.
127
exposée à Manchester en 1857, l’avis presque unanime des connaisseurs
légitima la hardiesse de l’attribution nouvelle. La Vierge de Manchester
— car c’est sous ce nom qu’elle est restée connue — appartient aujour-
d’hui à la National Gallery1.
L’œuvre, malheureusement inachevée, est du plus frappant caractère;
elle est encore du xve siècle, mais combien elle le dépasse, et, d’un seul
bond, quel agrandissement dans l’idéal ! L’unité sans doute n’en est pas
parfaite et l’on y sent par endroits quelques hésitations, quelques inéga-
lités. Deux courants se mêlent, et les eaux des fleuves différents ne sont
pas tout à fait réconciliées. A certains égards, la conception générale
semble pins forte que l’exécution, et ce sont là autant de raisons de croire
que cette peinture, où éclate cependant tant de fierté, est bien l’œuvre
d’un pinceau jeune encore, qui comprend, mais ne sait pas tout. La
composition, symétrique dans ses lignes d’ensemble, n’est pas néan-
moins absolument pondérée : elle penche un peu d’un côté. Assise de
face, sérieuse, presque triste, la Aierge tient un livre à la main. Près
d’elle, l’enfant est debout, appuyé sur les genoux de sa mère; il étend
le bras comme pour saisir le livre et continuer la leçon commencée. Saint
Jean-Baptiste, un petit athlète aux chairs doucement bronzées, est placé
à côté de Jésus et contribue à faire pyramider le groupe qui, cependant,
manque, à gauche, d’un peu d’équilibre et d’assiette. A droite, au second
plan, sont deux anges; penchant l’une vers l’autre leurs tètes charmantes,
ils lisent ensemble la feuille étroite d’un parchemin déroulé. Les épaules,
les bras et les jambes sont nus, détail qui, chez Michel-Ange, ne doit pas
surprendre, et qui est presque l’aveu cl’un système. Deux autres anges
devaient, du côté gauche, faire pendant à ce groupe fraternel : ils ne sont
qu’ébauchés, et l’on ne voit, dans cette partie de la peinture, que des
linéaments superbes laissant paraître entre leurs contours les tons
intacts d’une préparation verte sur un fond blanchâtre. Le ton vert
aurait formé le dessous des chairs ; le blanc marque la place des dra-
peries qui sont à peine indiquées.
Mais le génie, un génie très-personnel, apparaît dans cette œuvie
incomplète. Ce qui domine dans le dessin et dans le sentiment, c est la
force, avec le désir, déjà visible, de pousser au caractère, d agiandii les
choses et de les transfigurer. Nulle exagération, toutefois, et nulle îedon-
dance. La madone est belle, mais vivante, et sa physionomie austère
est empreinte de cette séduction mystérieuse que Michel-Ange a souvent
■1. V. sur l’histoire du tableau longtemps méconnu les détails recueillis par
M. Charles Blanc (Gazette des Beaux-Arts, 1re période, I, p. 261).
127
exposée à Manchester en 1857, l’avis presque unanime des connaisseurs
légitima la hardiesse de l’attribution nouvelle. La Vierge de Manchester
— car c’est sous ce nom qu’elle est restée connue — appartient aujour-
d’hui à la National Gallery1.
L’œuvre, malheureusement inachevée, est du plus frappant caractère;
elle est encore du xve siècle, mais combien elle le dépasse, et, d’un seul
bond, quel agrandissement dans l’idéal ! L’unité sans doute n’en est pas
parfaite et l’on y sent par endroits quelques hésitations, quelques inéga-
lités. Deux courants se mêlent, et les eaux des fleuves différents ne sont
pas tout à fait réconciliées. A certains égards, la conception générale
semble pins forte que l’exécution, et ce sont là autant de raisons de croire
que cette peinture, où éclate cependant tant de fierté, est bien l’œuvre
d’un pinceau jeune encore, qui comprend, mais ne sait pas tout. La
composition, symétrique dans ses lignes d’ensemble, n’est pas néan-
moins absolument pondérée : elle penche un peu d’un côté. Assise de
face, sérieuse, presque triste, la Aierge tient un livre à la main. Près
d’elle, l’enfant est debout, appuyé sur les genoux de sa mère; il étend
le bras comme pour saisir le livre et continuer la leçon commencée. Saint
Jean-Baptiste, un petit athlète aux chairs doucement bronzées, est placé
à côté de Jésus et contribue à faire pyramider le groupe qui, cependant,
manque, à gauche, d’un peu d’équilibre et d’assiette. A droite, au second
plan, sont deux anges; penchant l’une vers l’autre leurs tètes charmantes,
ils lisent ensemble la feuille étroite d’un parchemin déroulé. Les épaules,
les bras et les jambes sont nus, détail qui, chez Michel-Ange, ne doit pas
surprendre, et qui est presque l’aveu cl’un système. Deux autres anges
devaient, du côté gauche, faire pendant à ce groupe fraternel : ils ne sont
qu’ébauchés, et l’on ne voit, dans cette partie de la peinture, que des
linéaments superbes laissant paraître entre leurs contours les tons
intacts d’une préparation verte sur un fond blanchâtre. Le ton vert
aurait formé le dessous des chairs ; le blanc marque la place des dra-
peries qui sont à peine indiquées.
Mais le génie, un génie très-personnel, apparaît dans cette œuvie
incomplète. Ce qui domine dans le dessin et dans le sentiment, c est la
force, avec le désir, déjà visible, de pousser au caractère, d agiandii les
choses et de les transfigurer. Nulle exagération, toutefois, et nulle îedon-
dance. La madone est belle, mais vivante, et sa physionomie austère
est empreinte de cette séduction mystérieuse que Michel-Ange a souvent
■1. V. sur l’histoire du tableau longtemps méconnu les détails recueillis par
M. Charles Blanc (Gazette des Beaux-Arts, 1re période, I, p. 261).