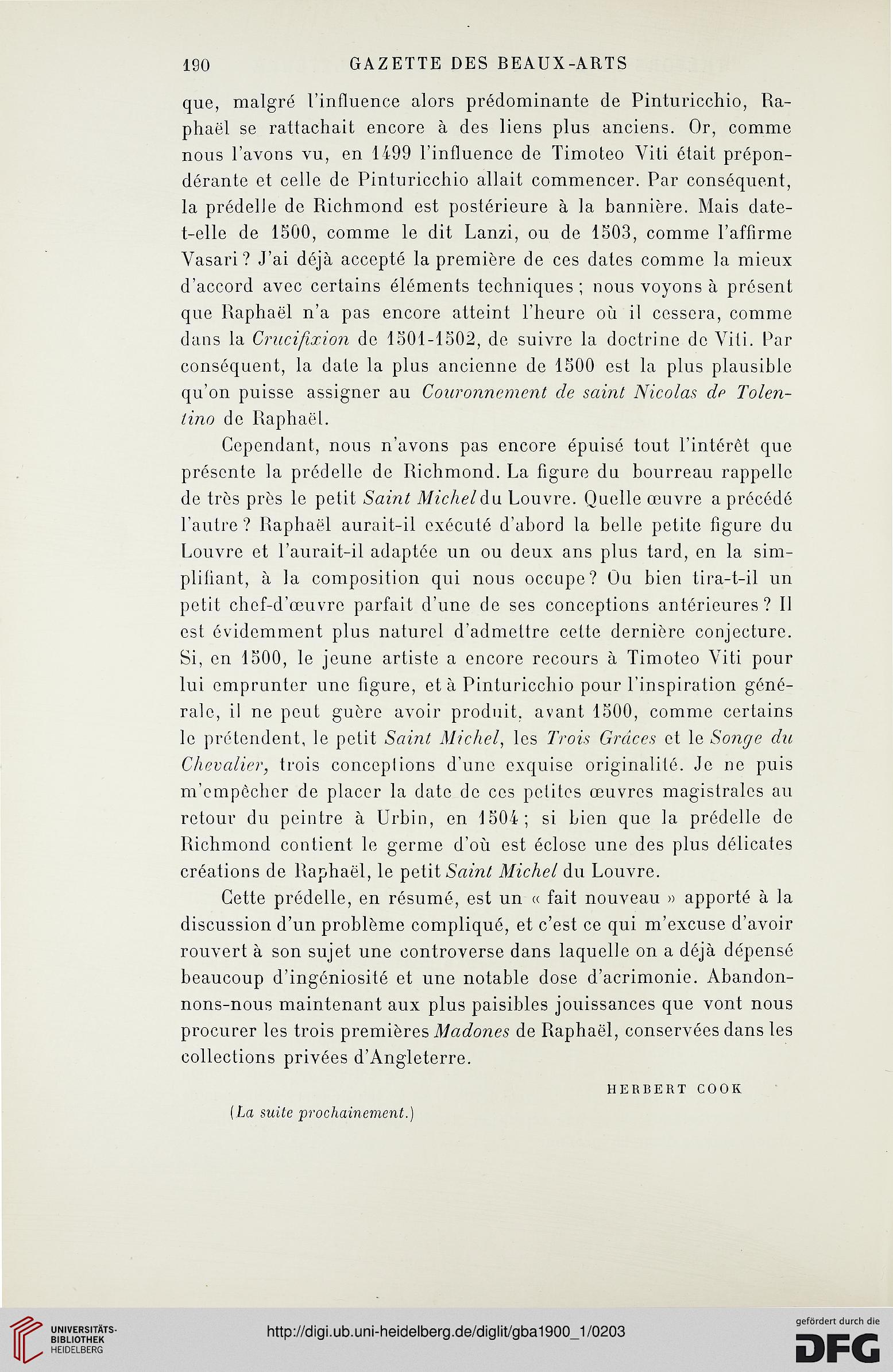190
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
que, malgré l’influence alors prédominante de Pinturicchio, Ra-
phaël se rattachait encore à des liens plus anciens. Or, comme
nous l’avons vu, en 1499 l'influence de Timoteo Yiti était prépon-
dérante et celle de Pinturicchio allait commencer. Par conséquent,
la prédelle de Richmond est postérieure à la bannière. Mais date-
t-elle de 1500, comme le dit Lanzi, ou de 1503, comme l’affirme
Vasari? J’ai déjà accepté la première de ces dates comme la mieux
d'accord avec certains éléments techniques ; nous voyons à présent
que Raphaël n’a pas encore atteint l’heure où il cessera, comme
dans la Crucifixion de 1501-1502, de suivre la doctrine de Viti. Par
conséquent, la date la plus ancienne de 1500 est la plus plausible
qu’on puisse assigner au Couronnement de saint Nicolas de Tolen-
tino de Raphaël.
Cependant, nous n’avons pas encore épuisé tout l’intérêt que
présente la prédelle de Richmond. La figure du bourreau rappelle
de très près le petit Saint Michelàu. Louvre. Quelle œuvre a précédé
l'autre ? Raphaël aurait-il exécuté d’abord la belle petite figure du
Louvre et l’aurait-il adaptée un ou deux ans plus tard, en la sim-
plifiant, à la composition qui nous occupe? Ou bien tira-t-il un
petit chef-d’œuvre parfait d’une de ses conceptions antérieures? Il
est évidemment plus naturel d’admettre cette dernière conjecture.
Si, en 1500, le jeune artiste a encore recours à Timoteo Viti pour
lui emprunter une figure, et à Pinturicchio pour l’inspiration géné-
rale, il ne peut guère avoir produit, avant 1500, comme certains
le prétendent, le petit Saint Michel, les Trois Grâces et le Songe du
Chevalier, trois conceplions d’une exquise originalité. Je ne puis
m’empêcher de placer la date de ces petites œuvres magistrales au
retour du peintre à Urbin, en 1504; si bien que la prédelle de
Richmond contient le germe d’où est éclose une des plus délicates
créations de Raphaël, le petit Saint Michel du Louvre.
Cette prédelle, en résumé, est un « fait nouveau » apporté à la
discussion d’un problème compliqué, et c’est ce qui m’excuse d’avoir
rouvert à son sujet une controverse dans laquelle on a déjà dépensé
beaucoup d’ingéniosité et une notable dose d’acrimonie. Abandon-
nons-nous maintenant aux plus paisibles jouissances que vont nous
procurer les trois premières Madones de Raphaël, conservées dans les
collections privées d’Angleterre.
HERBERT COOK
(La suite prochainement.)
GAZETTE DES BEAUX-ARTS
que, malgré l’influence alors prédominante de Pinturicchio, Ra-
phaël se rattachait encore à des liens plus anciens. Or, comme
nous l’avons vu, en 1499 l'influence de Timoteo Yiti était prépon-
dérante et celle de Pinturicchio allait commencer. Par conséquent,
la prédelle de Richmond est postérieure à la bannière. Mais date-
t-elle de 1500, comme le dit Lanzi, ou de 1503, comme l’affirme
Vasari? J’ai déjà accepté la première de ces dates comme la mieux
d'accord avec certains éléments techniques ; nous voyons à présent
que Raphaël n’a pas encore atteint l’heure où il cessera, comme
dans la Crucifixion de 1501-1502, de suivre la doctrine de Viti. Par
conséquent, la date la plus ancienne de 1500 est la plus plausible
qu’on puisse assigner au Couronnement de saint Nicolas de Tolen-
tino de Raphaël.
Cependant, nous n’avons pas encore épuisé tout l’intérêt que
présente la prédelle de Richmond. La figure du bourreau rappelle
de très près le petit Saint Michelàu. Louvre. Quelle œuvre a précédé
l'autre ? Raphaël aurait-il exécuté d’abord la belle petite figure du
Louvre et l’aurait-il adaptée un ou deux ans plus tard, en la sim-
plifiant, à la composition qui nous occupe? Ou bien tira-t-il un
petit chef-d’œuvre parfait d’une de ses conceptions antérieures? Il
est évidemment plus naturel d’admettre cette dernière conjecture.
Si, en 1500, le jeune artiste a encore recours à Timoteo Viti pour
lui emprunter une figure, et à Pinturicchio pour l’inspiration géné-
rale, il ne peut guère avoir produit, avant 1500, comme certains
le prétendent, le petit Saint Michel, les Trois Grâces et le Songe du
Chevalier, trois conceplions d’une exquise originalité. Je ne puis
m’empêcher de placer la date de ces petites œuvres magistrales au
retour du peintre à Urbin, en 1504; si bien que la prédelle de
Richmond contient le germe d’où est éclose une des plus délicates
créations de Raphaël, le petit Saint Michel du Louvre.
Cette prédelle, en résumé, est un « fait nouveau » apporté à la
discussion d’un problème compliqué, et c’est ce qui m’excuse d’avoir
rouvert à son sujet une controverse dans laquelle on a déjà dépensé
beaucoup d’ingéniosité et une notable dose d’acrimonie. Abandon-
nons-nous maintenant aux plus paisibles jouissances que vont nous
procurer les trois premières Madones de Raphaël, conservées dans les
collections privées d’Angleterre.
HERBERT COOK
(La suite prochainement.)