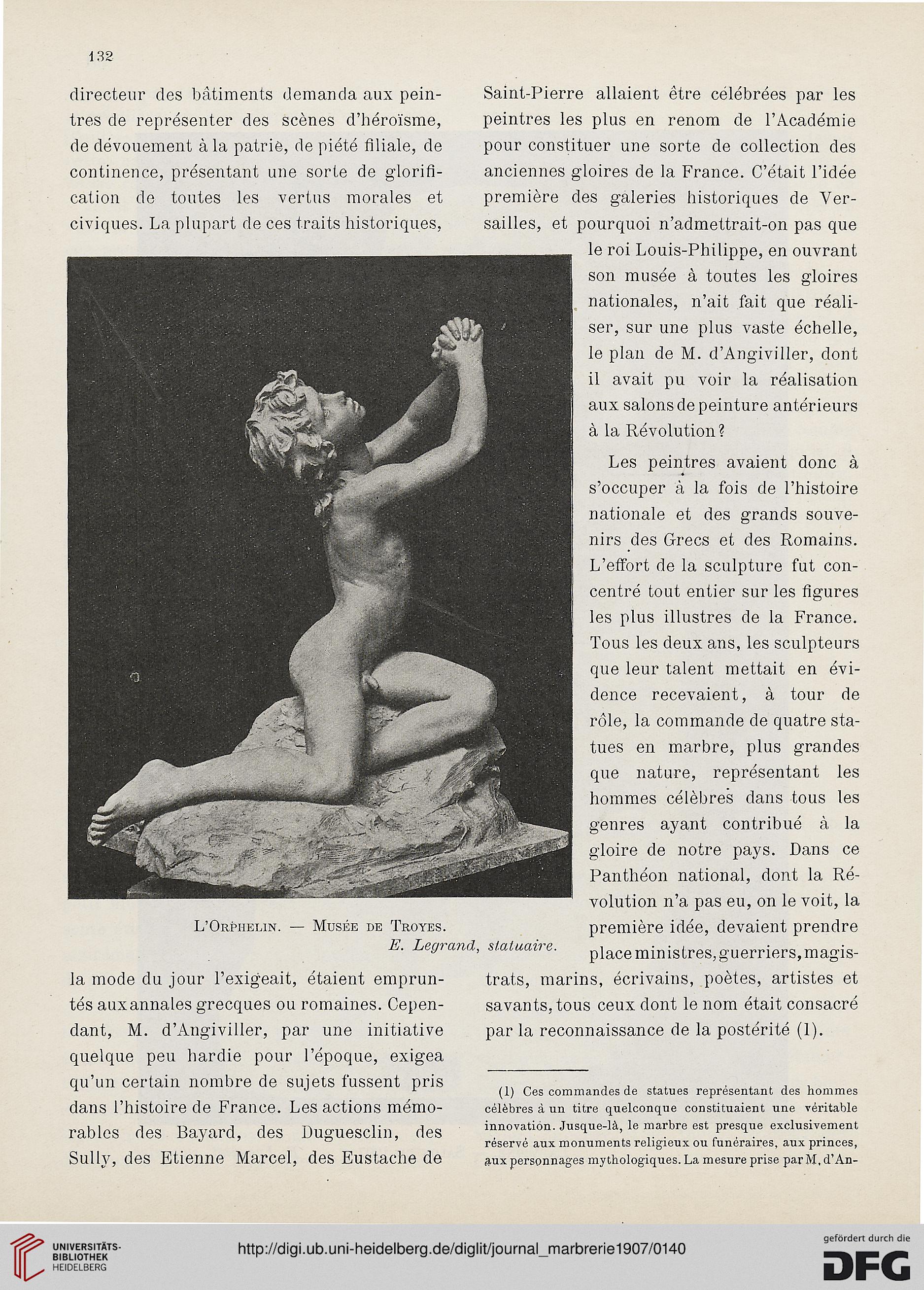132
directeur des bâtiments demanda aux pein- Saint-Pierre allaient être célébrées par les
très de représenter des scènes d'héroïsme, peintres les plus en renom de l'Académie
de dévouement à la patrie, de piété filiale, de pour constituer une sorte de collection des
continence, présentant une sorte de glorifi- anciennes gloires de la France. C'était l'idée
cation de toutes les vertus morales et première des galeries historiques de Ver-
civiques. La plupart de ces traits historiques, sailles, et pourquoi n'admettrait-on pas que
le roi Louis-Philippe, en ouvrant
son musée à toutes les gloires
nationales, n'ait fait que réali-
ser, sur une plus vaste échelle,
le plan de M. d'Angiviller, dont
il avait pu voir la réalisation
aux salons de peinture antérieurs
à la Révolution?
Les peintres avaient donc à
s'occuper à la fois de l'histoire
nationale et des grands souve-
nirs des Grecs et des Romains.
L'effort de la sculpture fut con-
centré tout entier sur les figures
les plus illustres de la France.
Tous les deux ans, les sculpteurs
que leur talent mettait en évi-
dence recevaient, à tour de
rôle, la commande de quatre sta-
tues en marbre, plus grandes
que nature, représentant les
hommes célèbres dans tous les
genres ayant contribué à la
gloire de notre pays. Dans ce
Panthéon national, dont la Ré-
volution n'a pas eu, on le voit, la
L'Orphelin. — Musée de Troyes. première idée, devaient prendre
E. Legrand, statuaire. plaCe ministres, guerriers, magis-
la mode du jour l'exigeait, étaient emprun- trats, marins, écrivains, poètes, artistes et
tés auxannales grecques ou romaines. Cepen- savants, tous ceux dont le nom était consacré
dant, M. d'Angiviller, par une initiative par la reconnaissance de la postérité (1).
quelque peu hardie pour l'époque, exigea
qu'un certain nombre de sujets fussent pris ,, ,., , , . . , . , .
* ,1 l ^ q6s commandes de statues représentant des hommes
dans l'histoire de France. Les actions mémo- célèbres à un titre quelconque constituaient une véritable
rables des Bayard, des Duguesclin, des Ration. Jusque-là, le marbre est presque exclusivement
reserve aux monuments religieux ou iuneraires, aux princes,
Sully, des Etienne Marcel, des Eustache de aux personnages mythologiques. La mesure prise par M, d'An-
directeur des bâtiments demanda aux pein- Saint-Pierre allaient être célébrées par les
très de représenter des scènes d'héroïsme, peintres les plus en renom de l'Académie
de dévouement à la patrie, de piété filiale, de pour constituer une sorte de collection des
continence, présentant une sorte de glorifi- anciennes gloires de la France. C'était l'idée
cation de toutes les vertus morales et première des galeries historiques de Ver-
civiques. La plupart de ces traits historiques, sailles, et pourquoi n'admettrait-on pas que
le roi Louis-Philippe, en ouvrant
son musée à toutes les gloires
nationales, n'ait fait que réali-
ser, sur une plus vaste échelle,
le plan de M. d'Angiviller, dont
il avait pu voir la réalisation
aux salons de peinture antérieurs
à la Révolution?
Les peintres avaient donc à
s'occuper à la fois de l'histoire
nationale et des grands souve-
nirs des Grecs et des Romains.
L'effort de la sculpture fut con-
centré tout entier sur les figures
les plus illustres de la France.
Tous les deux ans, les sculpteurs
que leur talent mettait en évi-
dence recevaient, à tour de
rôle, la commande de quatre sta-
tues en marbre, plus grandes
que nature, représentant les
hommes célèbres dans tous les
genres ayant contribué à la
gloire de notre pays. Dans ce
Panthéon national, dont la Ré-
volution n'a pas eu, on le voit, la
L'Orphelin. — Musée de Troyes. première idée, devaient prendre
E. Legrand, statuaire. plaCe ministres, guerriers, magis-
la mode du jour l'exigeait, étaient emprun- trats, marins, écrivains, poètes, artistes et
tés auxannales grecques ou romaines. Cepen- savants, tous ceux dont le nom était consacré
dant, M. d'Angiviller, par une initiative par la reconnaissance de la postérité (1).
quelque peu hardie pour l'époque, exigea
qu'un certain nombre de sujets fussent pris ,, ,., , , . . , . , .
* ,1 l ^ q6s commandes de statues représentant des hommes
dans l'histoire de France. Les actions mémo- célèbres à un titre quelconque constituaient une véritable
rables des Bayard, des Duguesclin, des Ration. Jusque-là, le marbre est presque exclusivement
reserve aux monuments religieux ou iuneraires, aux princes,
Sully, des Etienne Marcel, des Eustache de aux personnages mythologiques. La mesure prise par M, d'An-