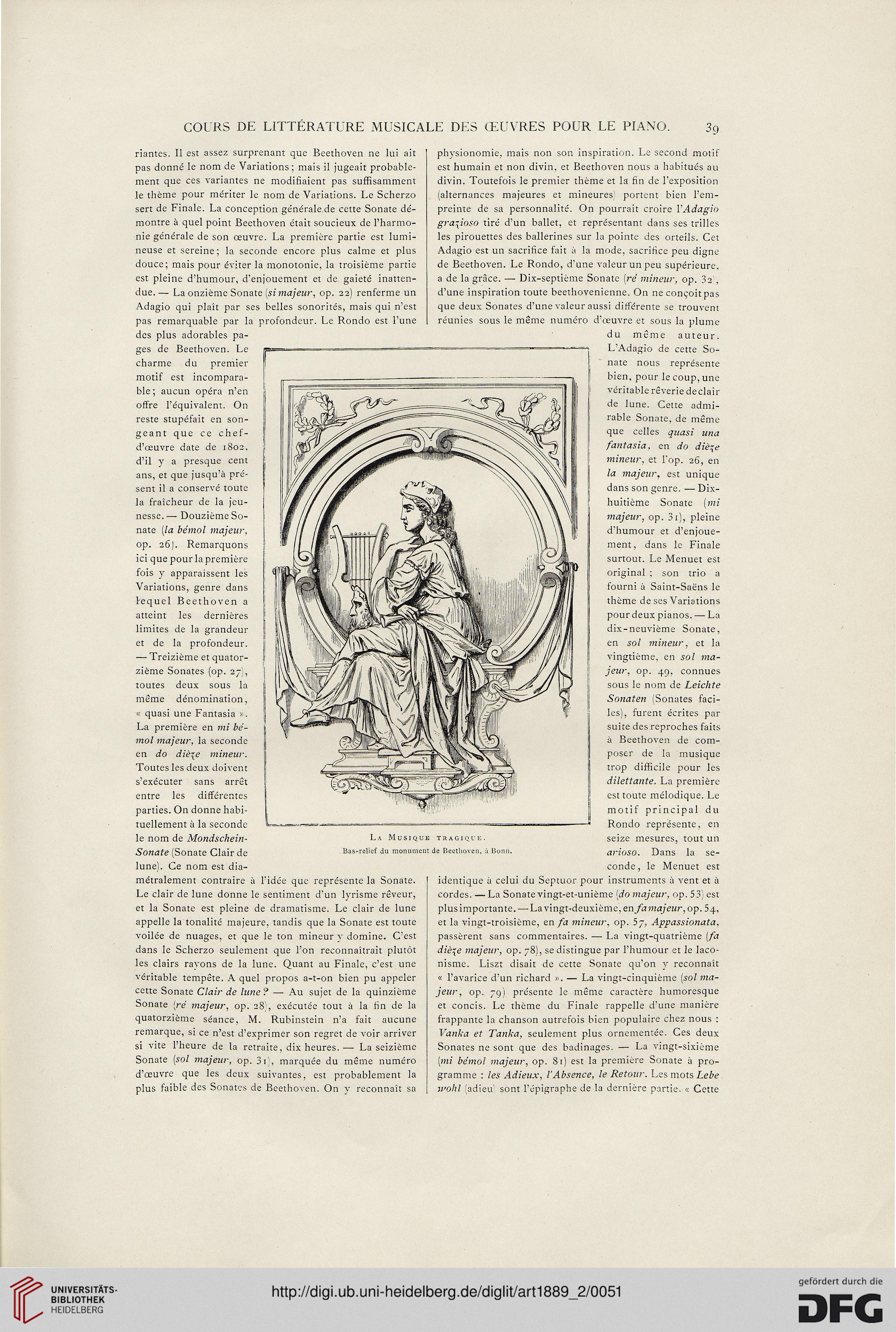COURS DE LITTERATURE MUSICALE DES ŒUVRES POUR LE PIANO.
39
riantes. Il est assez surprenant que Beethoven ne lui ait
pas donné le nom de Variations; mais il jugeait probable-
ment que ces variantes ne modifiaient pas suffisamment
le thème pour mériter le nom de Variations. Le Scherzo
sert de Finale. La conception générale,de cette Sonate dé-
montre à quel point Beethoven était soucieux de l’harmo-
nie générale de son œuvre. La première partie est lumi-
neuse et sereine; la seconde encore plus calme et plus
douce; mais pour éviter la monotonie, la troisième partie
est pleine d’humour, d’enjouement et de gaieté inatten-
due.— La onzième Sonate [si majeur, op. 22) renferme un
Adagio qui plaît par ses belles sonorités, mais qui n’est
pas remarquable par la profondeur. Le Rondo est l’une
des plus adorables pa-
ges de Beethoven. Le
charme du premier
motif est incompara-
ble ; aucun opéra n’en
offre l’équivalent. On
reste stupéfait en son-
geant que ce chef-
d’œuvre date de 1802,
d’il y a presque cent
ans, et que jusqu’à pré-
sent il a conservé toute
la fraîcheur de la jeu-
nesse. — Douzième So-
nate [la bémol majeur,
op. 26]. Remarquons
ici que pour la première
fois y apparaissent les
Variations, genre dans
lequel Beethoven a
atteint les dernières
limites de la grandeur
et de la profondeur.
— Treizième et quator-
zième Sonates (op. 27),
toutes deux sous la
même dénomination,
« quasi une Fantasia ».
La première en mi bé-
mol majeur, la seconde
en do diè^e mineur.
Toutes les deux doivent
s’exécuter sans arrêt
entre les différentes
parties. On donne habi-
tuellement à la seconde
le nom de Mondschein-
Sonate (Sonate Clair de
lune). Ce nom est dia-
métralement contraire à l'idée que représente la Sonate.
Le clair de lune donne le sentiment d’un lyrisme rêveur,
et la Sonate est pleine de dramatisme. Le clair de lune
appelle la tonalité majeure, tandis que la Sonate est toute
voilée de nuages, et que le ton mineur y domine. C’est
dans le Scherzo seulement que l’on reconnaîtrait plutôt
les clairs rayons de la lune. Quant au Finale, c’est une
véritable tempête. A quel propos a-t-on bien pu appeler
cette Sonate Clair de lune? —- Au sujet de la quinzième
Sonate [ré majeur, op. 28), exécutée tout à la fin de la
quatorzième séance, M. Rubinstein n’a fait aucune
remarque, si ce n’est d’exprimer son regret de voir arriver
si vite l’heure de la retraite, dix heures. — La seizième
Sonate (sol majeur, op. 3 1 ), marquée du même numéro
d’œuvre que les deux suivantes, est probablement la
plus faible des Sonates de Beethoven. On y reconnaît sa
physionomie, mais non son inspiration. Le second motif
est humain et non divin, et Beethoven nous a habitués au
divin. Toutefois le premier thème et la fin de l'exposition
(alternances majeures et mineures portent bien l’em-
preinte de sa personnalité. On pourrait croire Y Adagio
gra^ioso tiré d’un ballet, et représentant dans ses trilles
les pirouettes des ballerines sur la pointe des orteils. Cet
Adagio est un sacrifice fait à la mode, sacrifice peu digne
de Beethoven. Le Rondo, d'une valeur un peu supérieure,
a de la grâce. — Dix-septième Sonate [ré mineur, op. 3a ,
d’une inspiration toute beethovenienne. On ne conçoit pas
que deux Sonates d’une valeur aussi différente se trouvent
réunies sous le même numéro d’œuvre et sous la plume
du même auteur.
L’Adagio de cette So-
nate nous représente
bien, pour le coup, une
véritable rêverie de clair
de lune. Cette admi-
rable Sonate, de même
que celles quasi una
fantasia, en do diè^e
mineur, et l’op. 26, en
la majeur, est unique
dans son genre. — Dix-
huitième Sonate [mi
majeur, op. 31), pleine
d'humour et d’enjoue-
ment, dans le Finale
surtout. Le Menuet est
original ; son trio a
fourni à Saint-Saêns le
thème de ses Variations
pour deux pianos. — La
dix-neuvième Sonate,
en sol mineur, et la
vingtième, en sol ma-
jeur, op. 49, connues
sous le nom de Leichte
Sonaten (Sonates faci-
les), furent écrites par
suite des reproches faits
à Beethoven de com-
poser de la musique
trop difficile pour les
dilettante. La première
est toute mélodique. Le
motif principal du
Rondo représente, en
seize mesures, tout un
arioso. Dans la se-
conde, le Menuet est
identique à celui du Septuor pour instruments à vent et à
cordes. — La Sonate vingt-et-unième [do majeur, op. 53) est
plus importante.—-La vingt-deuxième, en famajeur, op. 5q,
et la vingt-troisième, en fa mineur, op. 57, Appassionata,
passèrent sans commentaires. — La vingt-quatrième [fa
diè\e majeur, op. 78), se distingue par l’humour et le laco-
nisme. Liszt disait de cette Sonate qu’on y reconnaît
« l’avarice d'un richard ». — La vingt-cinquième [sol ma-
jeur, op. 79) présente le même caractère humoresque
et concis. Le thème du Finale rappelle d’une manière
frappante la chanson autrefois bien populaire chez nous :
Vanka et Tanka, seulement plus ornementée. Ces deux
Sonates ne sont que des badinages. — La vingt-sixième
[mi bémol majeur, op. 81) est la première Sonate à pro-
gramme : les Adieux, l'Absence, le Retour. Les mots Lebe
molli (adieu' sont l’épigraphe de la dernière partie. « Cette
La Musique tragique.
Bas-relief du monument de Beethoven, à Bonn.
39
riantes. Il est assez surprenant que Beethoven ne lui ait
pas donné le nom de Variations; mais il jugeait probable-
ment que ces variantes ne modifiaient pas suffisamment
le thème pour mériter le nom de Variations. Le Scherzo
sert de Finale. La conception générale,de cette Sonate dé-
montre à quel point Beethoven était soucieux de l’harmo-
nie générale de son œuvre. La première partie est lumi-
neuse et sereine; la seconde encore plus calme et plus
douce; mais pour éviter la monotonie, la troisième partie
est pleine d’humour, d’enjouement et de gaieté inatten-
due.— La onzième Sonate [si majeur, op. 22) renferme un
Adagio qui plaît par ses belles sonorités, mais qui n’est
pas remarquable par la profondeur. Le Rondo est l’une
des plus adorables pa-
ges de Beethoven. Le
charme du premier
motif est incompara-
ble ; aucun opéra n’en
offre l’équivalent. On
reste stupéfait en son-
geant que ce chef-
d’œuvre date de 1802,
d’il y a presque cent
ans, et que jusqu’à pré-
sent il a conservé toute
la fraîcheur de la jeu-
nesse. — Douzième So-
nate [la bémol majeur,
op. 26]. Remarquons
ici que pour la première
fois y apparaissent les
Variations, genre dans
lequel Beethoven a
atteint les dernières
limites de la grandeur
et de la profondeur.
— Treizième et quator-
zième Sonates (op. 27),
toutes deux sous la
même dénomination,
« quasi une Fantasia ».
La première en mi bé-
mol majeur, la seconde
en do diè^e mineur.
Toutes les deux doivent
s’exécuter sans arrêt
entre les différentes
parties. On donne habi-
tuellement à la seconde
le nom de Mondschein-
Sonate (Sonate Clair de
lune). Ce nom est dia-
métralement contraire à l'idée que représente la Sonate.
Le clair de lune donne le sentiment d’un lyrisme rêveur,
et la Sonate est pleine de dramatisme. Le clair de lune
appelle la tonalité majeure, tandis que la Sonate est toute
voilée de nuages, et que le ton mineur y domine. C’est
dans le Scherzo seulement que l’on reconnaîtrait plutôt
les clairs rayons de la lune. Quant au Finale, c’est une
véritable tempête. A quel propos a-t-on bien pu appeler
cette Sonate Clair de lune? —- Au sujet de la quinzième
Sonate [ré majeur, op. 28), exécutée tout à la fin de la
quatorzième séance, M. Rubinstein n’a fait aucune
remarque, si ce n’est d’exprimer son regret de voir arriver
si vite l’heure de la retraite, dix heures. — La seizième
Sonate (sol majeur, op. 3 1 ), marquée du même numéro
d’œuvre que les deux suivantes, est probablement la
plus faible des Sonates de Beethoven. On y reconnaît sa
physionomie, mais non son inspiration. Le second motif
est humain et non divin, et Beethoven nous a habitués au
divin. Toutefois le premier thème et la fin de l'exposition
(alternances majeures et mineures portent bien l’em-
preinte de sa personnalité. On pourrait croire Y Adagio
gra^ioso tiré d’un ballet, et représentant dans ses trilles
les pirouettes des ballerines sur la pointe des orteils. Cet
Adagio est un sacrifice fait à la mode, sacrifice peu digne
de Beethoven. Le Rondo, d'une valeur un peu supérieure,
a de la grâce. — Dix-septième Sonate [ré mineur, op. 3a ,
d’une inspiration toute beethovenienne. On ne conçoit pas
que deux Sonates d’une valeur aussi différente se trouvent
réunies sous le même numéro d’œuvre et sous la plume
du même auteur.
L’Adagio de cette So-
nate nous représente
bien, pour le coup, une
véritable rêverie de clair
de lune. Cette admi-
rable Sonate, de même
que celles quasi una
fantasia, en do diè^e
mineur, et l’op. 26, en
la majeur, est unique
dans son genre. — Dix-
huitième Sonate [mi
majeur, op. 31), pleine
d'humour et d’enjoue-
ment, dans le Finale
surtout. Le Menuet est
original ; son trio a
fourni à Saint-Saêns le
thème de ses Variations
pour deux pianos. — La
dix-neuvième Sonate,
en sol mineur, et la
vingtième, en sol ma-
jeur, op. 49, connues
sous le nom de Leichte
Sonaten (Sonates faci-
les), furent écrites par
suite des reproches faits
à Beethoven de com-
poser de la musique
trop difficile pour les
dilettante. La première
est toute mélodique. Le
motif principal du
Rondo représente, en
seize mesures, tout un
arioso. Dans la se-
conde, le Menuet est
identique à celui du Septuor pour instruments à vent et à
cordes. — La Sonate vingt-et-unième [do majeur, op. 53) est
plus importante.—-La vingt-deuxième, en famajeur, op. 5q,
et la vingt-troisième, en fa mineur, op. 57, Appassionata,
passèrent sans commentaires. — La vingt-quatrième [fa
diè\e majeur, op. 78), se distingue par l’humour et le laco-
nisme. Liszt disait de cette Sonate qu’on y reconnaît
« l’avarice d'un richard ». — La vingt-cinquième [sol ma-
jeur, op. 79) présente le même caractère humoresque
et concis. Le thème du Finale rappelle d’une manière
frappante la chanson autrefois bien populaire chez nous :
Vanka et Tanka, seulement plus ornementée. Ces deux
Sonates ne sont que des badinages. — La vingt-sixième
[mi bémol majeur, op. 81) est la première Sonate à pro-
gramme : les Adieux, l'Absence, le Retour. Les mots Lebe
molli (adieu' sont l’épigraphe de la dernière partie. « Cette
La Musique tragique.
Bas-relief du monument de Beethoven, à Bonn.