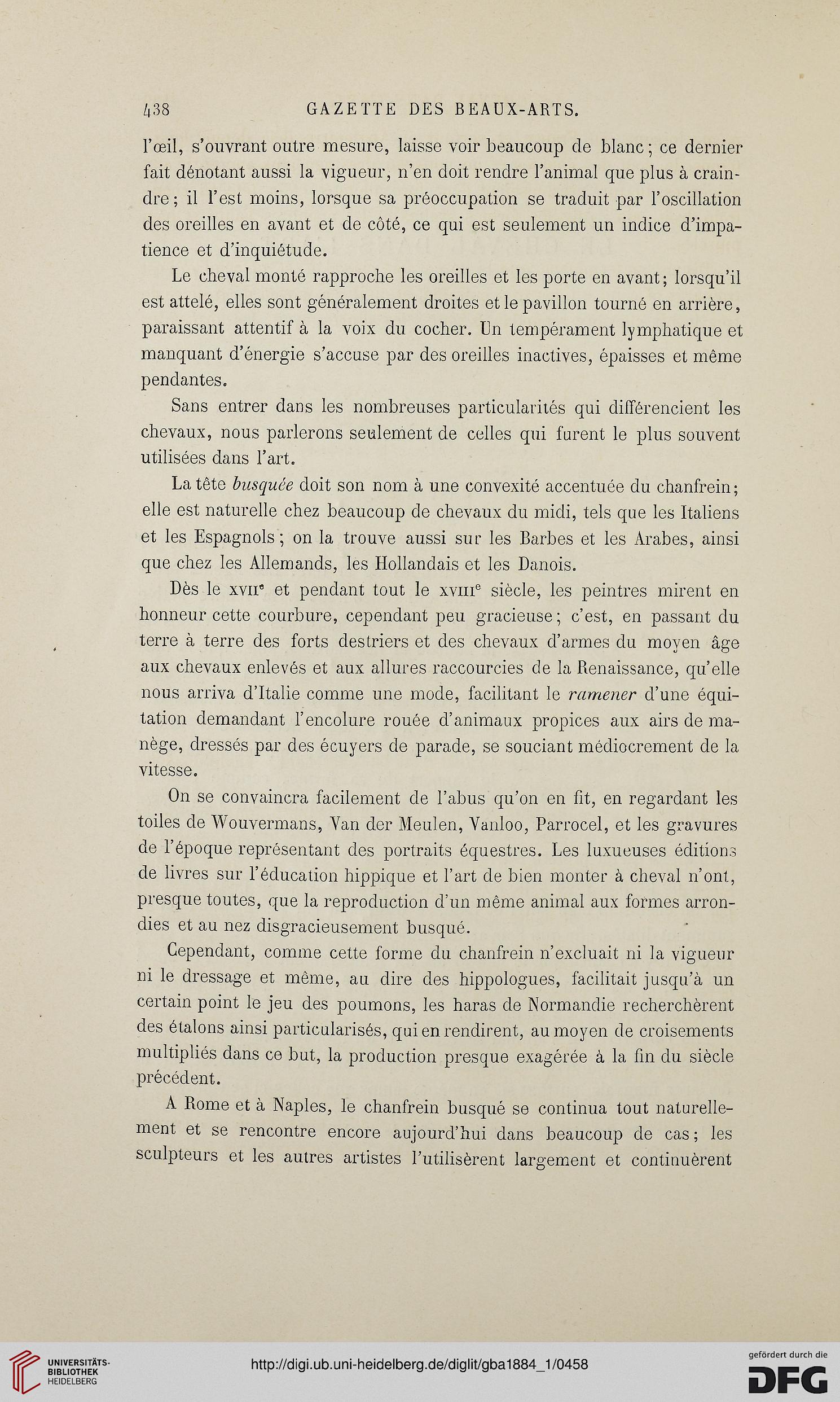GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
438
l’œil, s’ouvrant outre mesure, laisse voir beaucoup de blanc; ce dernier
fait dénotant aussi la vigueur, n’en doit rendre l’animal que plus à crain-
dre; il l’est moins, lorsque sa préoccupation se traduit par l’oscillation
des oreilles en avant et de côté, ce qui est seulement un indice d’impa-
tience et d’inquiétude.
Le cheval monté rapproche les oreilles et les porte en avant ; lorsqu’il
est attelé, elles sont généralement droites et le pavillon tourné en arrière,
paraissant attentif à la voix du cocher. Un tempérament lymphatique et
manquant d’énergie s’accuse par des oreilles inactives, épaisses et même
pendantes.
Sans entrer dans les nombreuses particularités qui différencient les
chevaux, nous parlerons seulement de celles qui furent le plus souvent
utilisées dans l’art.
La tête busquée doit son nom à une convexité accentuée du chanfrein;
elle est naturelle chez beaucoup de chevaux du midi, tels que les Italiens
et les Espagnols; on la trouve aussi sur les Barbes et les Arabes, ainsi
que chez les Allemands, les Hollandais et les Danois.
Dès le xvii® et pendant tout le xviii® siècle, les peintres mirent en
honneur cette courbure, cependant peu gracieuse; c’est, en passant du
terre à terre des forts destriers et des chevaux d’armes du moyen âge
aux chevaux enlevés et aux allures raccourcies de la Renaissance, qu’elle
nous arriva d’Italie comme une mode, facilitant le ramener d’une équi-
tation demandant l’encolure rouée d’animaux propices aux airs de ma-
nège, dressés par des écuyers de parade, se souciant médiocrement de la
vitesse.
On se convaincra facilement de l’abus qu’on en fit, en regardant les
toiles de Wouvermans, Yan der Meulen, Vanloo, Parrocel, et les gravures
de l’époque représentant des portraits équestres. Les luxueuses éditions
de livres sur l’éducation hippique et l’art de bien monter à cheval n’ont,
presque toutes, que la reproduction d’un même animal aux formes arron-
dies et au nez disgracieusement busqué.
Cependant, comme cette forme du chanfrein n’excluait ni la vigueur
ni le dressage et même, au dire des hippologues, facilitait jusqu’à un
certain point le jeu des poumons, les haras de Normandie recherchèrent
des étalons ainsi particularisés, qui en rendirent, au moyen de croisements
multipliés dans ce but, la production presque exagérée à la fin du siècle
précédent.
A Rome et à Naples, le chanfrein busqué se continua tout naturelle-
ment et se rencontre encore aujourd’hui dans beaucoup de cas ; les
sculpteurs et les autres artistes l’utilisèrent largement et continuèrent
438
l’œil, s’ouvrant outre mesure, laisse voir beaucoup de blanc; ce dernier
fait dénotant aussi la vigueur, n’en doit rendre l’animal que plus à crain-
dre; il l’est moins, lorsque sa préoccupation se traduit par l’oscillation
des oreilles en avant et de côté, ce qui est seulement un indice d’impa-
tience et d’inquiétude.
Le cheval monté rapproche les oreilles et les porte en avant ; lorsqu’il
est attelé, elles sont généralement droites et le pavillon tourné en arrière,
paraissant attentif à la voix du cocher. Un tempérament lymphatique et
manquant d’énergie s’accuse par des oreilles inactives, épaisses et même
pendantes.
Sans entrer dans les nombreuses particularités qui différencient les
chevaux, nous parlerons seulement de celles qui furent le plus souvent
utilisées dans l’art.
La tête busquée doit son nom à une convexité accentuée du chanfrein;
elle est naturelle chez beaucoup de chevaux du midi, tels que les Italiens
et les Espagnols; on la trouve aussi sur les Barbes et les Arabes, ainsi
que chez les Allemands, les Hollandais et les Danois.
Dès le xvii® et pendant tout le xviii® siècle, les peintres mirent en
honneur cette courbure, cependant peu gracieuse; c’est, en passant du
terre à terre des forts destriers et des chevaux d’armes du moyen âge
aux chevaux enlevés et aux allures raccourcies de la Renaissance, qu’elle
nous arriva d’Italie comme une mode, facilitant le ramener d’une équi-
tation demandant l’encolure rouée d’animaux propices aux airs de ma-
nège, dressés par des écuyers de parade, se souciant médiocrement de la
vitesse.
On se convaincra facilement de l’abus qu’on en fit, en regardant les
toiles de Wouvermans, Yan der Meulen, Vanloo, Parrocel, et les gravures
de l’époque représentant des portraits équestres. Les luxueuses éditions
de livres sur l’éducation hippique et l’art de bien monter à cheval n’ont,
presque toutes, que la reproduction d’un même animal aux formes arron-
dies et au nez disgracieusement busqué.
Cependant, comme cette forme du chanfrein n’excluait ni la vigueur
ni le dressage et même, au dire des hippologues, facilitait jusqu’à un
certain point le jeu des poumons, les haras de Normandie recherchèrent
des étalons ainsi particularisés, qui en rendirent, au moyen de croisements
multipliés dans ce but, la production presque exagérée à la fin du siècle
précédent.
A Rome et à Naples, le chanfrein busqué se continua tout naturelle-
ment et se rencontre encore aujourd’hui dans beaucoup de cas ; les
sculpteurs et les autres artistes l’utilisèrent largement et continuèrent