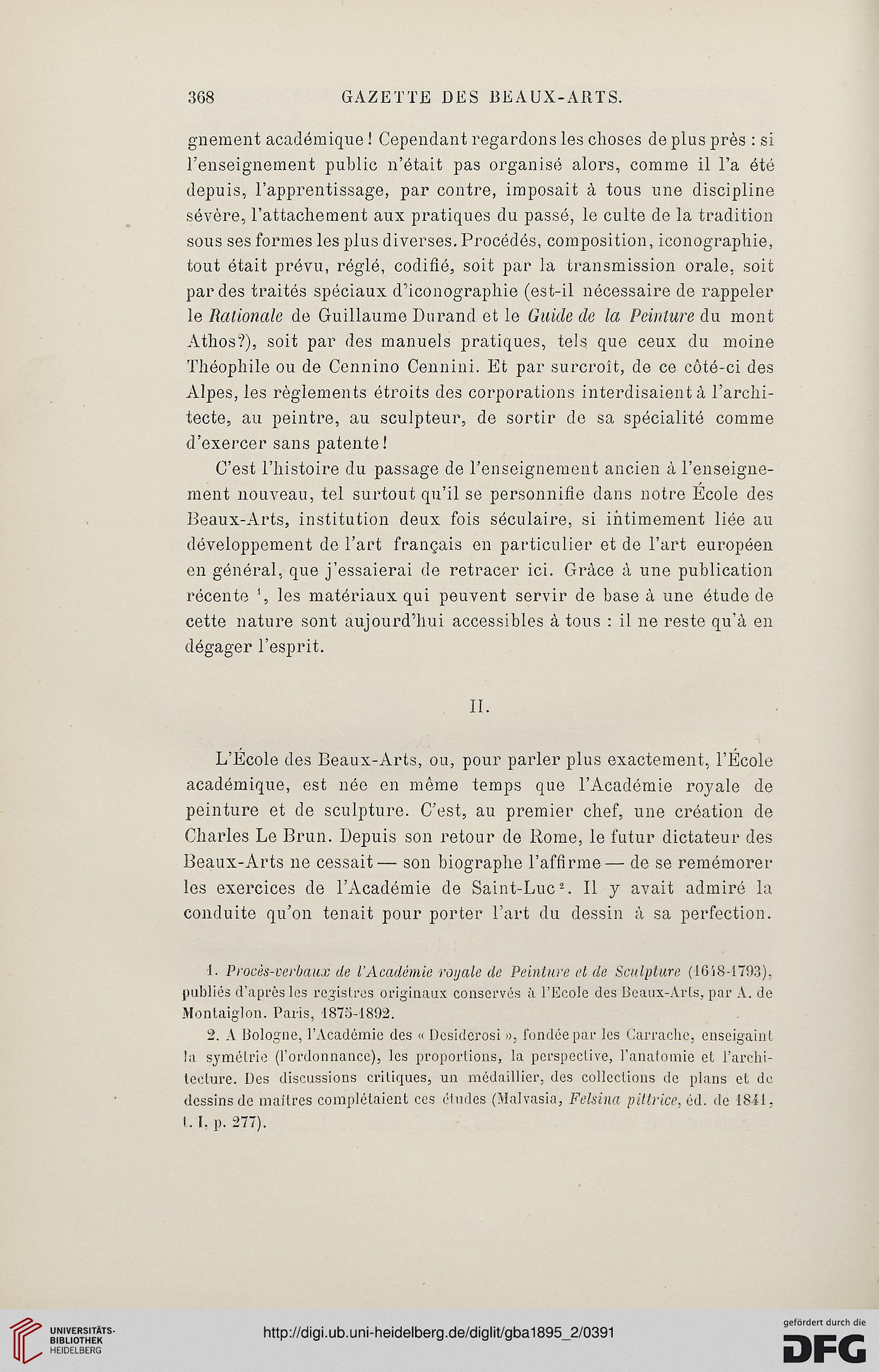368
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
gnement académique ! Cependant regardons les choses de plus près : si
l’enseignement public n’était pas organisé alors, comme il l’a été
depuis, l’apprentissage, par contre, imposait à tous une discipline
sévère, l’attachement aux pratiques du passé, le culte de la tradition
sous ses formes les plus diverses. Procédés, composition, iconographie,
tout était prévu, réglé, codifié, soit par la transmission orale, soit
par des traités spéciaux d’iconographie (est-il nécessaire de rappeler
le Rationale de Guillaume Durand et le Guide de la Peinture du mont
Athos?), soit par des manuels pratiques, tels que ceux du moine
Théophile ou de Cennino Cennini. Et par surcroît, de ce côté-ci des
Alpes, les règlements étroits des corporations interdisaient à l’archi-
tecte, au peintre, au sculpteur, de sortir de sa spécialité comme
d’exercer sans patente!
C’est l’histoire du passage de l’enseignement ancien à l’enseigne-
ment nouveau, tel surtout qu’il se personnifie dans notre École des
Beaux-Arts, institution deux fois séculaire, si intimement liée au
développement de l’art français en particulier et de l’art européen
en général, que j’essaierai de retracer ici. Grâce à une publication
récente ', les matériaux qui peuvent servir de base à une étude de
cette nature sont aujourd’hui accessibles à tous : il ne reste qu’à en
dégager l’esprit.
II.
L’École des Beaux-Arts, ou, pour parler plus exactement, l’École
académique, est née en même temps que l’Académie royale de
peinture et de sculpture. C’est, au premier chef, une création de
Charles Le Brun. Depuis son retour de Rome, le futur dictateur des
Beaux-Arts ne cessait— son biographe l’affirme— de se remémorer
les exercices de l’Académie de Saint-Luc1 2. Il y avait admiré la
conduite qu’on tenait pour porter l’art du dessin à sa perfection.
1. Procès-verbaux de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture (1618-179.3),
publiés d’après les registres originaux conservés à l’Ecole des Beaux-Arts, par A. de
Montaiglon. Paris, 1873-1892.
2. A Bologne, l’Académie des « Desiderosi », fondée par les Carrache, enseigaint
la symétrie (l’ordonnance), les proportions, la perspective, l’anatomie et l’archi-
tecture. Des discussions critiques, un médaillier, des collections de plans et de
dessins de maîtres complétaient ces études (Malvasia, Felsina pittrice, éd. de 1811,
t. I. p. 277).
GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
gnement académique ! Cependant regardons les choses de plus près : si
l’enseignement public n’était pas organisé alors, comme il l’a été
depuis, l’apprentissage, par contre, imposait à tous une discipline
sévère, l’attachement aux pratiques du passé, le culte de la tradition
sous ses formes les plus diverses. Procédés, composition, iconographie,
tout était prévu, réglé, codifié, soit par la transmission orale, soit
par des traités spéciaux d’iconographie (est-il nécessaire de rappeler
le Rationale de Guillaume Durand et le Guide de la Peinture du mont
Athos?), soit par des manuels pratiques, tels que ceux du moine
Théophile ou de Cennino Cennini. Et par surcroît, de ce côté-ci des
Alpes, les règlements étroits des corporations interdisaient à l’archi-
tecte, au peintre, au sculpteur, de sortir de sa spécialité comme
d’exercer sans patente!
C’est l’histoire du passage de l’enseignement ancien à l’enseigne-
ment nouveau, tel surtout qu’il se personnifie dans notre École des
Beaux-Arts, institution deux fois séculaire, si intimement liée au
développement de l’art français en particulier et de l’art européen
en général, que j’essaierai de retracer ici. Grâce à une publication
récente ', les matériaux qui peuvent servir de base à une étude de
cette nature sont aujourd’hui accessibles à tous : il ne reste qu’à en
dégager l’esprit.
II.
L’École des Beaux-Arts, ou, pour parler plus exactement, l’École
académique, est née en même temps que l’Académie royale de
peinture et de sculpture. C’est, au premier chef, une création de
Charles Le Brun. Depuis son retour de Rome, le futur dictateur des
Beaux-Arts ne cessait— son biographe l’affirme— de se remémorer
les exercices de l’Académie de Saint-Luc1 2. Il y avait admiré la
conduite qu’on tenait pour porter l’art du dessin à sa perfection.
1. Procès-verbaux de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture (1618-179.3),
publiés d’après les registres originaux conservés à l’Ecole des Beaux-Arts, par A. de
Montaiglon. Paris, 1873-1892.
2. A Bologne, l’Académie des « Desiderosi », fondée par les Carrache, enseigaint
la symétrie (l’ordonnance), les proportions, la perspective, l’anatomie et l’archi-
tecture. Des discussions critiques, un médaillier, des collections de plans et de
dessins de maîtres complétaient ces études (Malvasia, Felsina pittrice, éd. de 1811,
t. I. p. 277).