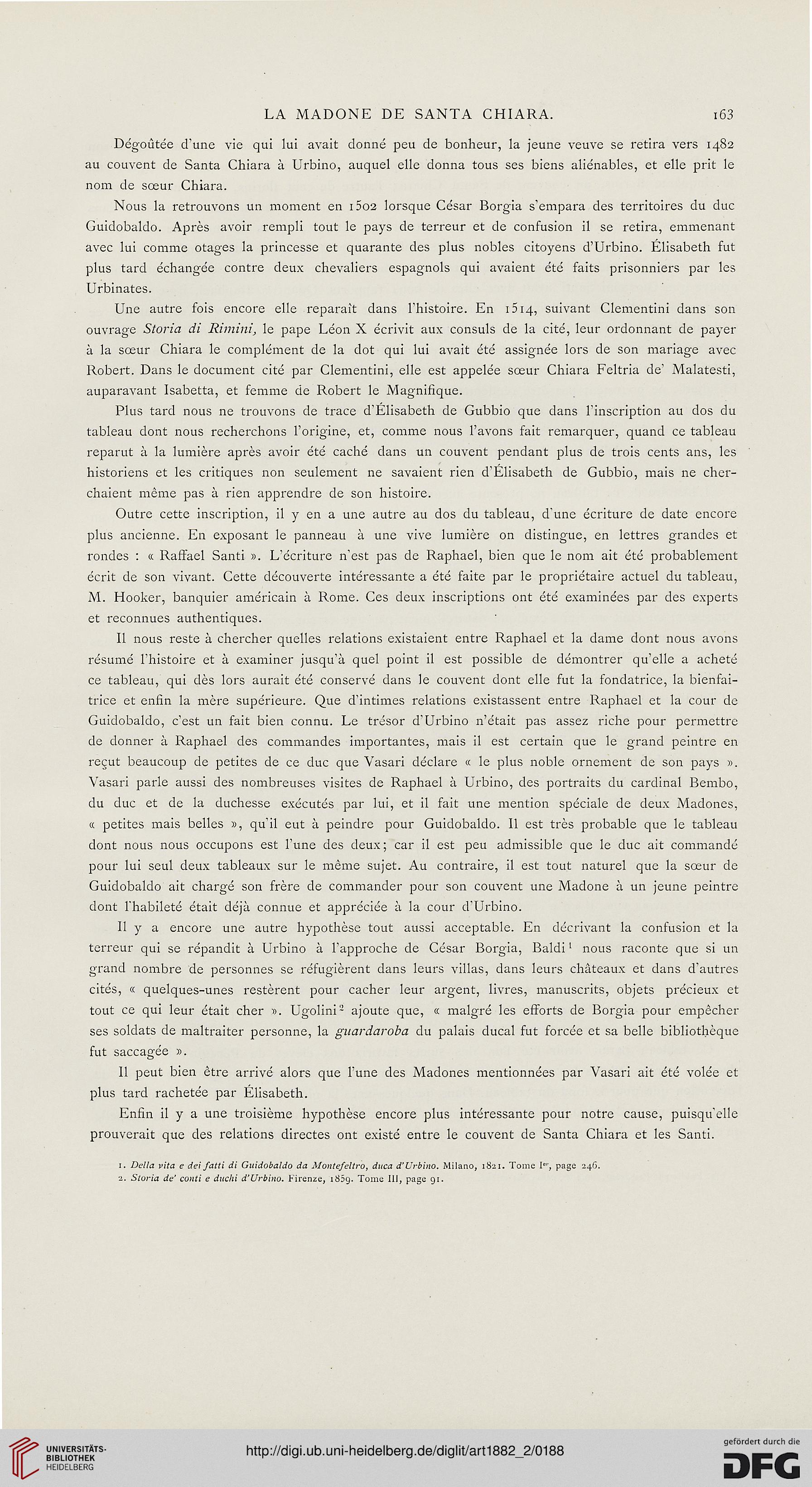LA MADONE DE SANTA CHIARA.
i63
Dégoûtée d'une vie qui lui avait donné peu de bonheur, la jeune veuve se retira vers 1482
au couvent de Santa Chiara à Urbino, auquel elle donna tous ses biens aliénables, et elle prit le
nom de sœur Chiara.
Nous la retrouvons un moment en i5o2 lorsque César Borgia s empara des territoires du duc
Guidobaldo. Après avoir rempli tout le pays de terreur et de confusion il se retira, emmenant
avec lui comme otages la princesse et quarante des plus nobles citoyens d'Urbino. Elisabeth fut
plus tard échangée contre deux chevaliers espagnols qui avaient été faits prisonniers par les
Urbinates.
Une autre fois encore elle reparaît dans l'histoire. En 1514, suivant Clementini clans son
ouvrage Storia di Rimini, le pape Léon X écrivit aux consuls de la cité, leur ordonnant de payer
à la sœur Chiara le complément de la dot qui lui avait été assignée lors de son mariage avec
Robert. Dans le document cité par Clementini, elle est appelée sœur Chiara Feltria de' Malatesti,
auparavant Isabetta, et femme de Robert le Magnifique.
Plus tard nous ne trouvons de trace d'Elisabeth de Gubbio que dans l'inscription au dos du
tableau dont nous recherchons l'origine, et, comme nous l'avons fait remarquer, quand ce tableau
reparut à la lumière après avoir été caché dans un couvent pendant plus de trois cents ans, les
historiens et les critiques non seulement ne savaient rien d'Elisabeth de Gubbio, mais ne cher-
chaient même pas à rien apprendre de son histoire.
Outre cette inscription, il y en a une autre au dos du tableau, d'une écriture de date encore
plus ancienne. En exposant le panneau à une vive lumière on distingue, en lettres grandes et
rondes : « Raffael Santi ». L'écriture n'est pas de Raphaël, bien que le nom ait été probablement
écrit de son vivant. Cette découverte intéressante a été faite par le propriétaire actuel du tableau,
M. Hooker, banquier américain à Rome. Ces deux inscriptions ont été examinées par des experts
et reconnues authentiques.
Il nous reste à chercher quelles relations existaient entre Raphaël et la dame dont nous avons
résumé l'histoire et à examiner jusqu'à quel point il est possible de démontrer qu'elle a acheté
ce tableau, qui dès lors aurait été conservé dans le couvent dont elle fut la fondatrice, la bienfai-
trice et enfin la mère supérieure. Que d'intimes relations existassent entre Raphaël et la cour de
Guidobaldo, c'est un fait bien connu. Le trésor d'Urbino n'était pas assez riche pour permettre
de donner à Raphaël des commandes importantes, mais il est certain que le grand peintre en
reçut beaucoup de petites de ce duc que Vasari déclare « le plus noble ornement de son pays ».
Vasari parle aussi des nombreuses visites de Raphaël à Urbino, des portraits du cardinal Bembo,
du duc et de la duchesse exécutés par lui, et il fait une mention spéciale de deux Madones,
a petites mais belles », qu'il eut à peindre pour Guidobaldo. 11 est très probable que le tableau
dont nous nous occupons est l'une des deux ; car il est peu admissible que le duc ait commandé
pour lui seul deux tableaux sur le même sujet. Au contraire, il est tout naturel que la sœur de
Guidobaldo ait chargé son frère de commander pour son couvent une Madone à un jeune peintre
dont l'habileté était déjà connue et appréciée à la cour d'Urbino.
Il y a encore une autre hypothèse tout aussi acceptable. En décrivant la confusion et la
terreur qui se répandit à Urbino à l'approche de César Borgia, Baldi1 nous raconte que si un
grand nombre de personnes se réfugièrent dans leurs villas, dans leurs châteaux et dans d'autres
cités, « quelques-unes restèrent pour cacher leur argent, livres, manuscrits, objets précieux et
tout ce qui leur était cher ». Ugolini- ajoute que, « malgré les efforts de Borgia pour empêcher
ses soldats de maltraiter personne, la guardaroba du palais ducal fut forcée et sa belle bibliothèque
fut saccagée ».
11 peut bien être arrivé alors que l'une des Madones mentionnées par Vasari ait été volée et
plus tard rachetée par Elisabeth.
Enfin il y a une troisième hypothèse encore plus intéressante pour notre cause, puisqu'elle
prouverait que des relations directes ont existé entre le couvent de Santa Chiara et les Santi.
1. Dclla vita e dei fatti di Guidobaldo da Montefeltro, duca d'Urbino. Milano, 1821. Tome Ie'', page 246.
2. Storia de' conti e duchi d'Urbino. Firenze, 1859. Tome III, page 91.
i63
Dégoûtée d'une vie qui lui avait donné peu de bonheur, la jeune veuve se retira vers 1482
au couvent de Santa Chiara à Urbino, auquel elle donna tous ses biens aliénables, et elle prit le
nom de sœur Chiara.
Nous la retrouvons un moment en i5o2 lorsque César Borgia s empara des territoires du duc
Guidobaldo. Après avoir rempli tout le pays de terreur et de confusion il se retira, emmenant
avec lui comme otages la princesse et quarante des plus nobles citoyens d'Urbino. Elisabeth fut
plus tard échangée contre deux chevaliers espagnols qui avaient été faits prisonniers par les
Urbinates.
Une autre fois encore elle reparaît dans l'histoire. En 1514, suivant Clementini clans son
ouvrage Storia di Rimini, le pape Léon X écrivit aux consuls de la cité, leur ordonnant de payer
à la sœur Chiara le complément de la dot qui lui avait été assignée lors de son mariage avec
Robert. Dans le document cité par Clementini, elle est appelée sœur Chiara Feltria de' Malatesti,
auparavant Isabetta, et femme de Robert le Magnifique.
Plus tard nous ne trouvons de trace d'Elisabeth de Gubbio que dans l'inscription au dos du
tableau dont nous recherchons l'origine, et, comme nous l'avons fait remarquer, quand ce tableau
reparut à la lumière après avoir été caché dans un couvent pendant plus de trois cents ans, les
historiens et les critiques non seulement ne savaient rien d'Elisabeth de Gubbio, mais ne cher-
chaient même pas à rien apprendre de son histoire.
Outre cette inscription, il y en a une autre au dos du tableau, d'une écriture de date encore
plus ancienne. En exposant le panneau à une vive lumière on distingue, en lettres grandes et
rondes : « Raffael Santi ». L'écriture n'est pas de Raphaël, bien que le nom ait été probablement
écrit de son vivant. Cette découverte intéressante a été faite par le propriétaire actuel du tableau,
M. Hooker, banquier américain à Rome. Ces deux inscriptions ont été examinées par des experts
et reconnues authentiques.
Il nous reste à chercher quelles relations existaient entre Raphaël et la dame dont nous avons
résumé l'histoire et à examiner jusqu'à quel point il est possible de démontrer qu'elle a acheté
ce tableau, qui dès lors aurait été conservé dans le couvent dont elle fut la fondatrice, la bienfai-
trice et enfin la mère supérieure. Que d'intimes relations existassent entre Raphaël et la cour de
Guidobaldo, c'est un fait bien connu. Le trésor d'Urbino n'était pas assez riche pour permettre
de donner à Raphaël des commandes importantes, mais il est certain que le grand peintre en
reçut beaucoup de petites de ce duc que Vasari déclare « le plus noble ornement de son pays ».
Vasari parle aussi des nombreuses visites de Raphaël à Urbino, des portraits du cardinal Bembo,
du duc et de la duchesse exécutés par lui, et il fait une mention spéciale de deux Madones,
a petites mais belles », qu'il eut à peindre pour Guidobaldo. 11 est très probable que le tableau
dont nous nous occupons est l'une des deux ; car il est peu admissible que le duc ait commandé
pour lui seul deux tableaux sur le même sujet. Au contraire, il est tout naturel que la sœur de
Guidobaldo ait chargé son frère de commander pour son couvent une Madone à un jeune peintre
dont l'habileté était déjà connue et appréciée à la cour d'Urbino.
Il y a encore une autre hypothèse tout aussi acceptable. En décrivant la confusion et la
terreur qui se répandit à Urbino à l'approche de César Borgia, Baldi1 nous raconte que si un
grand nombre de personnes se réfugièrent dans leurs villas, dans leurs châteaux et dans d'autres
cités, « quelques-unes restèrent pour cacher leur argent, livres, manuscrits, objets précieux et
tout ce qui leur était cher ». Ugolini- ajoute que, « malgré les efforts de Borgia pour empêcher
ses soldats de maltraiter personne, la guardaroba du palais ducal fut forcée et sa belle bibliothèque
fut saccagée ».
11 peut bien être arrivé alors que l'une des Madones mentionnées par Vasari ait été volée et
plus tard rachetée par Elisabeth.
Enfin il y a une troisième hypothèse encore plus intéressante pour notre cause, puisqu'elle
prouverait que des relations directes ont existé entre le couvent de Santa Chiara et les Santi.
1. Dclla vita e dei fatti di Guidobaldo da Montefeltro, duca d'Urbino. Milano, 1821. Tome Ie'', page 246.
2. Storia de' conti e duchi d'Urbino. Firenze, 1859. Tome III, page 91.