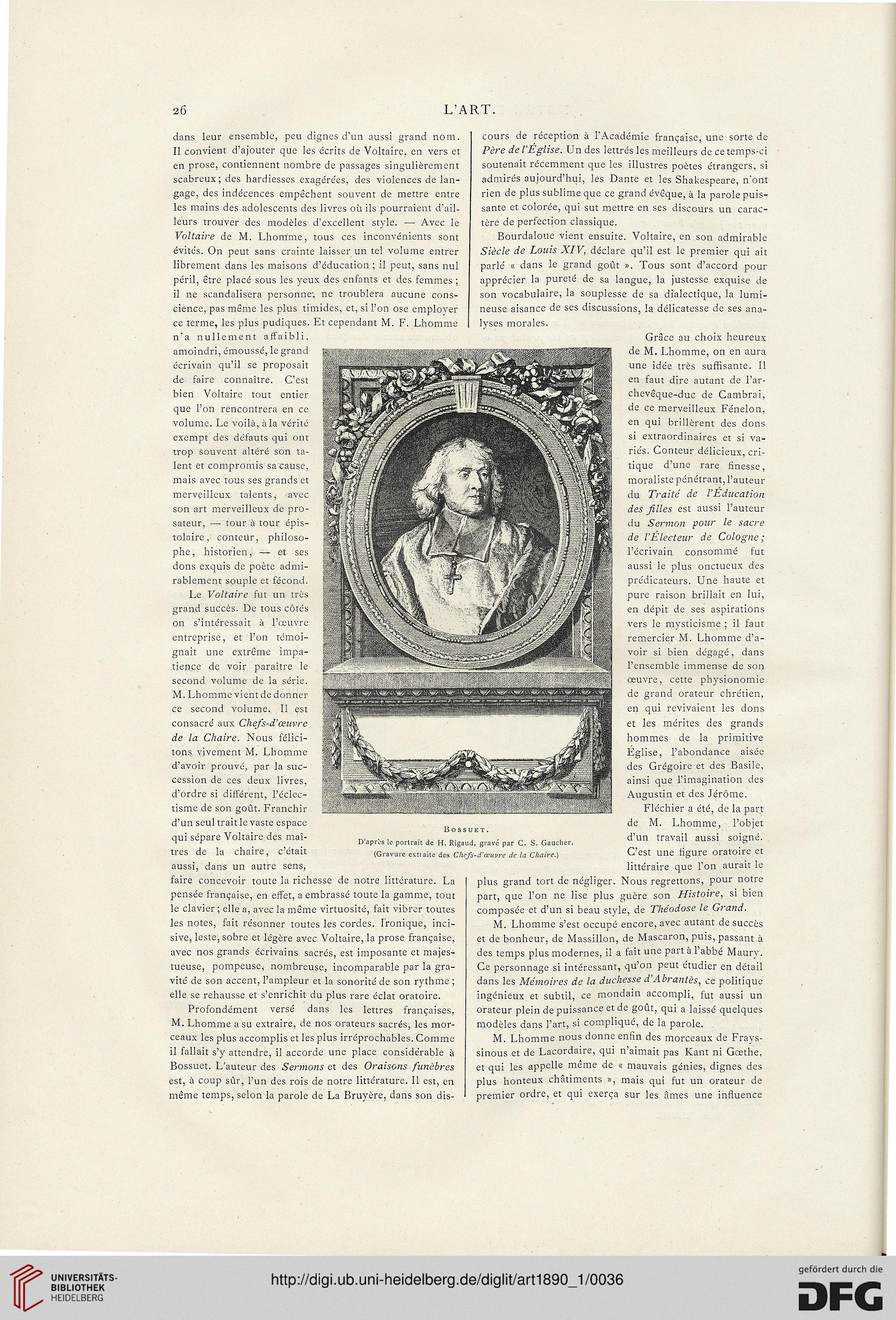26
L’ART.
dans leur ensemble, peu dignes d’un aussi grand nom.
Il convient d’ajouter que les écrits de Voltaire, en vers et
en prose, contiennent nombre de passages singulièrement
scabreux; des hardiesses exagérées, des violences de lan-
gage, des indécences empêchent souvent de mettre entre
les mains des adolescents des livres où ils pourraient d’ail-
leurs trouver des modèles d’excellent style. — Avec le
Voltaire de M. Lhomme, tous ces inconvénients sont
évités. On peut sans crainte laisser un tel volume entrer
librement dans les maisons d’éducation ; il peut, sans nul
péril, être placé sous les yeux des enfants et des femmes ;
il ne scandalisera personne-, ne troublera aucune cons-
cience, pas même les plus timides, et, si l’on ose employer
ce terme, les plus pudiques. Et cependant M. F. Lhomme
n’a nullement affaibli,
amoindri, émoussé, le grand
écrivain qu’il se proposait
de faire connaître. C’est
bien Voltaire tout entier
que l’on rencontrera en ce
volume. Le voilà, à la vérité
exempt des défauts qui ont
trop souvent altéré son ta-
lent et compromis sa cause,
mais avec tous ses grands et
merveilleux talents* avec
son art merveilleux de pro-
sateur, — tour à tour épis-
tolaire, conteur, philoso-
phe, historien, — et ses
dons exquis de poète admi-
rablement souple et fécond.
Le Voltaire fut un très
grand succès. De tous côtés
on s’intéressait à l’oeuvre
entreprise, et l’on témoi-
gnait une extrême impa-
tience de voir paraître le
second volume de la série.
M. Lhomme vient de donner
ce second volume. Il est
consacré aux Chefs-d’œuvre
de la Chaire. Nous félici-
tons vivement M. Lhomnie
d’avoir prouvé, par la suc-
cession de ces deux livres,
d’ordre si différent, l’éclec-
tisme de son goût. Franchir
d’un seul trait le vaste espace
qui sépare Voltaire des maî-
tres de la chaire, c’était
aussi, dans un autre sens,
faire concevoir toute la richesse de notre littérature. La
pensée française, en effet, a embrassé toute la gamme, tout
le clavier ; elle a, avec la même virtuosité, fait vibrer toutes
les notes, fait résonner toutes les cordes. Ironique, inci-
sive, leste, sobre et légère avec Voltaire, la prose française,
avec nos grands écrivains sacrés, est imposante et majes-
tueuse, pompeuse, nombreuse, incomparable par la gra-
vité de son accent, l’ampleur et la sonorité de son rythme ;
elle se rehausse et s’enrichit du plus rare éclat oratoire.
Profondément versé dans les lettres françaises,
M. Lhomme a su extraire, de nos orateurs sacrés, les mor-
ceaux les plus accomplis et les plus irréprochables. Comme
il fallait s’y attendre, il accorde une place considérable à
Bossuet. L’auteur des Sermons et des Oraisons funèbres
est, à coup sûr, l’un des rois de notre littérature. 11 est, en
même temps, selon la parole de La Bruyère, dans son dis-
cours de réception à l’Académie française, une sorte de
Père de l’Eglise. Un des lettrés les meilleurs de ce temps-ci
soutenait récemment que les illustres poètes étrangers, si
admirés aujourd’hui, les Dante et les Shakespeare, n’ônt
rien de plus sublime que ce grand évêque, à la parole puis-
sante et colorée, qui sut mettre en ses discours un carac-
tère de perfection classique.
Bourdaloue vient ensuite. Voltaire, en son admirable
Siècle de Louis XIV, déclare qu’il est le premier qui ait
parlé « dans le grand goût ». Tous sont d’accord pour
apprécier la pureté de sa langue, la justesse exquise de
son vocabulaire, la souplesse de sa dialectique, la lumi-
neuse aisance de ses discussions, la délicatesse de ses ana-
lyses morales.
Grâce au choix heureux
de M. Lhomme, on en aura
une idée très suffisante. Il
en faut dire autant de l’ar-
chevêque-duc de Cambrai,
de ce merveilleux Fénelon,
en qui brillèrent des dons
si extraordinaires et si va-
riés. Conteur délicieux, cri-
tique d’une rare finesse,
moraliste pénétrant, l’auteur
du Traité de l’Éducation
des filles est aussi l’auteur
du Sermon pour le sacre
de l’Électeur de Cologne;
l’écrivain consommé fut
aussi le plus onctueux des
prédicateurs. Une haute et
pure raison brillait en lui,
en dépit de ses aspirations
vers le mysticisme ; il faut
remercier M. Lhomme d’a-
voir si bien dégagé, dans
l’ensemble immense de son
œuvre, cette physionomie
de grand orateur chrétien,
en qui revivaient les dons
et les mérites des grands
hommes de la primitive
Eglise, l’abondance aisée
des Grégoire et des Basile,
ainsi que l’imagination des
Augustin et des Jérôme.
Fléchier a été, de la part
de M. Lhomme, l’objet
d’un travail aussi soigné.
C’est une figure oratoire et
littéraire que l’on aurait le
plus grand tort de négliger. Nous regrettons, pour notre
part, que l’on ne lise plus guère son Histoire, si bien
composée et d’un si beau style, de Théodose le Grand.
M. Lhomme s’est occupé encore, avec autant de succès
et de bonheur, de Massillon, de Mascaron, puis, passant à
des temps plus modernes, il a fait une part à l’abbé Maury.
Ce personnage si intéressant, qu’on peut étudier en détail
dans les Mémoires de la duchesse d’Abrantès, ce politique
ingénieux et subtil, ce mondain accompli, fut aussi un
orateur plein de puissance et de goût, qui a laissé quelques
modèles dans l’art, si compliqué, de la parole.
M. Lhomme nous donne enfin des morceaux de Frays-
sinous et de Lacordaire, qui n’aimait pas Kant ni Gœthe,
et qui les appelle même de « mauvais génies, dignes des
plus honteux châtiments », mais qui fut un orateur de
premier ordre, et qui exerça sur les âmes une influence
Bossuet.
D’après le portrait de H. Rigaud, gravé par C. S. Gaucher.
(Gravure extiaite des Chefs-d’œuvre de la Chaire.)
L’ART.
dans leur ensemble, peu dignes d’un aussi grand nom.
Il convient d’ajouter que les écrits de Voltaire, en vers et
en prose, contiennent nombre de passages singulièrement
scabreux; des hardiesses exagérées, des violences de lan-
gage, des indécences empêchent souvent de mettre entre
les mains des adolescents des livres où ils pourraient d’ail-
leurs trouver des modèles d’excellent style. — Avec le
Voltaire de M. Lhomme, tous ces inconvénients sont
évités. On peut sans crainte laisser un tel volume entrer
librement dans les maisons d’éducation ; il peut, sans nul
péril, être placé sous les yeux des enfants et des femmes ;
il ne scandalisera personne-, ne troublera aucune cons-
cience, pas même les plus timides, et, si l’on ose employer
ce terme, les plus pudiques. Et cependant M. F. Lhomme
n’a nullement affaibli,
amoindri, émoussé, le grand
écrivain qu’il se proposait
de faire connaître. C’est
bien Voltaire tout entier
que l’on rencontrera en ce
volume. Le voilà, à la vérité
exempt des défauts qui ont
trop souvent altéré son ta-
lent et compromis sa cause,
mais avec tous ses grands et
merveilleux talents* avec
son art merveilleux de pro-
sateur, — tour à tour épis-
tolaire, conteur, philoso-
phe, historien, — et ses
dons exquis de poète admi-
rablement souple et fécond.
Le Voltaire fut un très
grand succès. De tous côtés
on s’intéressait à l’oeuvre
entreprise, et l’on témoi-
gnait une extrême impa-
tience de voir paraître le
second volume de la série.
M. Lhomme vient de donner
ce second volume. Il est
consacré aux Chefs-d’œuvre
de la Chaire. Nous félici-
tons vivement M. Lhomnie
d’avoir prouvé, par la suc-
cession de ces deux livres,
d’ordre si différent, l’éclec-
tisme de son goût. Franchir
d’un seul trait le vaste espace
qui sépare Voltaire des maî-
tres de la chaire, c’était
aussi, dans un autre sens,
faire concevoir toute la richesse de notre littérature. La
pensée française, en effet, a embrassé toute la gamme, tout
le clavier ; elle a, avec la même virtuosité, fait vibrer toutes
les notes, fait résonner toutes les cordes. Ironique, inci-
sive, leste, sobre et légère avec Voltaire, la prose française,
avec nos grands écrivains sacrés, est imposante et majes-
tueuse, pompeuse, nombreuse, incomparable par la gra-
vité de son accent, l’ampleur et la sonorité de son rythme ;
elle se rehausse et s’enrichit du plus rare éclat oratoire.
Profondément versé dans les lettres françaises,
M. Lhomme a su extraire, de nos orateurs sacrés, les mor-
ceaux les plus accomplis et les plus irréprochables. Comme
il fallait s’y attendre, il accorde une place considérable à
Bossuet. L’auteur des Sermons et des Oraisons funèbres
est, à coup sûr, l’un des rois de notre littérature. 11 est, en
même temps, selon la parole de La Bruyère, dans son dis-
cours de réception à l’Académie française, une sorte de
Père de l’Eglise. Un des lettrés les meilleurs de ce temps-ci
soutenait récemment que les illustres poètes étrangers, si
admirés aujourd’hui, les Dante et les Shakespeare, n’ônt
rien de plus sublime que ce grand évêque, à la parole puis-
sante et colorée, qui sut mettre en ses discours un carac-
tère de perfection classique.
Bourdaloue vient ensuite. Voltaire, en son admirable
Siècle de Louis XIV, déclare qu’il est le premier qui ait
parlé « dans le grand goût ». Tous sont d’accord pour
apprécier la pureté de sa langue, la justesse exquise de
son vocabulaire, la souplesse de sa dialectique, la lumi-
neuse aisance de ses discussions, la délicatesse de ses ana-
lyses morales.
Grâce au choix heureux
de M. Lhomme, on en aura
une idée très suffisante. Il
en faut dire autant de l’ar-
chevêque-duc de Cambrai,
de ce merveilleux Fénelon,
en qui brillèrent des dons
si extraordinaires et si va-
riés. Conteur délicieux, cri-
tique d’une rare finesse,
moraliste pénétrant, l’auteur
du Traité de l’Éducation
des filles est aussi l’auteur
du Sermon pour le sacre
de l’Électeur de Cologne;
l’écrivain consommé fut
aussi le plus onctueux des
prédicateurs. Une haute et
pure raison brillait en lui,
en dépit de ses aspirations
vers le mysticisme ; il faut
remercier M. Lhomme d’a-
voir si bien dégagé, dans
l’ensemble immense de son
œuvre, cette physionomie
de grand orateur chrétien,
en qui revivaient les dons
et les mérites des grands
hommes de la primitive
Eglise, l’abondance aisée
des Grégoire et des Basile,
ainsi que l’imagination des
Augustin et des Jérôme.
Fléchier a été, de la part
de M. Lhomme, l’objet
d’un travail aussi soigné.
C’est une figure oratoire et
littéraire que l’on aurait le
plus grand tort de négliger. Nous regrettons, pour notre
part, que l’on ne lise plus guère son Histoire, si bien
composée et d’un si beau style, de Théodose le Grand.
M. Lhomme s’est occupé encore, avec autant de succès
et de bonheur, de Massillon, de Mascaron, puis, passant à
des temps plus modernes, il a fait une part à l’abbé Maury.
Ce personnage si intéressant, qu’on peut étudier en détail
dans les Mémoires de la duchesse d’Abrantès, ce politique
ingénieux et subtil, ce mondain accompli, fut aussi un
orateur plein de puissance et de goût, qui a laissé quelques
modèles dans l’art, si compliqué, de la parole.
M. Lhomme nous donne enfin des morceaux de Frays-
sinous et de Lacordaire, qui n’aimait pas Kant ni Gœthe,
et qui les appelle même de « mauvais génies, dignes des
plus honteux châtiments », mais qui fut un orateur de
premier ordre, et qui exerça sur les âmes une influence
Bossuet.
D’après le portrait de H. Rigaud, gravé par C. S. Gaucher.
(Gravure extiaite des Chefs-d’œuvre de la Chaire.)