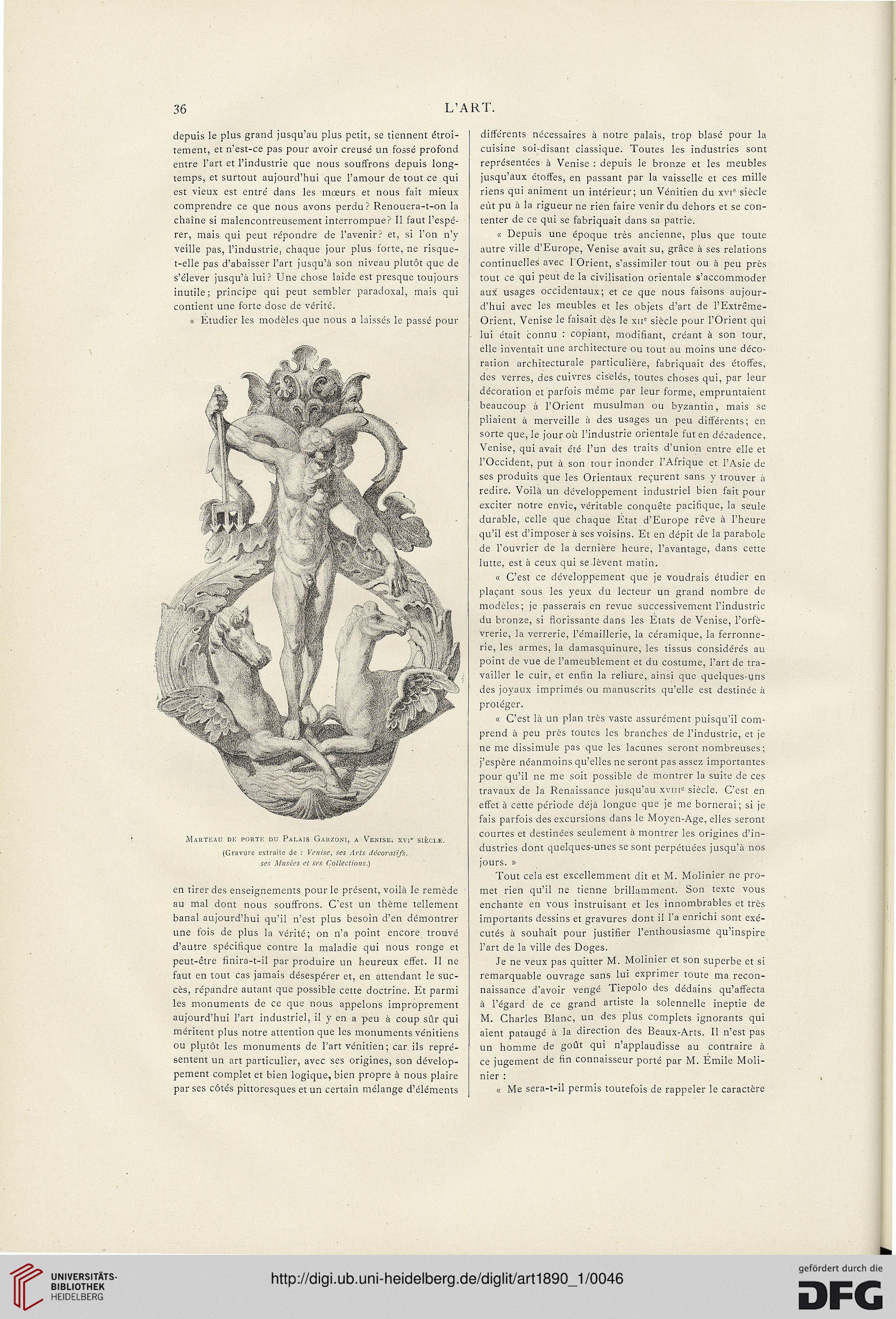36
L’ART.
depuis le plus grand jusqu’au plus petit, se tiennent étroi-
tement, et n’est-ce pas pour avoir creusé un fossé profond
entre l’art et l’industrie que nous souffrons depuis long- I
temps, et surtout aujourd’hui que l’amour de tout ce qui
est vieux est entré dans les moeurs et nous fait mieux
comprendre ce que nous avons perdu? Renouera-t-on la
chaîne si malencontreusement interrompue? Il faut l’espé-
rer, mais qui peut répondre de l’avenir? et, si l'on n’y
veille pas, l’industrie, chaque jour plus forte, ne risque-
t-elle pas d’abaisser l’art jusqu’à son niveau plutôt que de
s’élever jusqu’à lui? Une chose laide est presque toujours
inutile; principe qui peut sembler paradoxal, mais qui
contient une forte dose de vérité.
« Étudier les modèles que nous a laissés le passé pour
Marteau de porte du Palais Garzoni, a Venise» xvi° siècle.
(Gravure extraite de : Venise, ses Arts décoratifs,
ses Musées et ses Collections.)
en tirer des enseignements pour le présent, voilà le remède
au mal dont nous souffrons. C’est un thème tellement
banal aujourd’hui qu’il n’est plus besoin d’en démontrer
une fois de plus la vérité; on n’a point encore trouvé
d’autre spécifique contre la maladie qui nous ronge et
peut-être finira-t-il par produire un heureux effet. Il ne
faut en tout cas jamais désespérer et, en attendant le suc-
cès, répandre autant que possible cette doctrine. Et parmi
les monuments de ce que nous appelons improprement
aujourd’hui l’art industriel, il y en a peu à coup sûr qui
méritent plus notre attention que les monuments vénitiens
ou plutôt les monuments de l’art vénitien ; car ils repré-
sentent un art particulier, avec ses origines, son dévelop-
pement complet et bien logique, bien propre à nous plaire
par ses côtés pittoresques et un certain mélange d’éléments
différents nécessaires à notre palais, trop blasé pour la
cuisine soi-disant classique. Toutes les industries sont
représentées à Venise : depuis le bronze et les meubles
jusqu’aux étoffes, en passant par la vaisselle et ces mille
riens qui animent un intérieur; un Vénitien du xvie siècle
eût pu à la rigueur ne rien faire venir du dehors et se con-
tenter de ce qui se fabriquait dans sa patrie.
« Depuis une époque très ancienne, plus que toute
autre ville d’Europe, Venise avait su, grâce à ses relations
continuelles avec l'Orient, s’assimiler tout ou à peu près
tout ce qui peut de la civilisation orientale s’accommoder
aux usages occidentaux; et ce que nous faisons aujour-
d'hui avec les meubles et les objets d’art de l’Extrême-
Orient, Venise le faisait dès le xue siècle pour l’Orient qui
lui était connu : copiant, modifiant, créant à son tour,
elle inventait une architecture ou tout au moins une déco-
ration architecturale particulière, fabriquait des étoffes,
des verres, des cuivres ciselés, toutes choses qui, par leur
décoration et parfois même par leur forme, empruntaient
beaucoup à l’Orient musulman ou byzantin, mais se
pliaient à merveille à des usages un peu différents; en
sorte que, le jour où l’industrie orientale fut en décadence,
Venise, qui avait été l’un des traits d’union entre elle et
l’Occident, put à son tour inonder l’Afrique et l’Asie de
ses produits que les Orientaux reçurent sans y trouver à
redire. Voilà un développement industriel bien fait pour
exciter notre envie, véritable conquête pacifique, la seule
durable, celle que chaque Etat d’Europe rêve à l’heure
qu’il est d’imposer à ses voisins. Et en dépit de la parabole
de l’ouvrier de la dernière heure, l’avantage, dans cette
lutte, est à ceux qui se lèvent matin.
« C’est ce développement que je voudrais étudier en
plaçant sous les yeux du lecteur un grand nombre de
modèles; je passerais en revue successivement l’industrie
du bronze, si florissante dans les Etats de Venise, l’orfè-
vrerie, la verrerie, l’émaillerie, la céramique, la ferronne-
rie, les armes, la damasquinure, les tissus considérés au
point de vue de l’ameublement et du costume, l’art de tra-
vailler le cuir, et enfin la reliure,.ainsi que quelques-uns
des joyaux imprimés ou manuscrits qu’elle est destinée à
protéger.
« C’est là un plan très vaste assurément puisqu’il com-
prend à peu près toutes les branches de l’industrie, et je
ne me dissimule pas que les lacunes seront nombreuses;
j’espère néanmoins qu’elles ne seront pas assez importantes
pour qu’il ne me soit possible de montrer la suite de ces
travaux de la Renaissance jusqu’au xvnie siècle. C’est en
effet à cette période déjà longue que je me bornerai; si je
fais parfois des excursions dans le Moyen-Age, elles seront
courtes et destinées seulement à montrer les origines d’in-
dustries dont quelques-unes se sont perpétuées jusqu’à nos
jours. »
Tout cela est excellemment dit et M. Molinier ne pro-
met rien qu’il ne tienne brillamment. Son texte vous
enchante en vous instruisant et les innombrables et très
importants dessins et gravures dont il l'a enrichi sont exé-
cutés à souhait pour justifier l’enthousiasme qu’inspire
l’art de la ville des Doges.
Je ne veux pas quitter M. Molinier et son superbe et si
remarquable ouvrage sans lui exprimer toute ma recon-
naissance d’avoir vengé Tiepolo des dédains qu’affecta
à l’égard de ce grand artiste la solennelle ineptie de
M. Charles Blanc, un des plus complets ignorants qui
aient pataugé à la direction des Beaux-Arts. Il n’est pas
un homme de goût qui n’applaudisse au contraire à
ce jugement de fin connaisseur porté par M. Émile Moli-
nier :
« Me sera-t-il permis toutefois de rappeler le caractère
L’ART.
depuis le plus grand jusqu’au plus petit, se tiennent étroi-
tement, et n’est-ce pas pour avoir creusé un fossé profond
entre l’art et l’industrie que nous souffrons depuis long- I
temps, et surtout aujourd’hui que l’amour de tout ce qui
est vieux est entré dans les moeurs et nous fait mieux
comprendre ce que nous avons perdu? Renouera-t-on la
chaîne si malencontreusement interrompue? Il faut l’espé-
rer, mais qui peut répondre de l’avenir? et, si l'on n’y
veille pas, l’industrie, chaque jour plus forte, ne risque-
t-elle pas d’abaisser l’art jusqu’à son niveau plutôt que de
s’élever jusqu’à lui? Une chose laide est presque toujours
inutile; principe qui peut sembler paradoxal, mais qui
contient une forte dose de vérité.
« Étudier les modèles que nous a laissés le passé pour
Marteau de porte du Palais Garzoni, a Venise» xvi° siècle.
(Gravure extraite de : Venise, ses Arts décoratifs,
ses Musées et ses Collections.)
en tirer des enseignements pour le présent, voilà le remède
au mal dont nous souffrons. C’est un thème tellement
banal aujourd’hui qu’il n’est plus besoin d’en démontrer
une fois de plus la vérité; on n’a point encore trouvé
d’autre spécifique contre la maladie qui nous ronge et
peut-être finira-t-il par produire un heureux effet. Il ne
faut en tout cas jamais désespérer et, en attendant le suc-
cès, répandre autant que possible cette doctrine. Et parmi
les monuments de ce que nous appelons improprement
aujourd’hui l’art industriel, il y en a peu à coup sûr qui
méritent plus notre attention que les monuments vénitiens
ou plutôt les monuments de l’art vénitien ; car ils repré-
sentent un art particulier, avec ses origines, son dévelop-
pement complet et bien logique, bien propre à nous plaire
par ses côtés pittoresques et un certain mélange d’éléments
différents nécessaires à notre palais, trop blasé pour la
cuisine soi-disant classique. Toutes les industries sont
représentées à Venise : depuis le bronze et les meubles
jusqu’aux étoffes, en passant par la vaisselle et ces mille
riens qui animent un intérieur; un Vénitien du xvie siècle
eût pu à la rigueur ne rien faire venir du dehors et se con-
tenter de ce qui se fabriquait dans sa patrie.
« Depuis une époque très ancienne, plus que toute
autre ville d’Europe, Venise avait su, grâce à ses relations
continuelles avec l'Orient, s’assimiler tout ou à peu près
tout ce qui peut de la civilisation orientale s’accommoder
aux usages occidentaux; et ce que nous faisons aujour-
d'hui avec les meubles et les objets d’art de l’Extrême-
Orient, Venise le faisait dès le xue siècle pour l’Orient qui
lui était connu : copiant, modifiant, créant à son tour,
elle inventait une architecture ou tout au moins une déco-
ration architecturale particulière, fabriquait des étoffes,
des verres, des cuivres ciselés, toutes choses qui, par leur
décoration et parfois même par leur forme, empruntaient
beaucoup à l’Orient musulman ou byzantin, mais se
pliaient à merveille à des usages un peu différents; en
sorte que, le jour où l’industrie orientale fut en décadence,
Venise, qui avait été l’un des traits d’union entre elle et
l’Occident, put à son tour inonder l’Afrique et l’Asie de
ses produits que les Orientaux reçurent sans y trouver à
redire. Voilà un développement industriel bien fait pour
exciter notre envie, véritable conquête pacifique, la seule
durable, celle que chaque Etat d’Europe rêve à l’heure
qu’il est d’imposer à ses voisins. Et en dépit de la parabole
de l’ouvrier de la dernière heure, l’avantage, dans cette
lutte, est à ceux qui se lèvent matin.
« C’est ce développement que je voudrais étudier en
plaçant sous les yeux du lecteur un grand nombre de
modèles; je passerais en revue successivement l’industrie
du bronze, si florissante dans les Etats de Venise, l’orfè-
vrerie, la verrerie, l’émaillerie, la céramique, la ferronne-
rie, les armes, la damasquinure, les tissus considérés au
point de vue de l’ameublement et du costume, l’art de tra-
vailler le cuir, et enfin la reliure,.ainsi que quelques-uns
des joyaux imprimés ou manuscrits qu’elle est destinée à
protéger.
« C’est là un plan très vaste assurément puisqu’il com-
prend à peu près toutes les branches de l’industrie, et je
ne me dissimule pas que les lacunes seront nombreuses;
j’espère néanmoins qu’elles ne seront pas assez importantes
pour qu’il ne me soit possible de montrer la suite de ces
travaux de la Renaissance jusqu’au xvnie siècle. C’est en
effet à cette période déjà longue que je me bornerai; si je
fais parfois des excursions dans le Moyen-Age, elles seront
courtes et destinées seulement à montrer les origines d’in-
dustries dont quelques-unes se sont perpétuées jusqu’à nos
jours. »
Tout cela est excellemment dit et M. Molinier ne pro-
met rien qu’il ne tienne brillamment. Son texte vous
enchante en vous instruisant et les innombrables et très
importants dessins et gravures dont il l'a enrichi sont exé-
cutés à souhait pour justifier l’enthousiasme qu’inspire
l’art de la ville des Doges.
Je ne veux pas quitter M. Molinier et son superbe et si
remarquable ouvrage sans lui exprimer toute ma recon-
naissance d’avoir vengé Tiepolo des dédains qu’affecta
à l’égard de ce grand artiste la solennelle ineptie de
M. Charles Blanc, un des plus complets ignorants qui
aient pataugé à la direction des Beaux-Arts. Il n’est pas
un homme de goût qui n’applaudisse au contraire à
ce jugement de fin connaisseur porté par M. Émile Moli-
nier :
« Me sera-t-il permis toutefois de rappeler le caractère