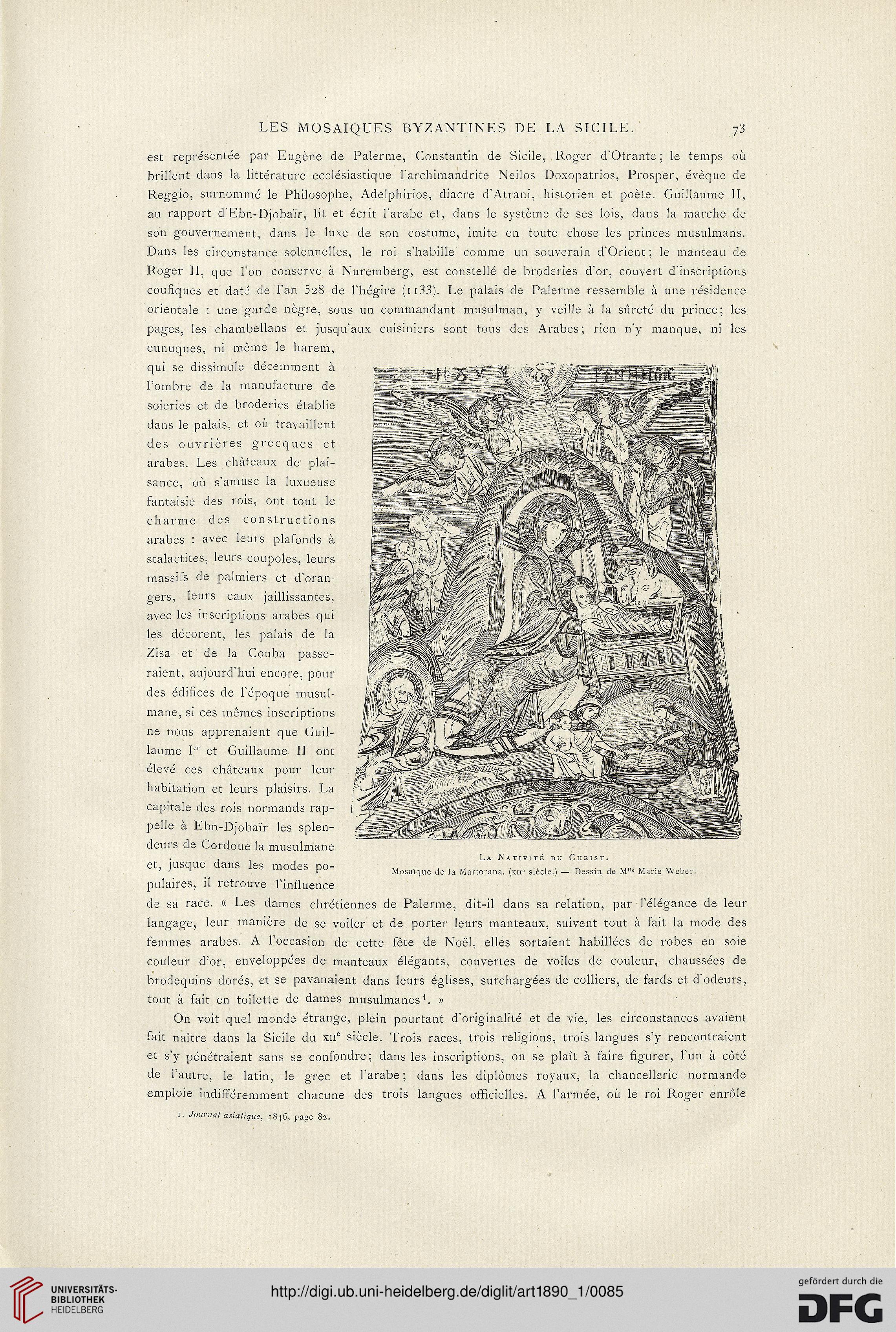LES MOSAÏQUES BYZANTINES DE LA SICILE.
est représentée par Eugène de Païenne, Constantin de Sicile, Roger d'Otrante ; le temps où
brillent dans la littérature ecclésiastique l'archimandrite Neilos Doxopatrios, Prosper, évêque de
Reggio, surnommé le Philosophe, Adelphirios, diacre d’Atrani, historien et poète. Guillaume II,
au rapport d’Ebn-Djobaïr, lit et écrit l’arabe et, dans le système de ses lois, dans la marche de
son gouvernement, dans le luxe de son costume, imite en toute chose les princes musulmans.
Dans les circonstance solennelles, le roi s’habille comme un souverain d'Orient ; le manteau de
Roger II, que l'on conserve à Nuremberg, est constellé de broderies d'or, couvert d’inscriptions
coufiques et daté de l’an 5e8 de l'hégire (1133). Le palais de Païenne ressemble à une résidence
orientale : une garde nègre, sous un commandant musulman, y veille à la sûreté du prince; les
pages, les chambellans et jusqu’aux cuisiniers sont tous des Arabes; rien n’y manque, ni les
eunuques, ni même le harem,
qui se dissimule décemment à
l’ombre de la manufacture de
soieries et de broderies établie
dans le palais, et où travaillent
des ouvrières grecques et
arabes. Les châteaux de plai-
sance, où s’amuse la luxueuse
fantaisie des rois, ont tout le
charme des constructions
arabes : avec leurs plafonds à
stalactites, leurs coupoles, leurs
massils de palmiers et d’oran-
gers, leurs eaux jaillissantes,
avec les inscriptions arabes qui
les décorent, les palais de la
Zisa et de la Couba passe-
raient, aujourd'hui encore, pour
des édifices de l’époque musul-
mane, si ces mêmes inscriptions
ne nous apprenaient que Guil-
laume Ier et Guillaume II ont
élevé ces châteaux pour leur
habitation et leurs plaisirs. La
capitale des rois normands rap-
pelle à Ebn-Djobaïr les splen-
deurs de Cordoue la musulmane
et, jusque clans les modes po-
pulaires, il retrouve l’influence
de sa race. « Les dames chrétiennes de Palerme, dit-il dans sa relation, par l’élégance de leur
langage, leur manière de se voiler et de porter leurs manteaux, suivent tout à fait la mode des
femmes arabes. A 1 occasion de cette fête de Noël, elles sortaient habillées de robes en soie
couleur d’or, enveloppées de manteaux élégants, couvertes de voiles de couleur, chaussées de
*
brodequins dorés, et se pavanaient dans leurs églises, surchargées de colliers, de fards et d'odeurs,
tout à fait en toilette de dames musulmanes 1. »
On voit quel monde étrange, plein pourtant d'originalité et de vie, les circonstances avaient
fait naître dans la Sicile du xiT siècle. Trois races, trois religions, trois langues s’y rencontraient
et s'y pénétraient sans se confondre; dans les inscriptions, on se plaît à faire figurer, 1 un à côté
de l'autre, le latin, le grec et l'arabe ; dans les diplômes royaux, la chancellerie normande
emploie indifféremment chacune des trois langues officielles. A l’armée, où le roi Roger enrôle
i. Journal asiatique, 1846, page 82.
La Nativité du Christ.
Mosaïque de la Martorana. (xn° siècle.) —■ Dessin de Mlle Marie Weber.
est représentée par Eugène de Païenne, Constantin de Sicile, Roger d'Otrante ; le temps où
brillent dans la littérature ecclésiastique l'archimandrite Neilos Doxopatrios, Prosper, évêque de
Reggio, surnommé le Philosophe, Adelphirios, diacre d’Atrani, historien et poète. Guillaume II,
au rapport d’Ebn-Djobaïr, lit et écrit l’arabe et, dans le système de ses lois, dans la marche de
son gouvernement, dans le luxe de son costume, imite en toute chose les princes musulmans.
Dans les circonstance solennelles, le roi s’habille comme un souverain d'Orient ; le manteau de
Roger II, que l'on conserve à Nuremberg, est constellé de broderies d'or, couvert d’inscriptions
coufiques et daté de l’an 5e8 de l'hégire (1133). Le palais de Païenne ressemble à une résidence
orientale : une garde nègre, sous un commandant musulman, y veille à la sûreté du prince; les
pages, les chambellans et jusqu’aux cuisiniers sont tous des Arabes; rien n’y manque, ni les
eunuques, ni même le harem,
qui se dissimule décemment à
l’ombre de la manufacture de
soieries et de broderies établie
dans le palais, et où travaillent
des ouvrières grecques et
arabes. Les châteaux de plai-
sance, où s’amuse la luxueuse
fantaisie des rois, ont tout le
charme des constructions
arabes : avec leurs plafonds à
stalactites, leurs coupoles, leurs
massils de palmiers et d’oran-
gers, leurs eaux jaillissantes,
avec les inscriptions arabes qui
les décorent, les palais de la
Zisa et de la Couba passe-
raient, aujourd'hui encore, pour
des édifices de l’époque musul-
mane, si ces mêmes inscriptions
ne nous apprenaient que Guil-
laume Ier et Guillaume II ont
élevé ces châteaux pour leur
habitation et leurs plaisirs. La
capitale des rois normands rap-
pelle à Ebn-Djobaïr les splen-
deurs de Cordoue la musulmane
et, jusque clans les modes po-
pulaires, il retrouve l’influence
de sa race. « Les dames chrétiennes de Palerme, dit-il dans sa relation, par l’élégance de leur
langage, leur manière de se voiler et de porter leurs manteaux, suivent tout à fait la mode des
femmes arabes. A 1 occasion de cette fête de Noël, elles sortaient habillées de robes en soie
couleur d’or, enveloppées de manteaux élégants, couvertes de voiles de couleur, chaussées de
*
brodequins dorés, et se pavanaient dans leurs églises, surchargées de colliers, de fards et d'odeurs,
tout à fait en toilette de dames musulmanes 1. »
On voit quel monde étrange, plein pourtant d'originalité et de vie, les circonstances avaient
fait naître dans la Sicile du xiT siècle. Trois races, trois religions, trois langues s’y rencontraient
et s'y pénétraient sans se confondre; dans les inscriptions, on se plaît à faire figurer, 1 un à côté
de l'autre, le latin, le grec et l'arabe ; dans les diplômes royaux, la chancellerie normande
emploie indifféremment chacune des trois langues officielles. A l’armée, où le roi Roger enrôle
i. Journal asiatique, 1846, page 82.
La Nativité du Christ.
Mosaïque de la Martorana. (xn° siècle.) —■ Dessin de Mlle Marie Weber.