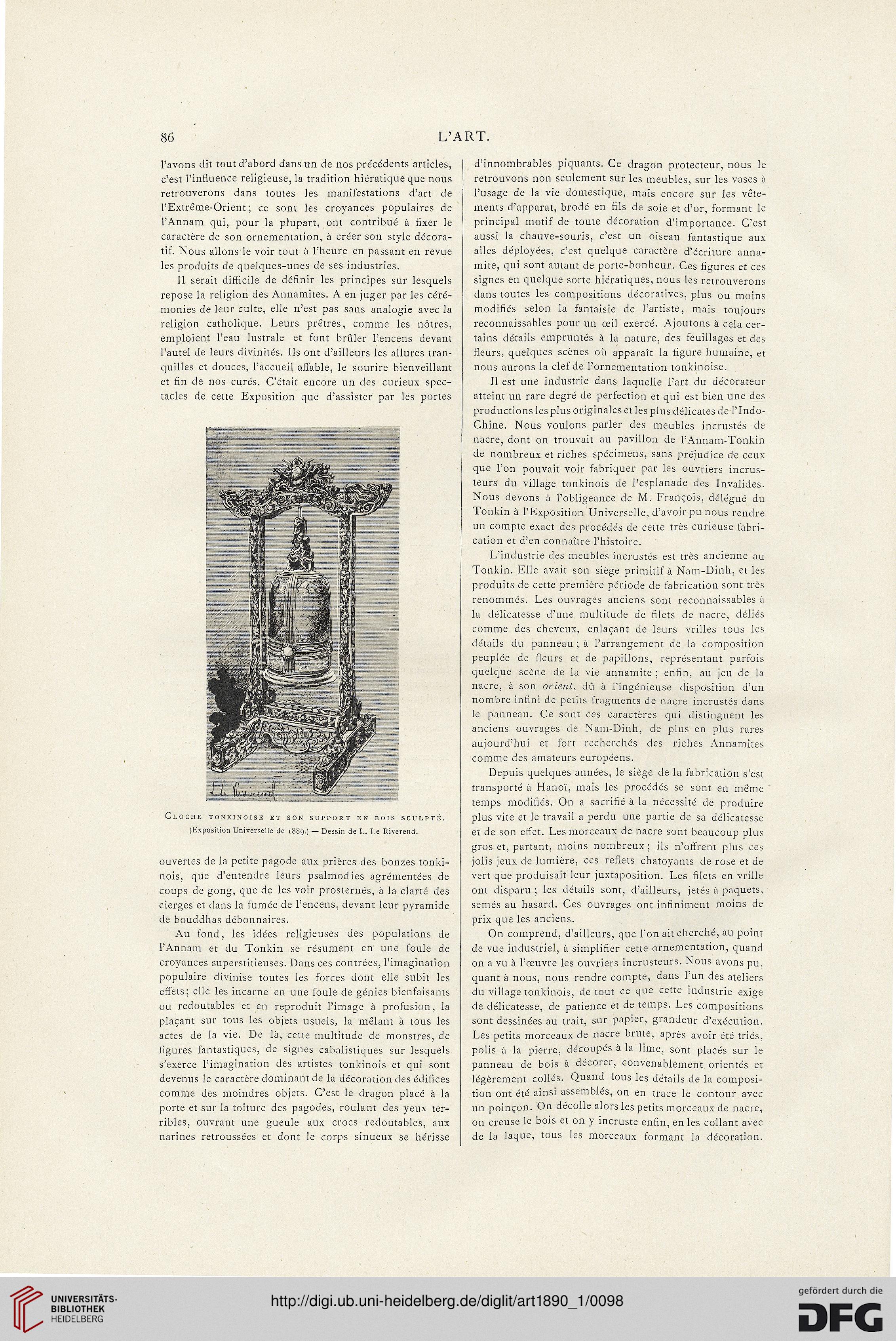86
L’ART.
l’avons dit tout d’abord dans un de nos pre'ce'dents articles,
c’est l’influence religieuse, la tradition hiératique que nous
retrouverons dans toutes les manifestations d’art de
l’Extrême-Orient; ce sont les croyances populaires de
l’Annam qui, pour la plupart, ont contribué à fixer le
caractère de son ornementation, à créer son style décora-
tif. Nous allons le voir tout à l’heure en passant en revue
les produits de quelques-unes de ses industries.
11 serait difficile de définir les principes sur lesquels
repose la religion des Annamites. A en juger par les céré-
monies de leur culte, elle n’est pas sans analogie avec la
religion catholique. Leurs prêtres, comme les nôtres,
emploient l’eau lustrale et font brûler l’encens devant
l’autel de leurs divinités. Ils ont d’ailleurs les allures tran-
quilles et douces, l’accueil affable, le sourire bienveillant
et fin de nos curés. C’était encore un des curieux spec-
tacles de cette Exposition que d’assister par les portes
Cloche tonkinoise et son support en bois sculpté.
(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.
ouvertes de la petite pagode aux prières des bonzes tonki-
nois, que d’entendre leurs psalmodies agrémentées de
coups de gong, que de les voir prosternés, à la clarté des
cierges et dans la fumée de l’encens, devant leur pyramide
de bouddhas débonnaires.
Au fond, les idées religieuses des populations de
l’Annam et du Tonkin se résument en une foule de
croyances superstitieuses. Dans ces contrées, l’imagination
populaire divinise toutes les forces dont elle subit les
effets; elle les incarne en une foule de génies bienfaisants
ou redoutables et en reproduit l’image à profusion, la
plaçant sur tous les objets usuels, la mêlant à tous les
actes de la vie. De là, cette multitude de monstres, de
figures fantastiques, de signes cabalistiques sur lesquels
s’exerce l’imagination des artistes tonkinois et qui sont
devenus le caractère dominant de la décoration des édifices
comme des moindres objets. C’est le dragon placé à la
porte et sur la toiture des pagodes, roulant des yeux ter-
ribles, ouvrant une gueule aux crocs redoutables, aux
narines retroussées et dont le corps sinueux se hérisse
d’innombrables piquants. Ce dragon protecteur, nous le
retrouvons non seulement sur les meubles, sur les vases à
l’usage de la vie domestique, mais encore sur les vête-
ments d’apparat, brodé en fils de soie et d’or, formant le
principal motif de toute décoration d’importance. C’est
aussi la chauve-souris, c’est un oiseau fantastique aux
ailes déployées, c’est quelque caractère d’écriture anna-
mite, qui sont autant de porte-bonheur. Ces figures et ces
signes en quelque sorte hiératiques, nous les retrouverons
dans toutes les compositions décoratives, plus ou moins
modifiés selon la fantaisie de l’artiste, mais toujours
reconnaissables pour un œil exercé. Ajoutons à cela cer-
tains détails empruntés à la nature, des feuillages et des
fleurs, quelques scènes où apparaît la figure humaine, et
nous aurons la clef de l’ornementation tonkinoise.
Il est une industrie dans laquelle l’art du décorateur
atteint un rare degré de perfection et qui est bien une des
productions les plus originales et les plus délicates de l’Indo-
Chine. Nous voulons parler des meubles incrustés de
nacre, dont on trouvait au pavillon de l’Annam-Tonkin
de nombreux et riches spécimens, sans préjudice de ceux
que l’on pouvait voir fabriquer par les ouvriers incrus-
teurs du village tonkinois de l’esplanade des Invalides.
Nous devons à l’obligeance de M. François, délégué du
Tonkin à l’Exposition Universelle, d’avoir pu nous rendre
un compte exact des procédés de cette très curieuse fabri-
cation et d’en connaître l’histoire.
L’industrie des meubles incrustés est très ancienne au
Tonkin. Elle avait son siège primitif à Nam-Dinh, et les
produits de cette première période de fabrication sont très
renommés. Les ouvrages anciens sont reconnaissables à
la délicatesse d’une multitude de filets de nacre, déliés
comme des cheveux, enlaçant de leurs vrilles tous les
détails du panneau ; à l’arrangement de la composition
peuplée de fleurs et de papillons, représentant parfois
quelque scène de la vie annamite ; enfin, au jeu de la
nacre, à son orient, dû à l’ingénieuse disposition d’un
nombre infini de petits fragments de nacre incrustés dans
le panneau. Ce sont ces caractères qui distinguent les
anciens ouvrages de Nam-Dinh, de plus en plus rares
aujourd’hui et fort recherchés des riches Annamites
comme des amateurs européens.
Depuis quelques années, le siège de la fabrication s’est
transporté à Hanoï, mais les procédés se sont en même
temps modifiés. On a sacrifié à la nécessité de produire
plus vite et le travail a perdu une partie de sa délicatesse
et de son effet. Les morceaux de nacre sont beaucoup plus
gros et, partant, moins nombreux; ils n’offrent plus ces
jolis jeux de lumière, ces reflets chatoyants de rose et de
vert que produisait leur juxtaposition. Les filets en vrille
ont disparu ; les détails sont, d’ailleurs, jetés à paquets,
semés au hasard. Ces ouvrages ont infiniment moins de
prix que les anciens.
On comprend, d’ailleurs, que l'on ait cherché, au point
de vue industriel, à simplifier cette ornementation, quand
on a vu à l’œuvre les ouvriers incrusteurs. Nous avons pu.
quant à nous, nous rendre compte, dans l’un des ateliers
du village tonkinois, de tout ce que cette industrie exige
de délicatesse, de patience et de temps. Les compositions
sont dessinées au trait, sur papier, grandeur d’exécution.
Les petits morceaux de nacre brute, après avoir été triés,
polis à la pierre, découpés à la lime, sont placés sur le
panneau de bois à décorer, convenablement orientés et
légèrement collés. Quand tous les détails de la composi-
tion ont été ainsi assemblés, on en trace le contour avec
un poinçon. On décolle alors les petits morceaux de nacre,
on creuse le bois et on y incruste enfin, en les collant avec
de la laque, tous les morceaux formant la décoration.
L’ART.
l’avons dit tout d’abord dans un de nos pre'ce'dents articles,
c’est l’influence religieuse, la tradition hiératique que nous
retrouverons dans toutes les manifestations d’art de
l’Extrême-Orient; ce sont les croyances populaires de
l’Annam qui, pour la plupart, ont contribué à fixer le
caractère de son ornementation, à créer son style décora-
tif. Nous allons le voir tout à l’heure en passant en revue
les produits de quelques-unes de ses industries.
11 serait difficile de définir les principes sur lesquels
repose la religion des Annamites. A en juger par les céré-
monies de leur culte, elle n’est pas sans analogie avec la
religion catholique. Leurs prêtres, comme les nôtres,
emploient l’eau lustrale et font brûler l’encens devant
l’autel de leurs divinités. Ils ont d’ailleurs les allures tran-
quilles et douces, l’accueil affable, le sourire bienveillant
et fin de nos curés. C’était encore un des curieux spec-
tacles de cette Exposition que d’assister par les portes
Cloche tonkinoise et son support en bois sculpté.
(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.
ouvertes de la petite pagode aux prières des bonzes tonki-
nois, que d’entendre leurs psalmodies agrémentées de
coups de gong, que de les voir prosternés, à la clarté des
cierges et dans la fumée de l’encens, devant leur pyramide
de bouddhas débonnaires.
Au fond, les idées religieuses des populations de
l’Annam et du Tonkin se résument en une foule de
croyances superstitieuses. Dans ces contrées, l’imagination
populaire divinise toutes les forces dont elle subit les
effets; elle les incarne en une foule de génies bienfaisants
ou redoutables et en reproduit l’image à profusion, la
plaçant sur tous les objets usuels, la mêlant à tous les
actes de la vie. De là, cette multitude de monstres, de
figures fantastiques, de signes cabalistiques sur lesquels
s’exerce l’imagination des artistes tonkinois et qui sont
devenus le caractère dominant de la décoration des édifices
comme des moindres objets. C’est le dragon placé à la
porte et sur la toiture des pagodes, roulant des yeux ter-
ribles, ouvrant une gueule aux crocs redoutables, aux
narines retroussées et dont le corps sinueux se hérisse
d’innombrables piquants. Ce dragon protecteur, nous le
retrouvons non seulement sur les meubles, sur les vases à
l’usage de la vie domestique, mais encore sur les vête-
ments d’apparat, brodé en fils de soie et d’or, formant le
principal motif de toute décoration d’importance. C’est
aussi la chauve-souris, c’est un oiseau fantastique aux
ailes déployées, c’est quelque caractère d’écriture anna-
mite, qui sont autant de porte-bonheur. Ces figures et ces
signes en quelque sorte hiératiques, nous les retrouverons
dans toutes les compositions décoratives, plus ou moins
modifiés selon la fantaisie de l’artiste, mais toujours
reconnaissables pour un œil exercé. Ajoutons à cela cer-
tains détails empruntés à la nature, des feuillages et des
fleurs, quelques scènes où apparaît la figure humaine, et
nous aurons la clef de l’ornementation tonkinoise.
Il est une industrie dans laquelle l’art du décorateur
atteint un rare degré de perfection et qui est bien une des
productions les plus originales et les plus délicates de l’Indo-
Chine. Nous voulons parler des meubles incrustés de
nacre, dont on trouvait au pavillon de l’Annam-Tonkin
de nombreux et riches spécimens, sans préjudice de ceux
que l’on pouvait voir fabriquer par les ouvriers incrus-
teurs du village tonkinois de l’esplanade des Invalides.
Nous devons à l’obligeance de M. François, délégué du
Tonkin à l’Exposition Universelle, d’avoir pu nous rendre
un compte exact des procédés de cette très curieuse fabri-
cation et d’en connaître l’histoire.
L’industrie des meubles incrustés est très ancienne au
Tonkin. Elle avait son siège primitif à Nam-Dinh, et les
produits de cette première période de fabrication sont très
renommés. Les ouvrages anciens sont reconnaissables à
la délicatesse d’une multitude de filets de nacre, déliés
comme des cheveux, enlaçant de leurs vrilles tous les
détails du panneau ; à l’arrangement de la composition
peuplée de fleurs et de papillons, représentant parfois
quelque scène de la vie annamite ; enfin, au jeu de la
nacre, à son orient, dû à l’ingénieuse disposition d’un
nombre infini de petits fragments de nacre incrustés dans
le panneau. Ce sont ces caractères qui distinguent les
anciens ouvrages de Nam-Dinh, de plus en plus rares
aujourd’hui et fort recherchés des riches Annamites
comme des amateurs européens.
Depuis quelques années, le siège de la fabrication s’est
transporté à Hanoï, mais les procédés se sont en même
temps modifiés. On a sacrifié à la nécessité de produire
plus vite et le travail a perdu une partie de sa délicatesse
et de son effet. Les morceaux de nacre sont beaucoup plus
gros et, partant, moins nombreux; ils n’offrent plus ces
jolis jeux de lumière, ces reflets chatoyants de rose et de
vert que produisait leur juxtaposition. Les filets en vrille
ont disparu ; les détails sont, d’ailleurs, jetés à paquets,
semés au hasard. Ces ouvrages ont infiniment moins de
prix que les anciens.
On comprend, d’ailleurs, que l'on ait cherché, au point
de vue industriel, à simplifier cette ornementation, quand
on a vu à l’œuvre les ouvriers incrusteurs. Nous avons pu.
quant à nous, nous rendre compte, dans l’un des ateliers
du village tonkinois, de tout ce que cette industrie exige
de délicatesse, de patience et de temps. Les compositions
sont dessinées au trait, sur papier, grandeur d’exécution.
Les petits morceaux de nacre brute, après avoir été triés,
polis à la pierre, découpés à la lime, sont placés sur le
panneau de bois à décorer, convenablement orientés et
légèrement collés. Quand tous les détails de la composi-
tion ont été ainsi assemblés, on en trace le contour avec
un poinçon. On décolle alors les petits morceaux de nacre,
on creuse le bois et on y incruste enfin, en les collant avec
de la laque, tous les morceaux formant la décoration.