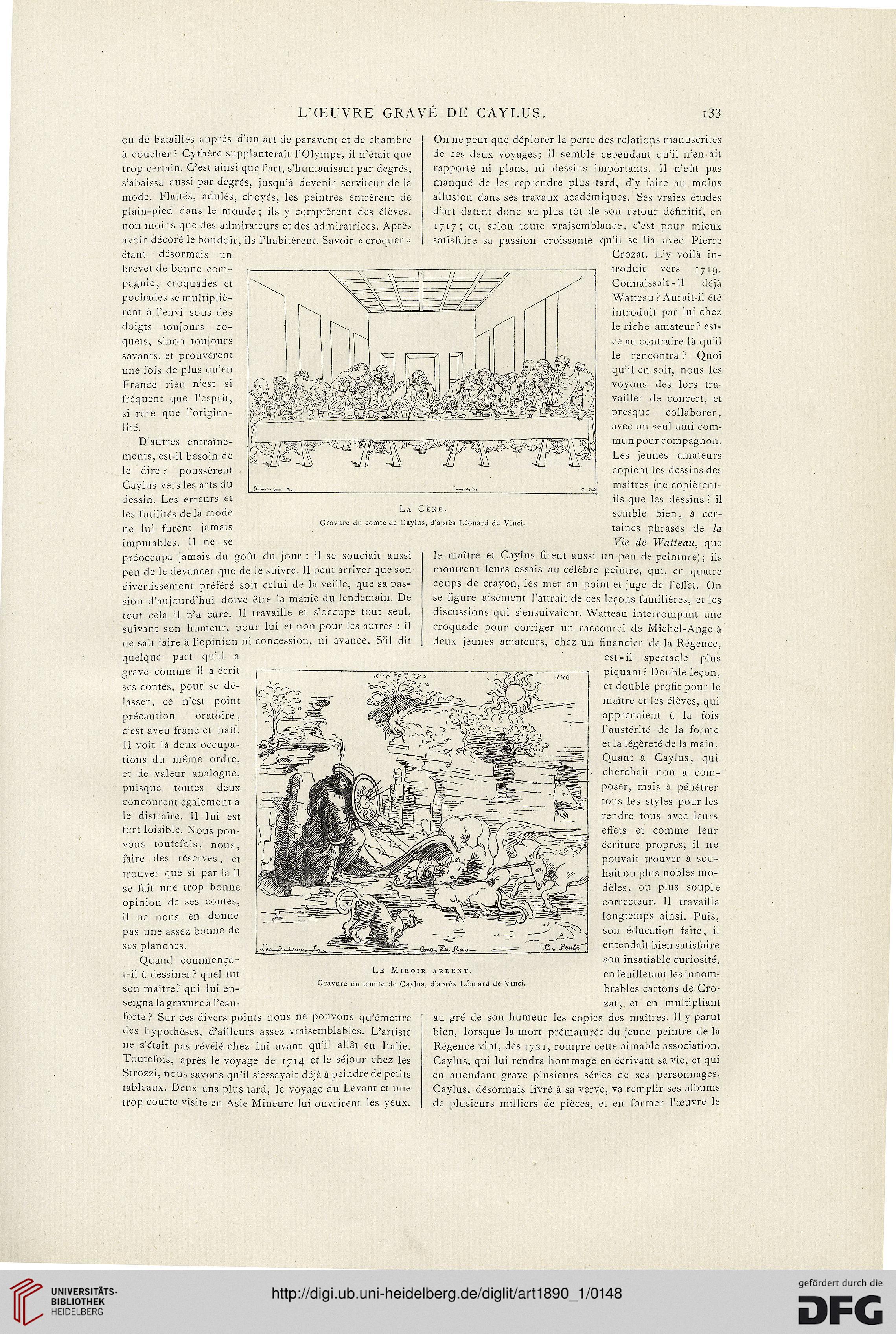L'ŒUVRE GRAVE DE CAYLUS.
133
ou de batailles auprès d'un art de paravent et de chambre
à coucher? Cythère supplanterait l’Olympe, il n’était que
trop certain. C’est ainsi que l’art, s’humanisant par degrés,
s’abaissa aussi par degrés, jusqu’à devenir serviteur de la
mode. Flattés, adulés, choyés, les peintres entrèrent de
plain-pied dans le monde ; ils y comptèrent des élèves,
non moins que des admirateurs et des admiratrices. Après
avoir décoré le boudoir, ils l’habitèrent. Savoir « croquer »
étant désormais un
brevet de bonne com-
pagnie, croquades et
pochades se multipliè-
rent à l’envi sous des
doigts toujours co-
quets, sinon toujours
savants, et prouvèrent
une fois de plus qu'en
France rien n’est si
fréquent que l’esprit,
si rare que l’origina-
lité.
D’autres entraîne-
ments, est-il besoin de
le dire ? poussèrent
Caylus vers les arts du
dessin. Les erreurs et
les futilités de la mode
ne lui furent jamais
imputables. Il ne se
préoccupa jamais du goût du jour : il se souciait aussi
peu de le devancer que de le suivre. Il peut arriver que son
divertissement préféré soit celui de la veille, que sa pas-
sion d’aujourd’hui doive être la manie du lendemain. De
tout cela il n’a cure. Il travaille et s occupe tout seul,
suivant son humeur, pour lui et non pour les autres : il
ne sait faire à l’opinion ni concession, ni avance. S’il dit
quelque part qu’il a
gravé comme il a écrit
ses contes, pour se dé-
lasser, ce n’est point
précaution oratoire,
c’est aveu franc et naïf.
Il voit là deux occupa-
tions du même ordre,
et de valeur analogue,
puisque toutes deux
concourent également à
le distraire. Il lui est
fort loisible. Nous pou-
vons toutefois, nous,
faire des réserves, et
trouver que si par là il
se fait une trop bonne
opinion de ses contes,
il ne nous en donne
p>as une assez bonne de
ses planches.
Quand commença-
t-il à dessiner? quel fut
son maître? qui lui en-
seigna la gravure à l’eau-
forte ? Sur ces divers points nous ne pouvons qu’émettre
des hypothèses, d’ailleurs assez vraisemblables. L’artiste
ne s’était pas révélé chez lui avant qu’il allât en Italie,
loutefois, après le voyage de 1714 et le séjour chez les
Strozzi, nous savons qu’il s’essayait déjà à peindre de petits
tableaux. Deux ans plus tard, le voyage du Levant et une
trop courte visite en Asie Mineure lui ouvrirent les yeux.
On ne peut que déplorer la perte des relations manuscrites
de ces deux voyages; il semble cependant qu’il n’en ait
rapporté ni plans, ni dessins importants. 11 n’eût pas
manqué de les reprendre plus tard, d’y faire au moins
allusion dans ses travaux académiques. Ses vraies études
d’art datent donc au plus tôt de son retour définitif, en
1717; et, selon toute vraisemblance, c’est pour mieux
satisfaire sa passion croissante qu’il se lia avec Pierre
Crozat. L’y voilà in-
troduit vers 1719.
Connaissait - il déjà
Watteau ? Aurait-il été
introduit par lui chez
le riche amateur? est-
ce au contraire là qu’il
le rencontra ? Quoi
qu’il en soit, nous les
voyons dès lors tra-
vailler de concert, et
presque collaborer,
avec un seul ami com-
mun pour compagnon.
Les jeunes amateurs
copient les dessins des
maîtres (ne copièrent-
ils que les dessins ? il
semble bien, à cer-
taines phrases de la
Vie de Watteau, que
le maître et Caylus firent aussi un peu de peinture) ; ils
montrent leurs essais au célèbre peintre, qui, en quatre
coups de crayon, les met au point et juge de l'effet. On
se figure aisément l’attrait de ces leçons familières, et les
discussions qui s’ensuivaient. Watteau interrompant une
croquade pour corriger un raccourci de Michel-Ange à
deux jeunes amateurs, chez un financier de la Régence,
est-il spectacle plus
piquant? Double leçon,
et double profit pour le
maître et les élèves, qui
apprenaient à la fois
l’austérité de la forme
et la légèreté de la main.
Quant à Caylus, qui
cherchait non à com-
poser, mais à pénétrer
tous les styles pour les
rendre tous avec leurs
effets et comme leur
écriture propres, il ne
pouvait trouver à sou-
hait ou plus nobles mo-
dèles, ou plus souple
correcteur. Il travailla
longtemps ainsi. Puis,
son éducation faite, il
entendait bien satisfaire
son insatiable curiosité,
en feuilletant les innom-
brables cartons de Cro-
zat, et en multipliant
au gré de son humeur les copies des maîtres. Il y parut
bien, lorsque la mort prématurée du jeune peintre de la
Régence vint, dès 1721, rompre cette aimable association.
Caylus, qui lui rendra hommage en écrivant sa vie, et qui
en attendant grave plusieurs séries de ses personnages,
Caylus, désormais livré à sa verve, va remplir ses albums
de plusieurs milliers de pièces, et en former l’œuvre le
La Cène.
Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.
Le Miroir ardent.
Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.
133
ou de batailles auprès d'un art de paravent et de chambre
à coucher? Cythère supplanterait l’Olympe, il n’était que
trop certain. C’est ainsi que l’art, s’humanisant par degrés,
s’abaissa aussi par degrés, jusqu’à devenir serviteur de la
mode. Flattés, adulés, choyés, les peintres entrèrent de
plain-pied dans le monde ; ils y comptèrent des élèves,
non moins que des admirateurs et des admiratrices. Après
avoir décoré le boudoir, ils l’habitèrent. Savoir « croquer »
étant désormais un
brevet de bonne com-
pagnie, croquades et
pochades se multipliè-
rent à l’envi sous des
doigts toujours co-
quets, sinon toujours
savants, et prouvèrent
une fois de plus qu'en
France rien n’est si
fréquent que l’esprit,
si rare que l’origina-
lité.
D’autres entraîne-
ments, est-il besoin de
le dire ? poussèrent
Caylus vers les arts du
dessin. Les erreurs et
les futilités de la mode
ne lui furent jamais
imputables. Il ne se
préoccupa jamais du goût du jour : il se souciait aussi
peu de le devancer que de le suivre. Il peut arriver que son
divertissement préféré soit celui de la veille, que sa pas-
sion d’aujourd’hui doive être la manie du lendemain. De
tout cela il n’a cure. Il travaille et s occupe tout seul,
suivant son humeur, pour lui et non pour les autres : il
ne sait faire à l’opinion ni concession, ni avance. S’il dit
quelque part qu’il a
gravé comme il a écrit
ses contes, pour se dé-
lasser, ce n’est point
précaution oratoire,
c’est aveu franc et naïf.
Il voit là deux occupa-
tions du même ordre,
et de valeur analogue,
puisque toutes deux
concourent également à
le distraire. Il lui est
fort loisible. Nous pou-
vons toutefois, nous,
faire des réserves, et
trouver que si par là il
se fait une trop bonne
opinion de ses contes,
il ne nous en donne
p>as une assez bonne de
ses planches.
Quand commença-
t-il à dessiner? quel fut
son maître? qui lui en-
seigna la gravure à l’eau-
forte ? Sur ces divers points nous ne pouvons qu’émettre
des hypothèses, d’ailleurs assez vraisemblables. L’artiste
ne s’était pas révélé chez lui avant qu’il allât en Italie,
loutefois, après le voyage de 1714 et le séjour chez les
Strozzi, nous savons qu’il s’essayait déjà à peindre de petits
tableaux. Deux ans plus tard, le voyage du Levant et une
trop courte visite en Asie Mineure lui ouvrirent les yeux.
On ne peut que déplorer la perte des relations manuscrites
de ces deux voyages; il semble cependant qu’il n’en ait
rapporté ni plans, ni dessins importants. 11 n’eût pas
manqué de les reprendre plus tard, d’y faire au moins
allusion dans ses travaux académiques. Ses vraies études
d’art datent donc au plus tôt de son retour définitif, en
1717; et, selon toute vraisemblance, c’est pour mieux
satisfaire sa passion croissante qu’il se lia avec Pierre
Crozat. L’y voilà in-
troduit vers 1719.
Connaissait - il déjà
Watteau ? Aurait-il été
introduit par lui chez
le riche amateur? est-
ce au contraire là qu’il
le rencontra ? Quoi
qu’il en soit, nous les
voyons dès lors tra-
vailler de concert, et
presque collaborer,
avec un seul ami com-
mun pour compagnon.
Les jeunes amateurs
copient les dessins des
maîtres (ne copièrent-
ils que les dessins ? il
semble bien, à cer-
taines phrases de la
Vie de Watteau, que
le maître et Caylus firent aussi un peu de peinture) ; ils
montrent leurs essais au célèbre peintre, qui, en quatre
coups de crayon, les met au point et juge de l'effet. On
se figure aisément l’attrait de ces leçons familières, et les
discussions qui s’ensuivaient. Watteau interrompant une
croquade pour corriger un raccourci de Michel-Ange à
deux jeunes amateurs, chez un financier de la Régence,
est-il spectacle plus
piquant? Double leçon,
et double profit pour le
maître et les élèves, qui
apprenaient à la fois
l’austérité de la forme
et la légèreté de la main.
Quant à Caylus, qui
cherchait non à com-
poser, mais à pénétrer
tous les styles pour les
rendre tous avec leurs
effets et comme leur
écriture propres, il ne
pouvait trouver à sou-
hait ou plus nobles mo-
dèles, ou plus souple
correcteur. Il travailla
longtemps ainsi. Puis,
son éducation faite, il
entendait bien satisfaire
son insatiable curiosité,
en feuilletant les innom-
brables cartons de Cro-
zat, et en multipliant
au gré de son humeur les copies des maîtres. Il y parut
bien, lorsque la mort prématurée du jeune peintre de la
Régence vint, dès 1721, rompre cette aimable association.
Caylus, qui lui rendra hommage en écrivant sa vie, et qui
en attendant grave plusieurs séries de ses personnages,
Caylus, désormais livré à sa verve, va remplir ses albums
de plusieurs milliers de pièces, et en former l’œuvre le
La Cène.
Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.
Le Miroir ardent.
Gravure du comte de Caylus, d’après Léonard de Vinci.