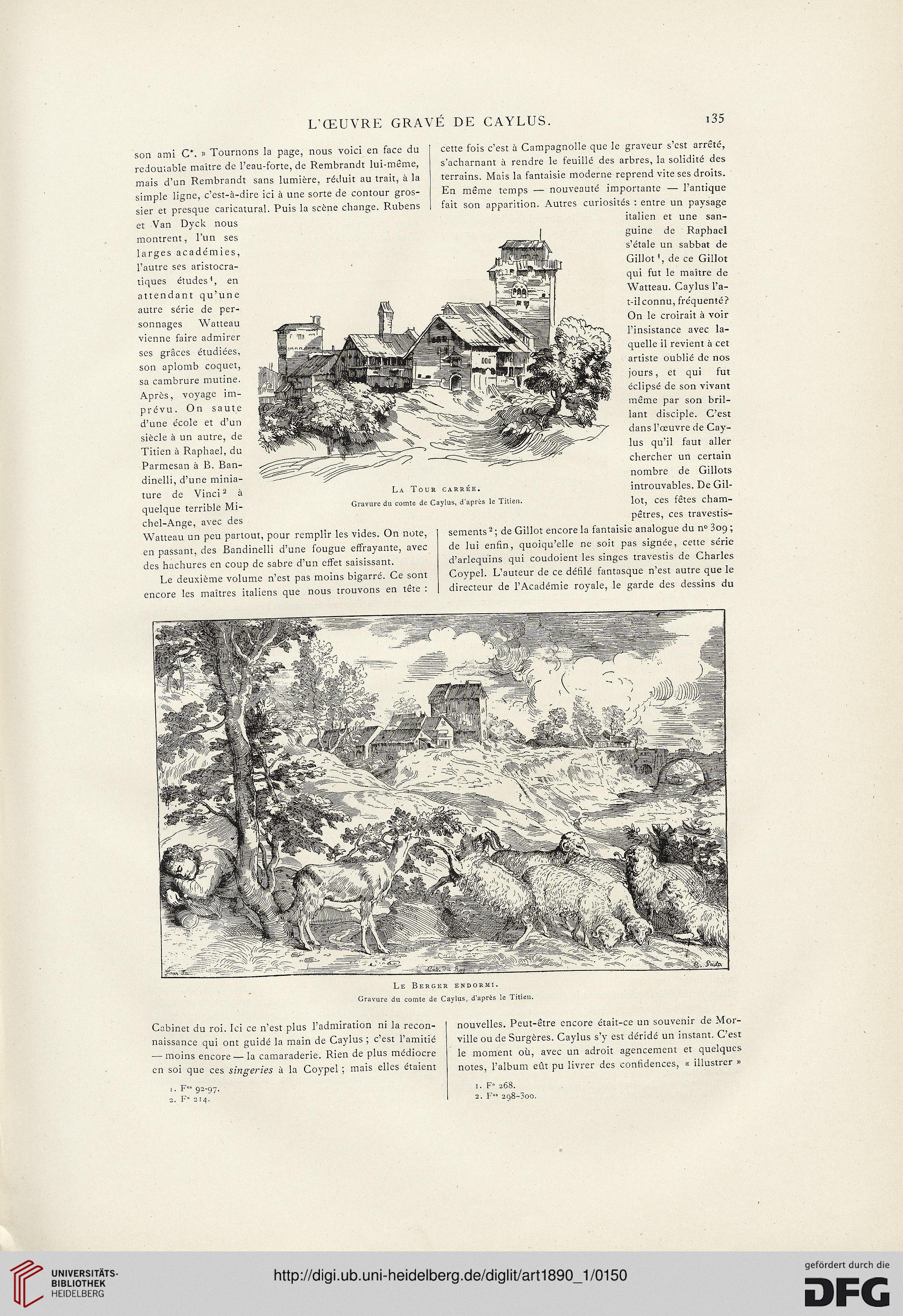L'ŒUVRE GRAVE DE CAYLUS.
135
son ami C*. » Tournons la page, nous voici en face du
redoutable maître de l’eau-forte, de Rembrandt lui-même,
mais d’un Rembrandt sans lumière, réduit au trait, à la
simple ligne, c’est-à-dire ici à une sorte de contour gros-
sier et presque caricatural. Puis la scène change. Rubens
et Van Dyck nous
montrent, l’un ses
larges académies,
l’autre ses aristocra-
tiques études1, en
attendant qu’une
autre série de per-
sonnages Watteau
vienne faire admirer
ses grâces étudiées,
son aplomb coquet,
sa cambrure mutine.
Après, voyage im-
prévu. On saute
d’une école et d’un
siècle à un autre, de
Titien à Raphaël, du
Parmesan à B. Ban-
dinelli, d’une minia-
ture de Vinci3 à
quelque terrible Mi-
chel-Ange, avec des
Watteau un peu partout, pour remplir les vides. On note,
en passant, des Bandinelli d’une fougue effrayante, avec
des hachures en coup de sabre d’un effet saisissant.
Le deuxième volume n’est pas moins bigarré. Ce sont
encore les maîtres italiens que nous trouvons en tête :
Cabinet du roi. Ici ce n’est plus l’admiration ni la recon-
naissance qui ont guidé la main de Caylus ; c’est l’amitié
— moins encore — la camaraderie. Rien de plus médiocre
en soi que ces singeries à la Coypel ; mais elles étaient
» • F°" 92-97-
2. F" 214.
cette fois c’est à Campagnolle que le graveur s’est arrêté,
s’acharnant à rendre le feuillé des arbres, la solidité des
terrains. Mais la fantaisie moderne reprend vite ses droits.
En même temps — nouveauté importante — l’antique
fait son apparition. Autres curiosités : entre un paysage
italien et une san-
guine de Raphaël
s’étale un sabbat de
Gillot1, de ce Gillot
qui fut le maître de
Watteau. Caylus l’a-
t-ilconnu, fréquenté?
On le croirait à voir
l’insistance avec la-
quelle il revient à cet
artiste oublié de nos
jours, et qui fut
éclipsé de son vivant
même par son bril-
lant disciple. C’est
dans l’œuvre de Cay-
lus qu’il faut aller
chercher un certain
nombre de Gillots
introuvables. De Gil-
lot, ces fêtes cham-
pêtres, ces travestis-
sements 2 ; de Gillot encore la fantaisie analogue du n° 309 ;
de lui enfin, quoiqu’elle ne soit pas signée, cette série
d’arlequins qui coudoient les singes travestis de Charles
Coypel. L’auteur de ce défilé fantasque n’est autre que le
directeur de l’Académie royale, le garde des dessins du
nouvelles. Peut-être encore était-ce un souvenir de Mor-
ville ou de Surgères. Caylus s’y est déridé un instant. C’est
le moment où, avec un adroit agencement et quelques
notes, l’album eût pu livrer des confidences, « illustrer »
1. F“ 268.
2. F°* 2q8-3oo.
La Tour carrée.
Gravure du comte de Caylus, d'après le Titien.
Le Berger endormi.
Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.
135
son ami C*. » Tournons la page, nous voici en face du
redoutable maître de l’eau-forte, de Rembrandt lui-même,
mais d’un Rembrandt sans lumière, réduit au trait, à la
simple ligne, c’est-à-dire ici à une sorte de contour gros-
sier et presque caricatural. Puis la scène change. Rubens
et Van Dyck nous
montrent, l’un ses
larges académies,
l’autre ses aristocra-
tiques études1, en
attendant qu’une
autre série de per-
sonnages Watteau
vienne faire admirer
ses grâces étudiées,
son aplomb coquet,
sa cambrure mutine.
Après, voyage im-
prévu. On saute
d’une école et d’un
siècle à un autre, de
Titien à Raphaël, du
Parmesan à B. Ban-
dinelli, d’une minia-
ture de Vinci3 à
quelque terrible Mi-
chel-Ange, avec des
Watteau un peu partout, pour remplir les vides. On note,
en passant, des Bandinelli d’une fougue effrayante, avec
des hachures en coup de sabre d’un effet saisissant.
Le deuxième volume n’est pas moins bigarré. Ce sont
encore les maîtres italiens que nous trouvons en tête :
Cabinet du roi. Ici ce n’est plus l’admiration ni la recon-
naissance qui ont guidé la main de Caylus ; c’est l’amitié
— moins encore — la camaraderie. Rien de plus médiocre
en soi que ces singeries à la Coypel ; mais elles étaient
» • F°" 92-97-
2. F" 214.
cette fois c’est à Campagnolle que le graveur s’est arrêté,
s’acharnant à rendre le feuillé des arbres, la solidité des
terrains. Mais la fantaisie moderne reprend vite ses droits.
En même temps — nouveauté importante — l’antique
fait son apparition. Autres curiosités : entre un paysage
italien et une san-
guine de Raphaël
s’étale un sabbat de
Gillot1, de ce Gillot
qui fut le maître de
Watteau. Caylus l’a-
t-ilconnu, fréquenté?
On le croirait à voir
l’insistance avec la-
quelle il revient à cet
artiste oublié de nos
jours, et qui fut
éclipsé de son vivant
même par son bril-
lant disciple. C’est
dans l’œuvre de Cay-
lus qu’il faut aller
chercher un certain
nombre de Gillots
introuvables. De Gil-
lot, ces fêtes cham-
pêtres, ces travestis-
sements 2 ; de Gillot encore la fantaisie analogue du n° 309 ;
de lui enfin, quoiqu’elle ne soit pas signée, cette série
d’arlequins qui coudoient les singes travestis de Charles
Coypel. L’auteur de ce défilé fantasque n’est autre que le
directeur de l’Académie royale, le garde des dessins du
nouvelles. Peut-être encore était-ce un souvenir de Mor-
ville ou de Surgères. Caylus s’y est déridé un instant. C’est
le moment où, avec un adroit agencement et quelques
notes, l’album eût pu livrer des confidences, « illustrer »
1. F“ 268.
2. F°* 2q8-3oo.
La Tour carrée.
Gravure du comte de Caylus, d'après le Titien.
Le Berger endormi.
Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.