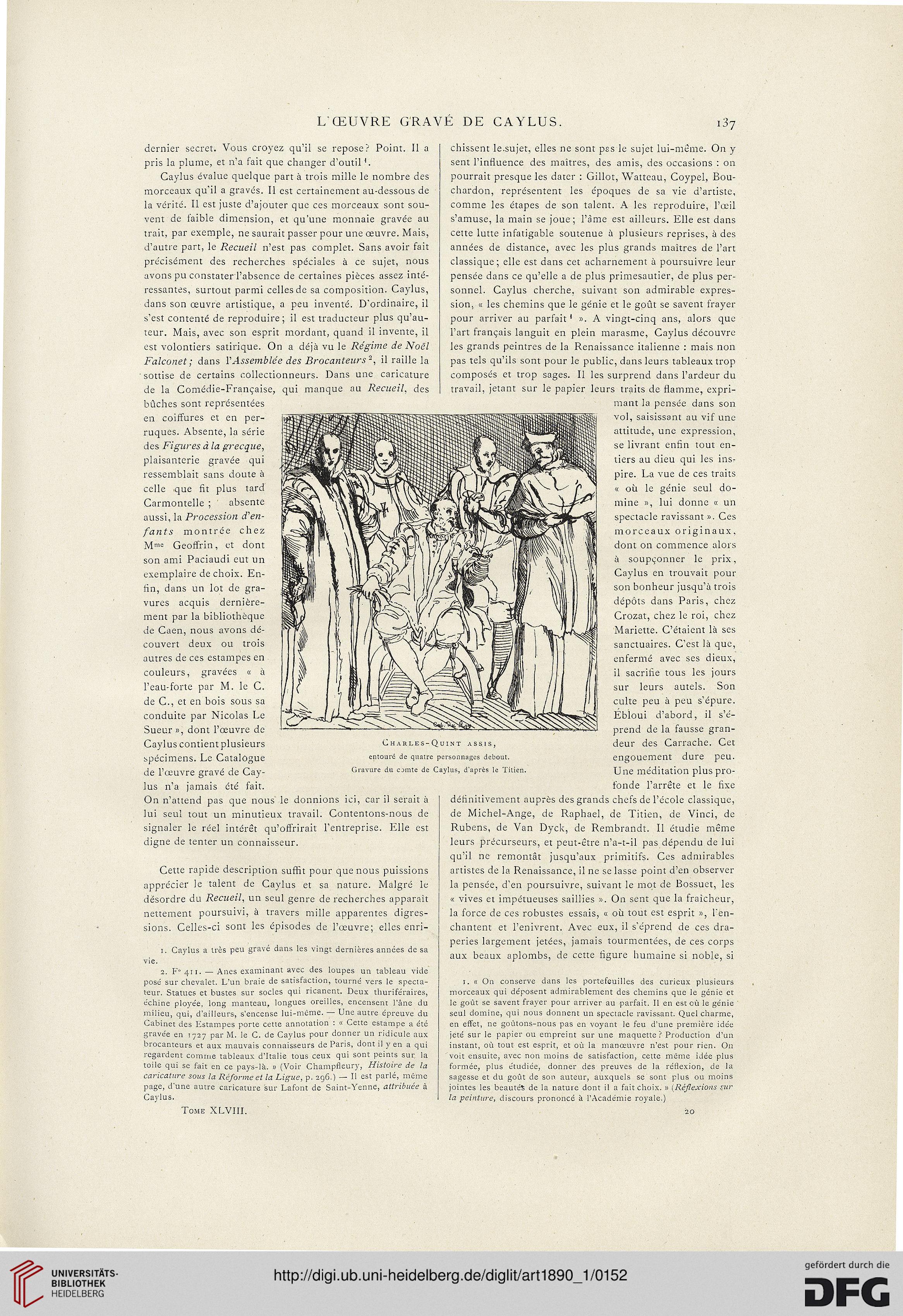L'ŒUVRE GRAVE DE CAYLUS.
dernier secret. Vous croyez qu’il se repose? Point. 11 a
pris la plume, et n’a fait que changer d’outil '.
Gaylus évalue quelque part à trois mille le nombre des
morceaux qu’il a gravés. 11 est certainement au-dessous de
la vérité. Il est juste d’ajouter que ce s morceaux sont sou-
vent de faible dimension, et qu’une monnaie gravée au
trait, par exemple, ne saurait passer pour une oeuvre. Mais,
d’autre part, le Recueil n’est pas complet. Sans avoir fait
précisément des recherches spéciales à ce sujet, nous
avons pu constater l’absence de certaines pièces assez inté-
ressantes, surtout parmi celles de sa composition. Caylus,
dans son œuvre artistique, a peu inventé. D'ordinaire, il
s’est contenté de reproduire; il est traducteur plus qu’au-
teur. Mais, avec son esprit mordant, quand il invente, il
est volontiers satirique. On a déjà vu le Régime de Noël
Falconet ; dans l’Assemblée des Brocanteurs *, il raille la
sottise de certains collectionneurs. Dans une caricature
de la Comédie-Française, qui manque au Recueil, des
bûches sont représentées
en coiffures et en per-
ruques. Absente, la série
des Figures à la grecque,
plaisanterie gravée qui
ressemblait sans doute à
celle .que fit plus tard
Carmontelle ; absente
aussi, la Procession d'en-
fants montrée chez
Mme Geoffrin, et dont
son ami Paciaudi eut un
exemplaire de choix. En-
fin, dans un lot de gra-
vures acquis dernière-
ment par la bibliothèque
de Caen, nous avons dé-
couvert deux ou trois
autres de ces estampes en
couleurs, gravées « à
l’eau-forte par M. le C.
de C., et en bois sous sa
conduite par Nicolas Le
Sueur », dont l’œuvre de
Caylus contient plusieurs
spécimens. Le Catalogue
de l’oeuvre gravé de Cay-
lus n’a jamais été fait.
On n’attend pas que nous le donnions ici, car il serait à
lui seul tout un minutieux travail. Contentons-nous de
signaler le réel intérêt qu’offrirait l’entreprise. Elle est
digne de tenter un connaisseur.
Cette rapide description suffit pour que nous puissions
apprécier le talent de Caylus et sa nature. Malgré le
désordre du Recueil, un seul genre de recherches apparaît
nettement poursuivi, à travers mille apparentes digres-
sions. Celles-ci sont les épisodes de l’œuvre; elles enri- 1 2
1. Caylus a très peu gravé dans les vingt dernières années de sa
vie.
2. F0 411. — Anes examinant avec des loupes un tableau vide
posé sur chevalet. L’un braie de satisfaction, tourné vers le specta-
teur. Statues et bustes sur socles qui ricanent. Deux thuriféraires,
échine ployée, long manteau, longues oreilles, encensent l’âne du
tuilieu, qui, d’ailleurs, s’encense lui-même. — Une autre épreuve du
Cabinet des Estampes porte cette annotation : « Cette estampe a été
gravée en 1727 par M. le C. de Caylus pour donner un ridicule aux
brocanteurs et aux mauvais connaisseurs de Paris, dont il y en a qui
regardent comme tableaux d’Italie tous ceux qui sont peints sur. la
toile qui se fait en ce pays-là. » (Voir Champfleury, Histoire de la
caricature sous la Réforme et la Ligue, p. 2gô.) — 11 est parlé, même
page, d une autre caricature sur Lafont de Saint-Yenne, attribuée à
Caylus.
ï37
chissent le.sujet, elles ne sont pas le sujet lui-même. On y
sent l’influence des maîtres, des amis, des occasions : on
pourrait presque les dater : Gillot, Watteau, Coypel, Bou-
chardon, représentent les époques de sa vie d’artiste,
comme les étapes de son talent. A les reproduire, l’œil
s’amuse, la main se joue; l’âme est ailleurs. Elle est dans
cette lutte infatigable soutenue à plusieurs reprises, à des
années de distance, avec les plus grands maîtres de l’art
classique; elle est dans cet acharnement à poursuivre leur
pensée dans ce qu’elle a de plus primesautier, de plus per-
sonnel. Caylus cherche, suivant son admirable expres-
sion, « les chemins que le génie et le goût se savent frayer
pour arriver au parfait1 ». A vingt-cinq ans, alors que
l’art français languit en plein marasme, Caylus découvre
les grands peintres de la Renaissance italienne : mais non
pas tels qu’ils sont pour le public, dans leurs tableaux trop
composés et trop sages. Il les surprend dans l’ardeur du
travail, jetant sur le papier leurs traits de flamme, expri-
mant la pensée dans son
vol, saisissant au vif une
attitude, une expression,
se livrant enfin tout en-
tiers au dieu qui les ins-
pire. La vue de ces traits
« où le génie seul do-
mine », lui donne « un
spectacle ravissant ». Ces
morceaux originaux,
dont on commence alors
à soupçonner le prix,
Caylus en trouvait pour
son bonheur jusqu’à trois
dépôts dans Paris, chez
Crozat, chez le roi, chez
Mariette. C’étaient là ses
sanctuaires. C’est là que,
enfermé avec ses dieux,
il sacrifie tous les jours
sur leurs autels. Son
culte peu à peu s’épure.
Ebloui d’abord, il s’é-
prend de la fausse gran-
deur des Carrache. Cet
engouement dure peu.
Une méditation plus pro-
fonde l’arrête et le fixe
définitivement auprès des grands chefs de l’école classique,
de Michel-Ange, de Raphaël, de Titien, de Vinci, de
Rubens, de Van Dyck, de Rembrandt. Il étudie même
leurs précurseurs, et peut-être n’a-t-il pas dépendu de lui
qu’il ne remontât jusqu’aux primitifs. Ces admirables
artistes de la Renaissance, il ne se lasse point d’en observer
la pensée, d’en poursuivre, suivant le mot de Bossuet, les
« vives et impétueuses saillies ». On sent que la fraîcheur,
la force de ces robustes essais, « où tout est esprit », l'en-
chantent et l’enivrent. Avec eux, il s'éprend de ces dra-
peries largement jetées, jamais tourmentées, de ces corps
aux beaux aplombs, de cette figure humaine si noble, si
1. « On conserve dans les portefeuilles des curieux plusieurs
morceaux qui déposent admirablement des chemins que le génie et
le goût se savent frayer pour arriver au parfait. Il en est où le génie
seul domine, qui nous donnent un spectacle ravissant. Quel charme,
en effet, ne goûtons-nous pas en voyant le feu d’une première idée
jeté sur le papier ou empreint sur une maquette? Production d’un
instant, où tout est esprit, et où la manœuvre n’est pour rien. On
voit ensuite, avec non moins de satisfaction, cette même idée plus
formée, plus étudiée, donner des preuves de la réflexion, de la
sagesse et du goût de son auteur, auxquels se sont plus ou moins
jointes les beautés de la nature dont il a fait choix. » (Réflexions sur
la peintui'e, discours prononcé à l’Académie royale.)
Charles-Quint assis,
entouré de quatre personnages debout.
Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.
Tome XLVIII.
20
dernier secret. Vous croyez qu’il se repose? Point. 11 a
pris la plume, et n’a fait que changer d’outil '.
Gaylus évalue quelque part à trois mille le nombre des
morceaux qu’il a gravés. 11 est certainement au-dessous de
la vérité. Il est juste d’ajouter que ce s morceaux sont sou-
vent de faible dimension, et qu’une monnaie gravée au
trait, par exemple, ne saurait passer pour une oeuvre. Mais,
d’autre part, le Recueil n’est pas complet. Sans avoir fait
précisément des recherches spéciales à ce sujet, nous
avons pu constater l’absence de certaines pièces assez inté-
ressantes, surtout parmi celles de sa composition. Caylus,
dans son œuvre artistique, a peu inventé. D'ordinaire, il
s’est contenté de reproduire; il est traducteur plus qu’au-
teur. Mais, avec son esprit mordant, quand il invente, il
est volontiers satirique. On a déjà vu le Régime de Noël
Falconet ; dans l’Assemblée des Brocanteurs *, il raille la
sottise de certains collectionneurs. Dans une caricature
de la Comédie-Française, qui manque au Recueil, des
bûches sont représentées
en coiffures et en per-
ruques. Absente, la série
des Figures à la grecque,
plaisanterie gravée qui
ressemblait sans doute à
celle .que fit plus tard
Carmontelle ; absente
aussi, la Procession d'en-
fants montrée chez
Mme Geoffrin, et dont
son ami Paciaudi eut un
exemplaire de choix. En-
fin, dans un lot de gra-
vures acquis dernière-
ment par la bibliothèque
de Caen, nous avons dé-
couvert deux ou trois
autres de ces estampes en
couleurs, gravées « à
l’eau-forte par M. le C.
de C., et en bois sous sa
conduite par Nicolas Le
Sueur », dont l’œuvre de
Caylus contient plusieurs
spécimens. Le Catalogue
de l’oeuvre gravé de Cay-
lus n’a jamais été fait.
On n’attend pas que nous le donnions ici, car il serait à
lui seul tout un minutieux travail. Contentons-nous de
signaler le réel intérêt qu’offrirait l’entreprise. Elle est
digne de tenter un connaisseur.
Cette rapide description suffit pour que nous puissions
apprécier le talent de Caylus et sa nature. Malgré le
désordre du Recueil, un seul genre de recherches apparaît
nettement poursuivi, à travers mille apparentes digres-
sions. Celles-ci sont les épisodes de l’œuvre; elles enri- 1 2
1. Caylus a très peu gravé dans les vingt dernières années de sa
vie.
2. F0 411. — Anes examinant avec des loupes un tableau vide
posé sur chevalet. L’un braie de satisfaction, tourné vers le specta-
teur. Statues et bustes sur socles qui ricanent. Deux thuriféraires,
échine ployée, long manteau, longues oreilles, encensent l’âne du
tuilieu, qui, d’ailleurs, s’encense lui-même. — Une autre épreuve du
Cabinet des Estampes porte cette annotation : « Cette estampe a été
gravée en 1727 par M. le C. de Caylus pour donner un ridicule aux
brocanteurs et aux mauvais connaisseurs de Paris, dont il y en a qui
regardent comme tableaux d’Italie tous ceux qui sont peints sur. la
toile qui se fait en ce pays-là. » (Voir Champfleury, Histoire de la
caricature sous la Réforme et la Ligue, p. 2gô.) — 11 est parlé, même
page, d une autre caricature sur Lafont de Saint-Yenne, attribuée à
Caylus.
ï37
chissent le.sujet, elles ne sont pas le sujet lui-même. On y
sent l’influence des maîtres, des amis, des occasions : on
pourrait presque les dater : Gillot, Watteau, Coypel, Bou-
chardon, représentent les époques de sa vie d’artiste,
comme les étapes de son talent. A les reproduire, l’œil
s’amuse, la main se joue; l’âme est ailleurs. Elle est dans
cette lutte infatigable soutenue à plusieurs reprises, à des
années de distance, avec les plus grands maîtres de l’art
classique; elle est dans cet acharnement à poursuivre leur
pensée dans ce qu’elle a de plus primesautier, de plus per-
sonnel. Caylus cherche, suivant son admirable expres-
sion, « les chemins que le génie et le goût se savent frayer
pour arriver au parfait1 ». A vingt-cinq ans, alors que
l’art français languit en plein marasme, Caylus découvre
les grands peintres de la Renaissance italienne : mais non
pas tels qu’ils sont pour le public, dans leurs tableaux trop
composés et trop sages. Il les surprend dans l’ardeur du
travail, jetant sur le papier leurs traits de flamme, expri-
mant la pensée dans son
vol, saisissant au vif une
attitude, une expression,
se livrant enfin tout en-
tiers au dieu qui les ins-
pire. La vue de ces traits
« où le génie seul do-
mine », lui donne « un
spectacle ravissant ». Ces
morceaux originaux,
dont on commence alors
à soupçonner le prix,
Caylus en trouvait pour
son bonheur jusqu’à trois
dépôts dans Paris, chez
Crozat, chez le roi, chez
Mariette. C’étaient là ses
sanctuaires. C’est là que,
enfermé avec ses dieux,
il sacrifie tous les jours
sur leurs autels. Son
culte peu à peu s’épure.
Ebloui d’abord, il s’é-
prend de la fausse gran-
deur des Carrache. Cet
engouement dure peu.
Une méditation plus pro-
fonde l’arrête et le fixe
définitivement auprès des grands chefs de l’école classique,
de Michel-Ange, de Raphaël, de Titien, de Vinci, de
Rubens, de Van Dyck, de Rembrandt. Il étudie même
leurs précurseurs, et peut-être n’a-t-il pas dépendu de lui
qu’il ne remontât jusqu’aux primitifs. Ces admirables
artistes de la Renaissance, il ne se lasse point d’en observer
la pensée, d’en poursuivre, suivant le mot de Bossuet, les
« vives et impétueuses saillies ». On sent que la fraîcheur,
la force de ces robustes essais, « où tout est esprit », l'en-
chantent et l’enivrent. Avec eux, il s'éprend de ces dra-
peries largement jetées, jamais tourmentées, de ces corps
aux beaux aplombs, de cette figure humaine si noble, si
1. « On conserve dans les portefeuilles des curieux plusieurs
morceaux qui déposent admirablement des chemins que le génie et
le goût se savent frayer pour arriver au parfait. Il en est où le génie
seul domine, qui nous donnent un spectacle ravissant. Quel charme,
en effet, ne goûtons-nous pas en voyant le feu d’une première idée
jeté sur le papier ou empreint sur une maquette? Production d’un
instant, où tout est esprit, et où la manœuvre n’est pour rien. On
voit ensuite, avec non moins de satisfaction, cette même idée plus
formée, plus étudiée, donner des preuves de la réflexion, de la
sagesse et du goût de son auteur, auxquels se sont plus ou moins
jointes les beautés de la nature dont il a fait choix. » (Réflexions sur
la peintui'e, discours prononcé à l’Académie royale.)
Charles-Quint assis,
entouré de quatre personnages debout.
Gravure du comte de Caylus, d’après le Titien.
Tome XLVIII.
20