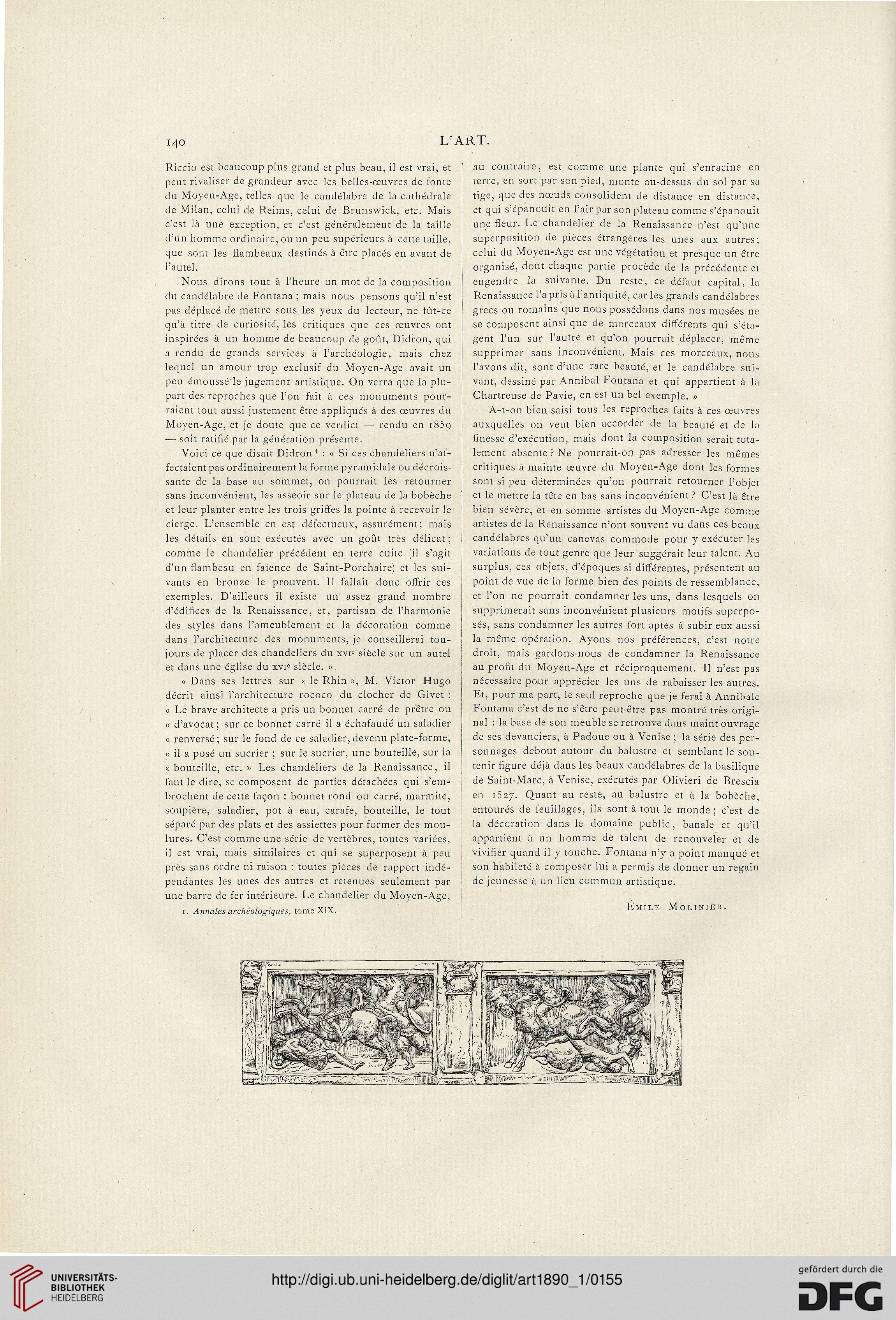140
L'ART.
Riccio est beaucoup plus grand et plus beau, il est vrai, et
peut rivaliser de grandeur avec les belles-œuvres de fonte
du Moyen-Age, telles que le candélabre de la cathédrale
de Milan, celui de Reims, celui de Brunswick, etc. Mais
c’est là une exception, et c’est généralement de la taille
d’un homme ordinaire, ou un peu supérieurs à cette taille,
que sont les flambeaux destinés à être placés en avant de
l’autel.
Nous dirons tout à l’heure un mot de la composition
du candélabre de Fontana ; mais nous pensons qu’il n'est
pas déplacé de mettre sous les yeux du lecteur, ne fût-ce
qu’à titre de curiosité, les critiques que ces œuvres ont
inspirées à un homme de beaucoup de goût, Didron, qui
a rendu de grands services à l’archéologie, mais chez
lequel un amour trop exclusif du Moyen-Age avait un
peu émousséie jugement artistique. On verra que la plu-
part des reproches que l’on fait à ces monuments pour-
raient tout aussi justement être appliqués à des œuvres du
Moyen-Age, et je doute que ce verdict — rendu en 185g
— soit ratifié par la génération présente.
Voici ce que disait Didron 1 : « Si ces chandeliers n’af-
fectaient pas ordinairement la forme pyramidale ou décrois-
sante de la base au sommet, on pourrait les retourner
sans inconvénient, les asseoir sur le plateau de la bobèche
et leur planter entre les trois griffes la pointe à recevoir le
cierge. L’ensemble en est défectueux, assurément; mais
les détails en sont exécutés avec un goût très délicat ;
comme le chandelier précédent en terre cuite (il s’agit
d’un flambeau en faïence de Saint-Porchaire) et les sui-
vants en bronze le prouvent. Il fallait donc offrir ces
exemples. D'ailleurs il existe un assez grand nombre
d’édifices de la Renaissance, et, partisan de l’harmonie
des styles dans l’ameublement et la décoration comme
dans l’architecture des monuments, je conseillerai tou- !
jours de placer des chandeliers du xvie siècle sur un autel
et dans une église du xvie siècle. »
« Dans ses lettres sur « le Rhin », M. Victor Hugo
décrit ainsi l’architecture rococo du clocher de Givet :
« Le brave architecte a pris un bonnet carré de prêtre ou
« d’avocat; sur ce bonnet carré il a échafaudé un saladier
« renversé; sur le fond de ce saladier, devenu plate-forme,
« il a posé un sucrier ; sur le sucrier, une bouteille, sur la
« bouteille, etc. » Les chandeliers de la Renaissance, il
faut le dire, se composent de parties détachées qui s’em-
brochent de cette façon : bonnet rond ou carré, marmite,
soupière, saladier, pot à eau, carafe, bouteille, le tout
séparé par des plats et des assiettes pour former des mou-
lures. C’est comme une série de vertèbres, toutes variées,
il est vrai, mais similaires et qui se superposent à peu
près sans ordre ni raison : toutes pièces de rapport indé-
pendantes les unes des autres et retenues seulement par j
une barre de fer intérieure. Le chandelier du Moyen-Age,
1. Annales archéologiques, tome XIX.
au contraire, est comme une plante qui s’enracine en
terre, en sort par son pied, monte au-dessus du sol par sa
tige, que des nœuds consolident de distance en distance,
et qui s’épanouit en l’air par son plateau comme s’épanouit
une fleur. Le chandelier de la Renaissance n’est qu’une
superposition de pièces étrangères les unes aux autres;
celui du Moyen-Age est une végétation et presque un être
organisé, dont chaque partie procède de la précédente et
engendre la suivante. Du reste, ce défaut capital, la
Renaissance l’a pris à l’antiquité, car les grands candélabres
grecs ou romains que nous possédons dans nos musées ne
se composent ainsi que de morceaux différents qui s’éta-
gent l’un sur l’autre et qu’on pourrait déplacer, même
supprimer sans inconvénient. Mais ces morceaux, nous
l’avons dit, sont d’une rare beauté, et le candélabre sui-
vant, dessiné par Annibal Fontana et qui appartient à la
Chartreuse de Pavie, en est un bel exemple. »
A-t-on bien saisi tous les reproches faits à ces œuvres
auxquelles on veut bien accorder de la beauté et de la
finesse d’exécution, mais dont la composition serait tota-
lement absente ? Ne pourrait-on pas adresser les mêmes
critiques à mainte œuvre du Moyen-Age dont les formes
sont si peu déterminées qu’on pourrait retourner l’objet
et le mettre la tête en bas sans inconvénient? C’est là être
bien sévère, et en somme artistes du Moyen-Age comme
artistes de la Renaissance n’ont souvent vu dans ces beaux
candélabres qu’un canevas commode pour y exécuter les
variations de tout genre que leur suggérait leur talent. Au
surplus, ces objets, d’époques si différentes, présentent au
point de vue de la forme bien des points de ressemblance,
et l’on ne pourrait condamner les uns, dans lesquels on
supprimerait sans inconvénient plusieurs motifs superpo-
sés, sans condamner les autres fort aptes à subir eux aussi
la même opération. Ayons nos préférences, c’est notre
droit, mais gardons-nous de condamner la Renaissance
au profit du Moyen-Age et réciproquement. Il n’est pas
nécessaire pour apprécier les uns de rabaisser les autres.
Et, pour ma part, le seul reproche que je ferai à Annibale
Fontana c’est de ne s’être peut-être pas montré très origi-
nal : la base de son meuble se retrouve dans maint ouvrage
de ses devanciers, à Padoue ou à Venise ; la série des per-
sonnages debout autour du balustre et semblant le sou-
tenir figure déjà dans les beaux candélabres de la basilique
de Saint-Marc, à Venise, exécutés par Olivieri de Brescia
en 1527. Quant au reste, au balustre et à la bobèche,
entourés de feuillages, ils sont à tout le monde ; c’est de
la décoration dans le domaine public, banale et qu’il
appartient à un homme de talent de renouveler et de
vivifier quand il y touche. Fontana n’y a point manqué et
son habileté à composer lui a permis de donner un regain
de jeunesse à un lieu commun artistique.
Emile M o l 1 n 1 e r .
L'ART.
Riccio est beaucoup plus grand et plus beau, il est vrai, et
peut rivaliser de grandeur avec les belles-œuvres de fonte
du Moyen-Age, telles que le candélabre de la cathédrale
de Milan, celui de Reims, celui de Brunswick, etc. Mais
c’est là une exception, et c’est généralement de la taille
d’un homme ordinaire, ou un peu supérieurs à cette taille,
que sont les flambeaux destinés à être placés en avant de
l’autel.
Nous dirons tout à l’heure un mot de la composition
du candélabre de Fontana ; mais nous pensons qu’il n'est
pas déplacé de mettre sous les yeux du lecteur, ne fût-ce
qu’à titre de curiosité, les critiques que ces œuvres ont
inspirées à un homme de beaucoup de goût, Didron, qui
a rendu de grands services à l’archéologie, mais chez
lequel un amour trop exclusif du Moyen-Age avait un
peu émousséie jugement artistique. On verra que la plu-
part des reproches que l’on fait à ces monuments pour-
raient tout aussi justement être appliqués à des œuvres du
Moyen-Age, et je doute que ce verdict — rendu en 185g
— soit ratifié par la génération présente.
Voici ce que disait Didron 1 : « Si ces chandeliers n’af-
fectaient pas ordinairement la forme pyramidale ou décrois-
sante de la base au sommet, on pourrait les retourner
sans inconvénient, les asseoir sur le plateau de la bobèche
et leur planter entre les trois griffes la pointe à recevoir le
cierge. L’ensemble en est défectueux, assurément; mais
les détails en sont exécutés avec un goût très délicat ;
comme le chandelier précédent en terre cuite (il s’agit
d’un flambeau en faïence de Saint-Porchaire) et les sui-
vants en bronze le prouvent. Il fallait donc offrir ces
exemples. D'ailleurs il existe un assez grand nombre
d’édifices de la Renaissance, et, partisan de l’harmonie
des styles dans l’ameublement et la décoration comme
dans l’architecture des monuments, je conseillerai tou- !
jours de placer des chandeliers du xvie siècle sur un autel
et dans une église du xvie siècle. »
« Dans ses lettres sur « le Rhin », M. Victor Hugo
décrit ainsi l’architecture rococo du clocher de Givet :
« Le brave architecte a pris un bonnet carré de prêtre ou
« d’avocat; sur ce bonnet carré il a échafaudé un saladier
« renversé; sur le fond de ce saladier, devenu plate-forme,
« il a posé un sucrier ; sur le sucrier, une bouteille, sur la
« bouteille, etc. » Les chandeliers de la Renaissance, il
faut le dire, se composent de parties détachées qui s’em-
brochent de cette façon : bonnet rond ou carré, marmite,
soupière, saladier, pot à eau, carafe, bouteille, le tout
séparé par des plats et des assiettes pour former des mou-
lures. C’est comme une série de vertèbres, toutes variées,
il est vrai, mais similaires et qui se superposent à peu
près sans ordre ni raison : toutes pièces de rapport indé-
pendantes les unes des autres et retenues seulement par j
une barre de fer intérieure. Le chandelier du Moyen-Age,
1. Annales archéologiques, tome XIX.
au contraire, est comme une plante qui s’enracine en
terre, en sort par son pied, monte au-dessus du sol par sa
tige, que des nœuds consolident de distance en distance,
et qui s’épanouit en l’air par son plateau comme s’épanouit
une fleur. Le chandelier de la Renaissance n’est qu’une
superposition de pièces étrangères les unes aux autres;
celui du Moyen-Age est une végétation et presque un être
organisé, dont chaque partie procède de la précédente et
engendre la suivante. Du reste, ce défaut capital, la
Renaissance l’a pris à l’antiquité, car les grands candélabres
grecs ou romains que nous possédons dans nos musées ne
se composent ainsi que de morceaux différents qui s’éta-
gent l’un sur l’autre et qu’on pourrait déplacer, même
supprimer sans inconvénient. Mais ces morceaux, nous
l’avons dit, sont d’une rare beauté, et le candélabre sui-
vant, dessiné par Annibal Fontana et qui appartient à la
Chartreuse de Pavie, en est un bel exemple. »
A-t-on bien saisi tous les reproches faits à ces œuvres
auxquelles on veut bien accorder de la beauté et de la
finesse d’exécution, mais dont la composition serait tota-
lement absente ? Ne pourrait-on pas adresser les mêmes
critiques à mainte œuvre du Moyen-Age dont les formes
sont si peu déterminées qu’on pourrait retourner l’objet
et le mettre la tête en bas sans inconvénient? C’est là être
bien sévère, et en somme artistes du Moyen-Age comme
artistes de la Renaissance n’ont souvent vu dans ces beaux
candélabres qu’un canevas commode pour y exécuter les
variations de tout genre que leur suggérait leur talent. Au
surplus, ces objets, d’époques si différentes, présentent au
point de vue de la forme bien des points de ressemblance,
et l’on ne pourrait condamner les uns, dans lesquels on
supprimerait sans inconvénient plusieurs motifs superpo-
sés, sans condamner les autres fort aptes à subir eux aussi
la même opération. Ayons nos préférences, c’est notre
droit, mais gardons-nous de condamner la Renaissance
au profit du Moyen-Age et réciproquement. Il n’est pas
nécessaire pour apprécier les uns de rabaisser les autres.
Et, pour ma part, le seul reproche que je ferai à Annibale
Fontana c’est de ne s’être peut-être pas montré très origi-
nal : la base de son meuble se retrouve dans maint ouvrage
de ses devanciers, à Padoue ou à Venise ; la série des per-
sonnages debout autour du balustre et semblant le sou-
tenir figure déjà dans les beaux candélabres de la basilique
de Saint-Marc, à Venise, exécutés par Olivieri de Brescia
en 1527. Quant au reste, au balustre et à la bobèche,
entourés de feuillages, ils sont à tout le monde ; c’est de
la décoration dans le domaine public, banale et qu’il
appartient à un homme de talent de renouveler et de
vivifier quand il y touche. Fontana n’y a point manqué et
son habileté à composer lui a permis de donner un regain
de jeunesse à un lieu commun artistique.
Emile M o l 1 n 1 e r .