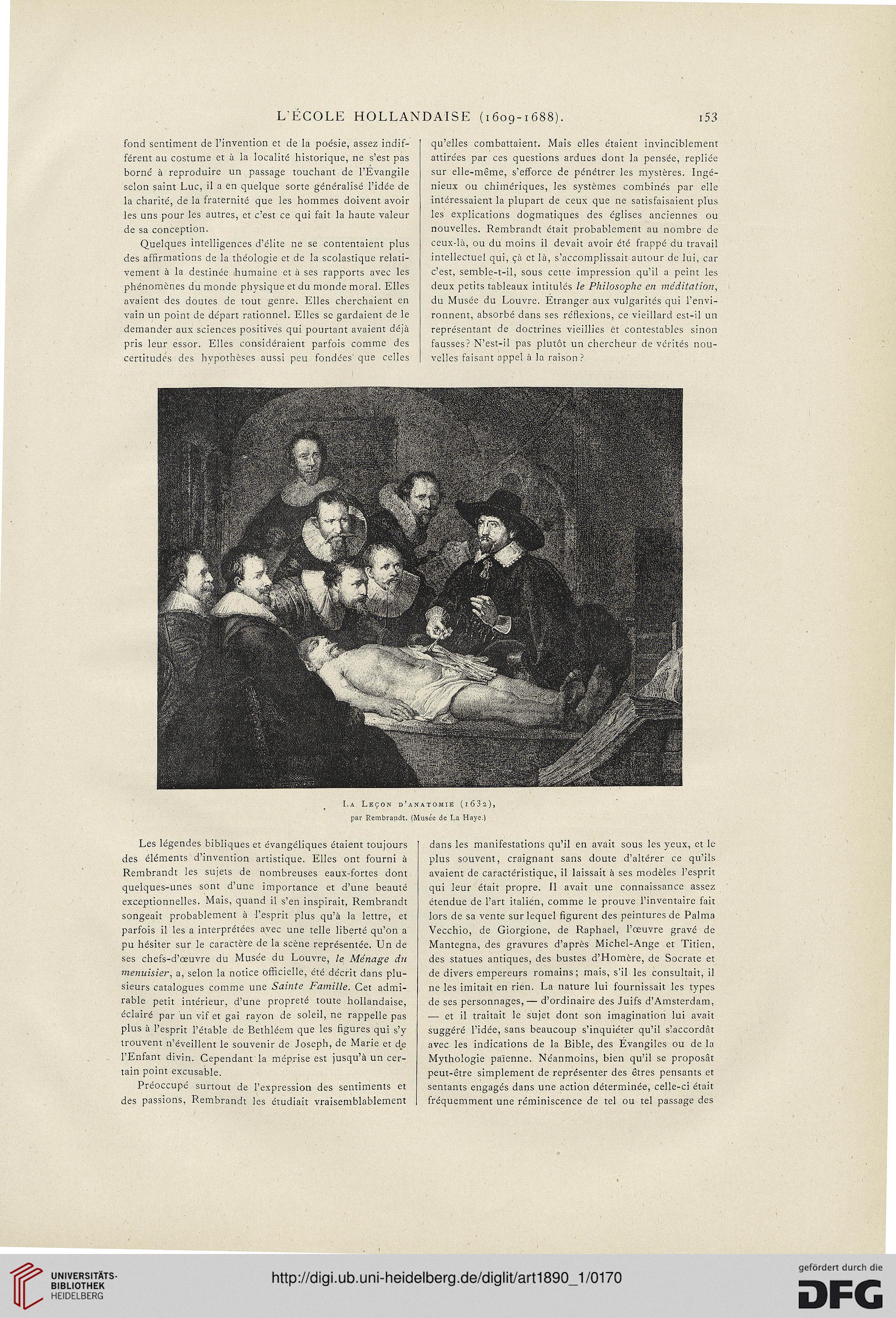L’ECOLE HOLLANDAISE (1609-1688).
153
fond sentiment de l’invention et de la poésie, assez indif-
férent au costume et à la localité historique, ne s’est pas
borné à reproduire un passage touchant de l’Evangile
selon saint Luc, il a en quelque sorte généralisé l’idée de
la charité, de la fraternité que les hommes doivent avoir
les uns pour les autres, et c’est ce qui fait la haute valeur
de sa conception.
Quelques intelligences d’élite ne se contentaient plus
des affirmations de la théologie et de la scolastique relati-
vement à la destinée ihumaine et à ses rapports avec les
phénomènes du monde physique et du monde moral. Elles
avaient des doutes de tout genre. Elles cherchaient en
vain un point de départ rationnel. Elles se gardaient de le
demander aux sciences positives qui pourtant avaient déjà
pris leur essor. Elles considéraient parfois comme des
certitudes des hypothèses aussi peu fondées' que celles
qu’elles combattaient. Mais elles étaient invinciblement
attirées par ces questions ardues dont la pensée, repliée
sur elle-même, s’efforce de pénétrer les mystères. Ingé-
nieux ou chimériques, les systèmes combinés par elle
intéressaient la plupart de ceux que ne satisfaisaient plus
les explications dogmatiques des églises anciennes ou
nouvelles. Rembrandt était probablement au nombre de
ceux-là, ou du moins il devait avoir été frappé du travail
intellectuel qui, çà et là, s’accomplissait autour de lui, car
c’est, semble-t-il, sous cette impression qu’il a peint les
deux petits tableaux intitulés le Philosophe en méditation,
du Musée du Louvre. Etranger aux vulgarités qui l’envi-
ronnent, absorbé dans ses réflexions, ce vieillard est-il un
représentant de doctrines vieillies et contestables sinon
fausses? N’est-il pas plutôt un chercheur de vérités nou-
velles faisant appel à la raison?
I.a Leçon d’anatomie ( i 6 3 2.),
par Rembrandt. (Musée de La Haye.)
Les légendes bibliques et évangéliques étaient toujours
des éléments d’invention artistique. Elles ont fourni à
Rembrandt les sujets de nombreuses eaux-fortes dont
quelques-unes sont d’une importance et d’une beauté
exceptionnelles. Mais, quand il s’en inspirait, Rembrandt
songeait probablement à l’esprit plus qu’à la lettre, et
parfois il les a interprétées avec une telle liberté qu’on a
pu hésiter sur le caractère de la scène représentée. Un de
ses chefs-d’œuvre du Musée du Louvre, le Ménage du
menuisier, a, selon la notice officielle, été décrit dans plu-
sieurs catalogues comme une Sainte Famille. Cet admi-
rable petit intérieur, d’une propreté toute hollandaise,
éclairé par un vif et gai rayon de soleil, ne rappelle pas
plus à l’esprit l’étable de Bethléem que les figures qui s’y
trouvent n’éveillent le souvenir de Joseph, de Marie et de
l’Enfant divin. Cependant la méprise est jusqu’à un cer-
tain point excusable.
Préoccupé surtout de l’expression des sentiments et
des passions, Rembrandt les étudiait vraisemblablement
dans les manifestations qu’il en avait sous les yeux, et le
plus souvent, craignant sans doute d’altérer ce qu’ils
avaient de caractéristique, il laissait à ses modèles l’esprit
qui leur était propre, fl avait une connaissance assez
étendue de l’art italien, comme le prouve l’inventaire fait
lors de sa vente sur lequel figurent des peintures de Palma
Vecchio, de Giorgione, de Raphaël, l’œuvre gravé de
Mantegna, des gravures d’après Michel-Ange et Titien,
des statues antiques, des bustes d’Homère, de Socrate et
de divers empereurs romains; mais, s’il les consultait, il
ne les imitait en rien. La nature lui fournissait les types
de ses personnages, — d’ordinaire des Juifs d’Amsterdam,
— et il traitait le sujet dont son imagination lui avait
suggéré l’idée, sans beaucoup s’inquiéter qu’il s’,accordât
avec les indications de la Bible, des Evangiles ou de la
Mythologie païenne. Néanmoins, bien qu’il se proposât
peut-être simplement de représenter des êtres pensants et
sentants engagés dans une action déterminée, celle-ci était
fréquemment une réminiscence de tel ou tel passage des
153
fond sentiment de l’invention et de la poésie, assez indif-
férent au costume et à la localité historique, ne s’est pas
borné à reproduire un passage touchant de l’Evangile
selon saint Luc, il a en quelque sorte généralisé l’idée de
la charité, de la fraternité que les hommes doivent avoir
les uns pour les autres, et c’est ce qui fait la haute valeur
de sa conception.
Quelques intelligences d’élite ne se contentaient plus
des affirmations de la théologie et de la scolastique relati-
vement à la destinée ihumaine et à ses rapports avec les
phénomènes du monde physique et du monde moral. Elles
avaient des doutes de tout genre. Elles cherchaient en
vain un point de départ rationnel. Elles se gardaient de le
demander aux sciences positives qui pourtant avaient déjà
pris leur essor. Elles considéraient parfois comme des
certitudes des hypothèses aussi peu fondées' que celles
qu’elles combattaient. Mais elles étaient invinciblement
attirées par ces questions ardues dont la pensée, repliée
sur elle-même, s’efforce de pénétrer les mystères. Ingé-
nieux ou chimériques, les systèmes combinés par elle
intéressaient la plupart de ceux que ne satisfaisaient plus
les explications dogmatiques des églises anciennes ou
nouvelles. Rembrandt était probablement au nombre de
ceux-là, ou du moins il devait avoir été frappé du travail
intellectuel qui, çà et là, s’accomplissait autour de lui, car
c’est, semble-t-il, sous cette impression qu’il a peint les
deux petits tableaux intitulés le Philosophe en méditation,
du Musée du Louvre. Etranger aux vulgarités qui l’envi-
ronnent, absorbé dans ses réflexions, ce vieillard est-il un
représentant de doctrines vieillies et contestables sinon
fausses? N’est-il pas plutôt un chercheur de vérités nou-
velles faisant appel à la raison?
I.a Leçon d’anatomie ( i 6 3 2.),
par Rembrandt. (Musée de La Haye.)
Les légendes bibliques et évangéliques étaient toujours
des éléments d’invention artistique. Elles ont fourni à
Rembrandt les sujets de nombreuses eaux-fortes dont
quelques-unes sont d’une importance et d’une beauté
exceptionnelles. Mais, quand il s’en inspirait, Rembrandt
songeait probablement à l’esprit plus qu’à la lettre, et
parfois il les a interprétées avec une telle liberté qu’on a
pu hésiter sur le caractère de la scène représentée. Un de
ses chefs-d’œuvre du Musée du Louvre, le Ménage du
menuisier, a, selon la notice officielle, été décrit dans plu-
sieurs catalogues comme une Sainte Famille. Cet admi-
rable petit intérieur, d’une propreté toute hollandaise,
éclairé par un vif et gai rayon de soleil, ne rappelle pas
plus à l’esprit l’étable de Bethléem que les figures qui s’y
trouvent n’éveillent le souvenir de Joseph, de Marie et de
l’Enfant divin. Cependant la méprise est jusqu’à un cer-
tain point excusable.
Préoccupé surtout de l’expression des sentiments et
des passions, Rembrandt les étudiait vraisemblablement
dans les manifestations qu’il en avait sous les yeux, et le
plus souvent, craignant sans doute d’altérer ce qu’ils
avaient de caractéristique, il laissait à ses modèles l’esprit
qui leur était propre, fl avait une connaissance assez
étendue de l’art italien, comme le prouve l’inventaire fait
lors de sa vente sur lequel figurent des peintures de Palma
Vecchio, de Giorgione, de Raphaël, l’œuvre gravé de
Mantegna, des gravures d’après Michel-Ange et Titien,
des statues antiques, des bustes d’Homère, de Socrate et
de divers empereurs romains; mais, s’il les consultait, il
ne les imitait en rien. La nature lui fournissait les types
de ses personnages, — d’ordinaire des Juifs d’Amsterdam,
— et il traitait le sujet dont son imagination lui avait
suggéré l’idée, sans beaucoup s’inquiéter qu’il s’,accordât
avec les indications de la Bible, des Evangiles ou de la
Mythologie païenne. Néanmoins, bien qu’il se proposât
peut-être simplement de représenter des êtres pensants et
sentants engagés dans une action déterminée, celle-ci était
fréquemment une réminiscence de tel ou tel passage des