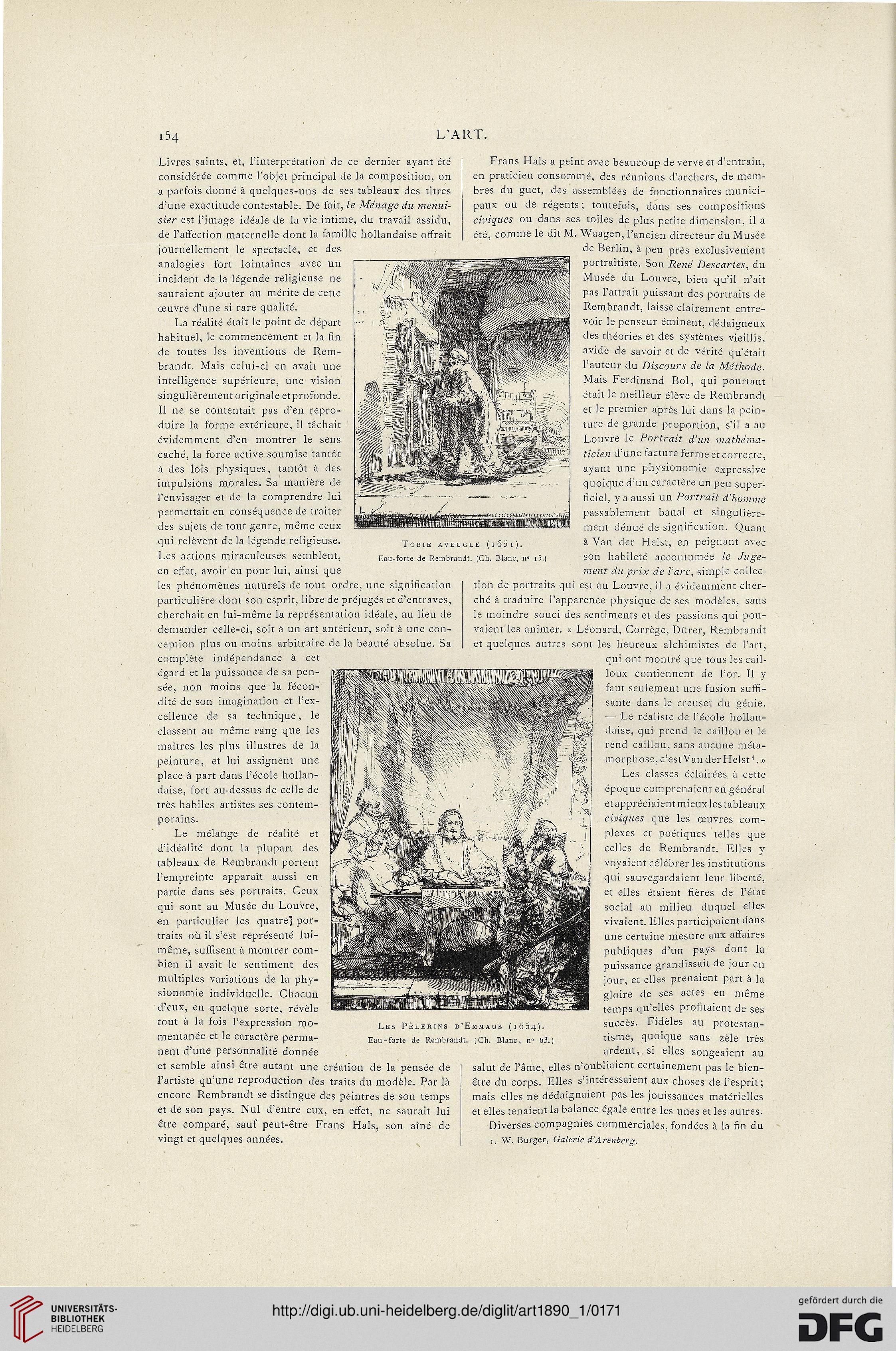154
L'ART.
Livres saints, et, l’interprétation de ce dernier ayant été
considérée comme l’objet principal de la composition, on
a parfois donné à quelques-uns de ses tableaux des titres
d’une exactitude contestable. De fait, le Ménage du menui-
sier est l’image idéale de la vie intime, du travail assidu,
de l’affection maternelle dont la famille hollandaise offrait
journellement le spectacle, et des
analogies fort lointaines avec un
incident de la légende religieuse ne
sauraient ajouter au mérite de cette
oeuvre d’une si rare qualité.
La réalité était le point de départ
habituel, le commencement et la fin
de toutes les inventions de Rem-
brandt. Mais celui-ci en avait une
intelligence supérieure, une vision
singulièrement originale etprofonde.
Il ne se contentait pas d’en repro-
duire la forme extérieure, il tâchait
évidemment d’en montrer le sens
caché, la force active soumise tantôt
à des lois physiques, tantôt à des
impulsions morales. Sa manière de
l’envisager et de la comprendre lui
permettait en conséquence de traiter
des sujets de tout genre, meme ceux
qui relèvent delà légende religieuse.
Les actions miraculeuses semblent,
en effet, avoir eu pour lui, ainsi que
les phénomènes naturels de tout ordre, une signification
particulière dont son esprit, libre de préjugés et d’entraves,
cherchait en lui-même la représentation idéale, au lieu de
demander celle-ci, soit à un art antérieur, soit à une con-
ception plus ou moins arbitraire de la beauté absolue. Sa
complète indépendance à cet
égard et la puissance de sa pen-
sée, non moins que la fécon-
dité de son imagination et l’ex-
cellence de sa technique, le
classent au même rang que les
maîtres les plus illustres de la
peinture, et lui assignent une
place à part dans l’école hollan-
daise, fort au-dessus de celle de
très habiles artistes ses contem-
porains.
Le mélange de réalité et
d’idéalité dont la plupart des
tableaux de Rembrandt portent
l’empreinte apparaît aussi en
partie dans ses portraits. Ceux
qui sont au Musée du Louvre,
en particulier les quatre] por-
traits où il s’est représenté lui-
même, suffisent à montrer com-
bien il avait le sentiment des
multiples variations de la phy-
sionomie individuelle. Chacun
d’eux, en quelque sorte, révèle
tout à la fois l’expression mo-
mentanée et le caractère perma-
nent d'une personnalité donnée
et semble ainsi etre autant une création de la pensée de
l’artiste qu’une reproduction des traits du modèle. Par là
encore Rembrandt se distingue des peintres de son temps
et de son pays. Nul d’entre eux, en effet, ne saurait lui
être comparé, sauf peut-être Frans Hais, son aîné de
vingt et quelques années.
Tobie aveugle ( i6 5 i ).
Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 15.)
Les Pèlerins d’Emma its (1654).
Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 63.)
Frans Hais a peint avec beaucoup de verve et d’entrain,
en praticien consommé, des réunions d’archers, de mem-
bres du guet, des assemblées de fonctionnaires munici-
paux ou de régents; toutefois, dans ses compositions
civiques ou dans ses toiles de plus petite dimension, il a
été, comme le dit M. Waagen, l’ancien directeur du Musée
de Berlin, à peu près exclusivement
portraitiste. Son René Descaries, du
Musée du Louvre, bien qu’il n’ait
pas l’attrait puissant des portraits de
Rembrandt, laisse clairement entre-
voir le penseur éminent, dédaigneux
des théories et des systèmes vieillis,
avide de savoir et de vérité qu'était
l’auteur du Discours de la Méthode.
Mais Ferdinand Bol, qui pourtant
était le meilleur élève de Rembrandt
et le premier après lui dans la pein-
ture de grande proportion, s’il a au
Louvre le Portrait d’un mathéma-
ticien d’une facture ferme et correcte,
ayant une physionomie expressive
quoique d’un caractère un peu super-
ficiel, y a aussi un Portrait d’homme
passablement banal et singulière-
ment dénué de signification. Quant
à Van der Helst, en peignant avec
son habileté accoutumée le Juge-
ment du prix de l’arc, simple collec-
tion de portraits qui est au Louvre, il a évidemment cher-
ché à traduire l’apparence physique de ses modèles, sans
le moindre souci des sentiments et des passions qui pou-
vaient les animer. « Léonard, Corrège, Dürer, Rembrandt
et quelques autres sont les heureux alchimistes de l’art,
qui ont montré que tous les cail-
loux contiennent de l’or. Il y
faut seulement une fusion suffi-
sante dans le creuset du génie.
— Le réaliste de l’école hollan-
daise, qui prend le caillou et le
rend caillou, sans aucune méta-
morphose, c’est Van der Helst L »
Les classes éclairées à cette
époque comprenaient en général
et appréciaient mieux les tableaux
civiques que les œuvres com-
plexes et poétiques telles que
celles de Rembrandt. Elles y
voyaient célébrer les institutions
qui sauvegardaient leur liberté,
et elles étaient fières de l’état
social au milieu duquel elles
vivaient. Elles participaient dans
une certaine mesure aux affaires
publiques d’un pays dont la
puissance grandissait de jour en
jour, et elles prenaient part à la
gloire de ses actes en même
temps qu’elles profitaient de ses
succès. Fidèles au protestan-
tisme, quoique sans zèle très
ardent, si elles songeaient au
salut de l’âme, elles n’oubliaient certainement pas le bien-
être du corps. Elles s’intéressaient aux choses de l’esprit;
mais elles ne dédaignaient pas les jouissances matérielles
et elles tenaient la balance égale entre les unes et les autres.
Diverses compagnies commerciales, fondées à la fin du
i. W. Burger, Galerie d'Arenberg.
L'ART.
Livres saints, et, l’interprétation de ce dernier ayant été
considérée comme l’objet principal de la composition, on
a parfois donné à quelques-uns de ses tableaux des titres
d’une exactitude contestable. De fait, le Ménage du menui-
sier est l’image idéale de la vie intime, du travail assidu,
de l’affection maternelle dont la famille hollandaise offrait
journellement le spectacle, et des
analogies fort lointaines avec un
incident de la légende religieuse ne
sauraient ajouter au mérite de cette
oeuvre d’une si rare qualité.
La réalité était le point de départ
habituel, le commencement et la fin
de toutes les inventions de Rem-
brandt. Mais celui-ci en avait une
intelligence supérieure, une vision
singulièrement originale etprofonde.
Il ne se contentait pas d’en repro-
duire la forme extérieure, il tâchait
évidemment d’en montrer le sens
caché, la force active soumise tantôt
à des lois physiques, tantôt à des
impulsions morales. Sa manière de
l’envisager et de la comprendre lui
permettait en conséquence de traiter
des sujets de tout genre, meme ceux
qui relèvent delà légende religieuse.
Les actions miraculeuses semblent,
en effet, avoir eu pour lui, ainsi que
les phénomènes naturels de tout ordre, une signification
particulière dont son esprit, libre de préjugés et d’entraves,
cherchait en lui-même la représentation idéale, au lieu de
demander celle-ci, soit à un art antérieur, soit à une con-
ception plus ou moins arbitraire de la beauté absolue. Sa
complète indépendance à cet
égard et la puissance de sa pen-
sée, non moins que la fécon-
dité de son imagination et l’ex-
cellence de sa technique, le
classent au même rang que les
maîtres les plus illustres de la
peinture, et lui assignent une
place à part dans l’école hollan-
daise, fort au-dessus de celle de
très habiles artistes ses contem-
porains.
Le mélange de réalité et
d’idéalité dont la plupart des
tableaux de Rembrandt portent
l’empreinte apparaît aussi en
partie dans ses portraits. Ceux
qui sont au Musée du Louvre,
en particulier les quatre] por-
traits où il s’est représenté lui-
même, suffisent à montrer com-
bien il avait le sentiment des
multiples variations de la phy-
sionomie individuelle. Chacun
d’eux, en quelque sorte, révèle
tout à la fois l’expression mo-
mentanée et le caractère perma-
nent d'une personnalité donnée
et semble ainsi etre autant une création de la pensée de
l’artiste qu’une reproduction des traits du modèle. Par là
encore Rembrandt se distingue des peintres de son temps
et de son pays. Nul d’entre eux, en effet, ne saurait lui
être comparé, sauf peut-être Frans Hais, son aîné de
vingt et quelques années.
Tobie aveugle ( i6 5 i ).
Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 15.)
Les Pèlerins d’Emma its (1654).
Eau-forte de Rembrandt. (Ch. Blanc, n° 63.)
Frans Hais a peint avec beaucoup de verve et d’entrain,
en praticien consommé, des réunions d’archers, de mem-
bres du guet, des assemblées de fonctionnaires munici-
paux ou de régents; toutefois, dans ses compositions
civiques ou dans ses toiles de plus petite dimension, il a
été, comme le dit M. Waagen, l’ancien directeur du Musée
de Berlin, à peu près exclusivement
portraitiste. Son René Descaries, du
Musée du Louvre, bien qu’il n’ait
pas l’attrait puissant des portraits de
Rembrandt, laisse clairement entre-
voir le penseur éminent, dédaigneux
des théories et des systèmes vieillis,
avide de savoir et de vérité qu'était
l’auteur du Discours de la Méthode.
Mais Ferdinand Bol, qui pourtant
était le meilleur élève de Rembrandt
et le premier après lui dans la pein-
ture de grande proportion, s’il a au
Louvre le Portrait d’un mathéma-
ticien d’une facture ferme et correcte,
ayant une physionomie expressive
quoique d’un caractère un peu super-
ficiel, y a aussi un Portrait d’homme
passablement banal et singulière-
ment dénué de signification. Quant
à Van der Helst, en peignant avec
son habileté accoutumée le Juge-
ment du prix de l’arc, simple collec-
tion de portraits qui est au Louvre, il a évidemment cher-
ché à traduire l’apparence physique de ses modèles, sans
le moindre souci des sentiments et des passions qui pou-
vaient les animer. « Léonard, Corrège, Dürer, Rembrandt
et quelques autres sont les heureux alchimistes de l’art,
qui ont montré que tous les cail-
loux contiennent de l’or. Il y
faut seulement une fusion suffi-
sante dans le creuset du génie.
— Le réaliste de l’école hollan-
daise, qui prend le caillou et le
rend caillou, sans aucune méta-
morphose, c’est Van der Helst L »
Les classes éclairées à cette
époque comprenaient en général
et appréciaient mieux les tableaux
civiques que les œuvres com-
plexes et poétiques telles que
celles de Rembrandt. Elles y
voyaient célébrer les institutions
qui sauvegardaient leur liberté,
et elles étaient fières de l’état
social au milieu duquel elles
vivaient. Elles participaient dans
une certaine mesure aux affaires
publiques d’un pays dont la
puissance grandissait de jour en
jour, et elles prenaient part à la
gloire de ses actes en même
temps qu’elles profitaient de ses
succès. Fidèles au protestan-
tisme, quoique sans zèle très
ardent, si elles songeaient au
salut de l’âme, elles n’oubliaient certainement pas le bien-
être du corps. Elles s’intéressaient aux choses de l’esprit;
mais elles ne dédaignaient pas les jouissances matérielles
et elles tenaient la balance égale entre les unes et les autres.
Diverses compagnies commerciales, fondées à la fin du
i. W. Burger, Galerie d'Arenberg.