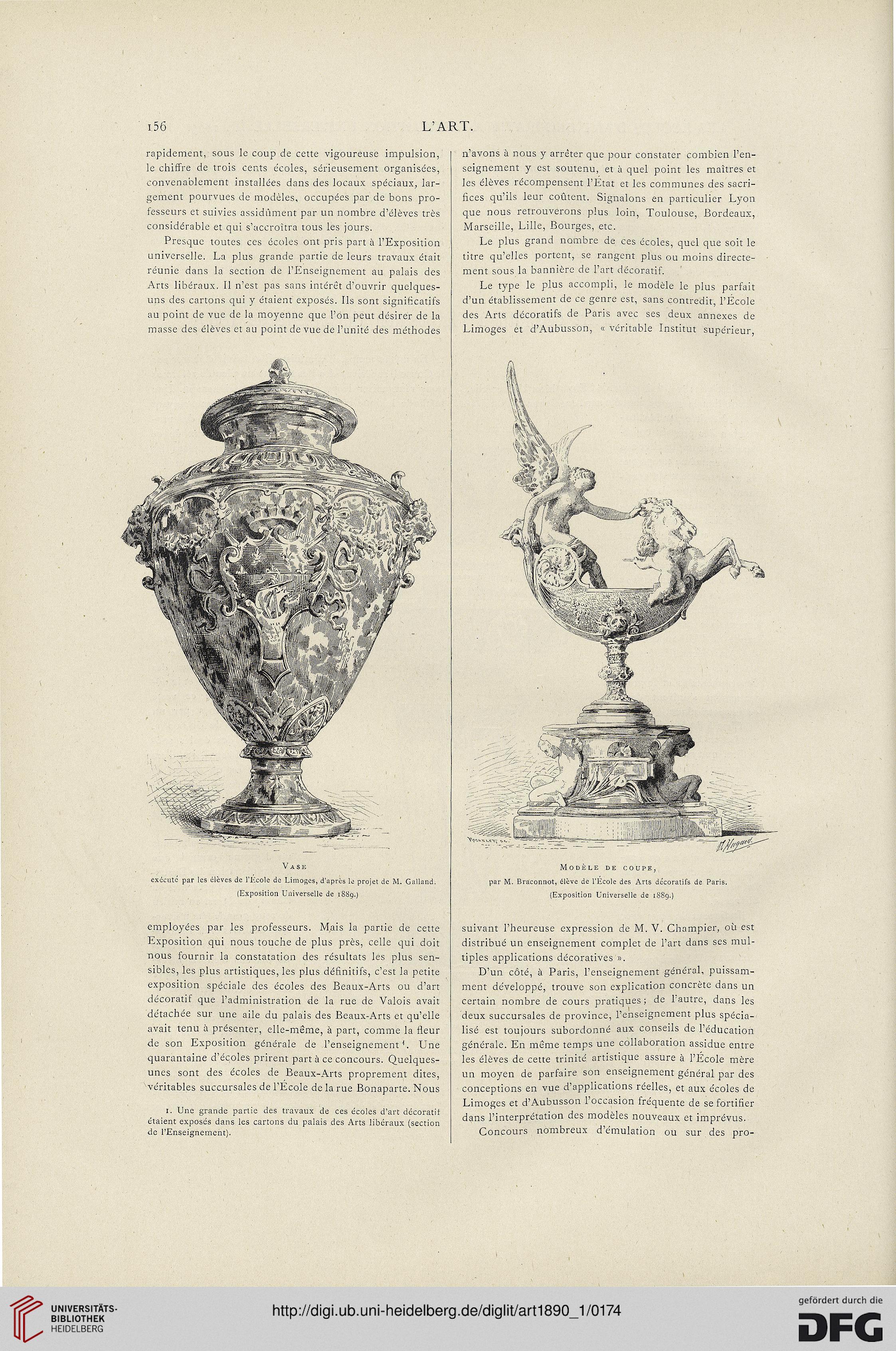156
L’ART.
rapidement, sous le coup de cette vigoureuse impulsion,
le chiffre de trois cents e'coles, sérieusement organisées,
convenablement installées dans des locaux spéciaux, lar-
gement pourvues de modèles, occupées par de bons pro-
fesseurs et suivies assidûment par un nombre d’élèves très
considérable et qui s’accroîtra tous les jours.
Presque toutes ces écoles ont pris part à l’Exposition
universelle. La plus grande partie de leurs travaux était
réunie dans la section de l’Enseignement au palais des
Arts libéraux. Il n’est pas sans intérêt d’ouvrir quelques-
uns des cartons qui y étaient exposés. Ils sont significatifs
au point de vue de la moyenne que l’on peut désirer de la
masse des élèves et au point de vue de l’unité des méthodes
n’avons à nous y arrêter que pour constater combien l’en-
seignement y est soutenu, et à quel point les maîtres et
les élèves récompensent l’État et les communes des sacri-
fices qu’ils leur coûtent. Signalons en particulier Lyon
que nous retrouverons plus loin, Toulouse, Bordeaux,
Marseille, Lille, Bourges, etc.
Le plus grand nombre de ces écoles, quel que soit le
titre qu’elles portent, se rangent plus ou moins directe-
ment sous la bannière de l’art décoratif.
Le type le plus accompli, le modèle le plus parfait
d’un établissement de ce genre est, sans contredit, l’École
des Arts décoratifs de Paris avec ses deux annexes de
Limoges et d’Aubusson, « véritable Institut supérieur,
Vase
exécute par les élèves de l'Ecole de Limoges, d’après le projet de M. Galland.
(Exposition Universelle de iS8g.)
Modèle de coupe,
par M. Braconnot, élève de l'École des Arts décoratifs de Paris.
(Exposition Universelle de 1889.)
employées par les professeurs. Mais la partie de cette
Exposition qui nous touche de plus près, celle qui doit
nous fournir la constatation des résultats les plus sen-
sibles, les plus artistiques, les plus définitifs, c’est la petite
exposition spéciale des écoles des Beaux-Arts ou d’art
décoratif que l’administration de la rue de Valois avait
détachée sur une aile du palais des Beaux-Arts et qu’elle
avait tenu à présenter, elle-même, à part, comme la fleur
de son Exposition générale de l’enseignement1. Une
quarantaine d’écoles prirent part à ce concours. Quelques-
unes sont des écoles de Beaux-Arts proprement dites,
véritables succursales de l’École de la rue Bonaparte. Nous
1. Une grande partie des travaux de ces écoles d’art décoratif
étaient exposés dans les cartons du palais des Arts libéraux (section
de l’Enseignement).
suivant l’heureuse expression de M. V. Champier, où est
distribué un enseignement complet de l’art dans ses mul-
tiples applications décoratives ».
D’un côté, à Paris, l’enseignement général, puissam-
ment développé, trouve son explication concrète dans un
certain nombre de cours pratiques; de l'autre, dans les
deux succursales de province, l’enseignement plus spécia-
lisé est toujours subordonné aux conseils de l’éducation
générale. En même temps une collaboration assidue entre
les élèves de cette trinité artistique assure à l’École mère
un moyen de parfaire son enseignement général par des
conceptions en vue d’applications réelles, et aux écoles de
Limoges et d’Aubusson l’occasion fréquente de se fortifier
dans l’interprétation des modèles nouveaux et imprévus.
Concours nombreux d’émulation ou sur des pro-
L’ART.
rapidement, sous le coup de cette vigoureuse impulsion,
le chiffre de trois cents e'coles, sérieusement organisées,
convenablement installées dans des locaux spéciaux, lar-
gement pourvues de modèles, occupées par de bons pro-
fesseurs et suivies assidûment par un nombre d’élèves très
considérable et qui s’accroîtra tous les jours.
Presque toutes ces écoles ont pris part à l’Exposition
universelle. La plus grande partie de leurs travaux était
réunie dans la section de l’Enseignement au palais des
Arts libéraux. Il n’est pas sans intérêt d’ouvrir quelques-
uns des cartons qui y étaient exposés. Ils sont significatifs
au point de vue de la moyenne que l’on peut désirer de la
masse des élèves et au point de vue de l’unité des méthodes
n’avons à nous y arrêter que pour constater combien l’en-
seignement y est soutenu, et à quel point les maîtres et
les élèves récompensent l’État et les communes des sacri-
fices qu’ils leur coûtent. Signalons en particulier Lyon
que nous retrouverons plus loin, Toulouse, Bordeaux,
Marseille, Lille, Bourges, etc.
Le plus grand nombre de ces écoles, quel que soit le
titre qu’elles portent, se rangent plus ou moins directe-
ment sous la bannière de l’art décoratif.
Le type le plus accompli, le modèle le plus parfait
d’un établissement de ce genre est, sans contredit, l’École
des Arts décoratifs de Paris avec ses deux annexes de
Limoges et d’Aubusson, « véritable Institut supérieur,
Vase
exécute par les élèves de l'Ecole de Limoges, d’après le projet de M. Galland.
(Exposition Universelle de iS8g.)
Modèle de coupe,
par M. Braconnot, élève de l'École des Arts décoratifs de Paris.
(Exposition Universelle de 1889.)
employées par les professeurs. Mais la partie de cette
Exposition qui nous touche de plus près, celle qui doit
nous fournir la constatation des résultats les plus sen-
sibles, les plus artistiques, les plus définitifs, c’est la petite
exposition spéciale des écoles des Beaux-Arts ou d’art
décoratif que l’administration de la rue de Valois avait
détachée sur une aile du palais des Beaux-Arts et qu’elle
avait tenu à présenter, elle-même, à part, comme la fleur
de son Exposition générale de l’enseignement1. Une
quarantaine d’écoles prirent part à ce concours. Quelques-
unes sont des écoles de Beaux-Arts proprement dites,
véritables succursales de l’École de la rue Bonaparte. Nous
1. Une grande partie des travaux de ces écoles d’art décoratif
étaient exposés dans les cartons du palais des Arts libéraux (section
de l’Enseignement).
suivant l’heureuse expression de M. V. Champier, où est
distribué un enseignement complet de l’art dans ses mul-
tiples applications décoratives ».
D’un côté, à Paris, l’enseignement général, puissam-
ment développé, trouve son explication concrète dans un
certain nombre de cours pratiques; de l'autre, dans les
deux succursales de province, l’enseignement plus spécia-
lisé est toujours subordonné aux conseils de l’éducation
générale. En même temps une collaboration assidue entre
les élèves de cette trinité artistique assure à l’École mère
un moyen de parfaire son enseignement général par des
conceptions en vue d’applications réelles, et aux écoles de
Limoges et d’Aubusson l’occasion fréquente de se fortifier
dans l’interprétation des modèles nouveaux et imprévus.
Concours nombreux d’émulation ou sur des pro-