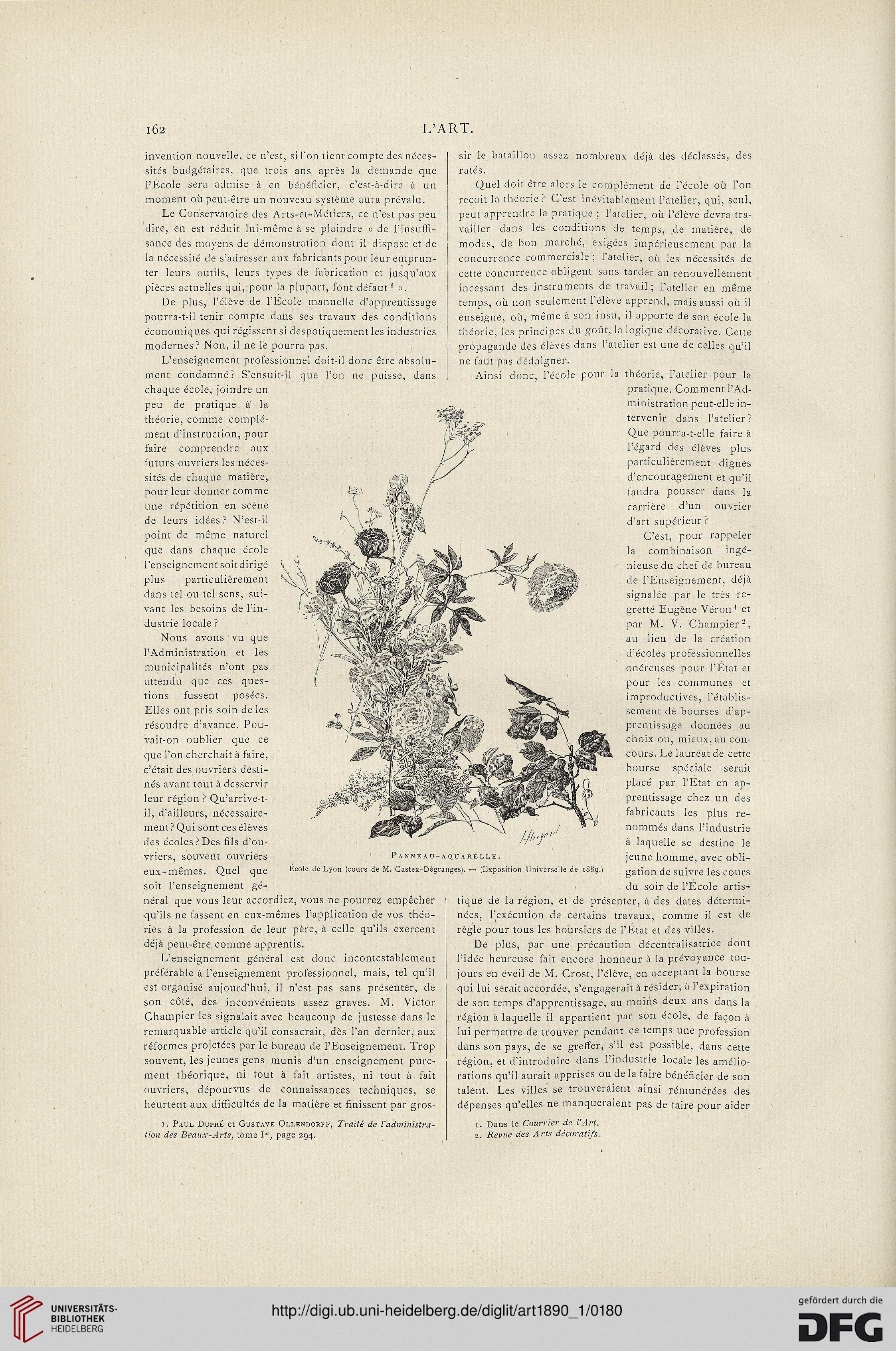IÔ2
L’ART.
invention nouvelle, ce n’est, si l'on tient compte des néces-
sités budgétaires, que trois ans après la demande que
l’École sera admise à en bénéficier, c’est-à-dire à un
moment où peut-être un nouveau système aura prévalu.
Le Conservatoire des Arts-et-Métiers, ce n’est pas peu
dire, en est réduit lui-même à se plaindre « de l’insuffi-
sance des moyens de démonstration dont il dispose et de
la nécessité de s’adresser aux fabricants pour leur emprun-
ter leurs outils, leurs types de fabrication et jusqu’aux
pièces actuelles qui, pour la plupart, font défaut1 ».
De plus, l’élève de l’Ecole manuelle d’apprentissage
pourra-t-il tenir compte dans ses travaux des conditions
économiques qui régissent si despotiquement les industries
modernes? Non, il ne le pourra pas.
L’enseignement professionnel doit-il donc être absolu-
ment condamné? S’ensuit-il que l’on ne puisse, dans
chaque école, joindre un
peu de pratique à la
théorie, comme complé-
ment d’instruction, pour
faire comprendre aux
futurs ouvriers les néces-
sités de chaque matière,
pour leur donner comme
une répétition en scène
de leurs idées? N’est-il
point de même naturel
que dans chaque école
l’enseignement soitdirigé
plus particulièrement
dans tel ou tel sens, sui-
vant les besoins de l’in-
dustrie locale ?
Nous avons vu que
l’Administration et les
municipalités n’ont pas
attendu que ces ques-
tions fussent posées.
Elles ont pris soin de les
résoudre d’avance. Pou-
vait-on oublier que ce
que l’on cherchait à faire,
c’était des ouvriers desti-
nés avant tout à desservir
leur région ? Qu’arrive-t-
il, d’ailleurs, nécessaire-
ment? Qui sont ces élèves
des écoles ? Des fils d’ou-
vriers, souvent ouvriers
eux-mêmes. Quel que
soit l’enseignement gé-
néral que vous leur accordiez, vous ne pourrez empêcher
qu’ils ne fassent en eux-mêmes l’application de vos théo-
ries à la profession de leur père, à celle qu’ils exercent
déjà peut-être comme apprentis.
L’enseignement général est donc incontestablement
préférable à l’enseignement professionnel, mais, tel qu’il
est organisé aujourd’hui, il n’est pas sans présenter, de
son côté, des inconvénients assez graves. M. Victor
Champier les signalait avec beaucoup de justesse dans le
remarquable article qu’il consacrait, dès l’an dernier, aux
réformes projetées par le bureau de l’Enseignement. Trop
souvent, les jeunes gens munis d’un enseignement pure-
ment théorique, ni tout à fait artistes, ni tout à fait
ouvriers, dépourvus de connaissances techniques, se
heurtent aux difficultés de la matière et finissent par gros-
i. Paul Dupré et Gustave Ollendorff, Traité de l’administra-
tion des Beaux-Arts, tome Ior, page 294.
sir le bataillon assez nombreux déjà des déclassés, des
ratés.
Quel doit être alors le complément de l’école où l’on
reçoit la théorie? C’est inévitablement l’atelier, qui, seul,
peut apprendre la pratique ; l’atelier, où l’élève devra tra-
vailler dans les conditions de temps, de matière, de
modes, de bon marché, exigées impérieusement par la
concurrence commerciale ; l'atelier, où les nécessités de
cette concurrence obligent sans tarder au renouvellement
incessant des instruments de travail; l’atelier en même
temps, où non seulement l’élève apprend, mais aussi où il
enseigne, où, même à son insu, il apporte de son école la
théorie, les principes du goût, la logique décorative. Cette
propagande des élèves dans l’atelier est une de celles qu’il
ne faut pas dédaigner.
Ainsi donc, l’école pour la théorie, l’atelier pour la
pratique. Comment l’Ad-
ministration peut-elle in-
tervenir dans l’atelier?
Que pourra-t-elle faire à
l’égard des élèves plus
particulièrement dignes
d’encouragement et qu’il
faudra pousser dans la
carrière d’un ouvrier
d’art supérieur?
C’est, pour rappeler
la combinaison ingé-
nieuse du chef de bureau
de l’Enseignement, déjà
signalée par le très re-
gretté Eugène Véron1 et
par M. V. Champier2,
au lieu de la création
d’écoles professionnelles
onéreuses pour l’Etat et
pour les communes et
improductives, l’établis-
sement de bourses d’ap-
prentissage données au
choix ou, mieux, au con-
cours. Le lauréat de cette
bourse spéciale serait
placé par l’Etat en ap-
prentissage chez un des
fabricants les plus re-
nommés dans l’industrie
à laquelle se destine le
jeune homme, avec obli-
gation de suivre les cours
du soir de l’École artis-
tique de la région, et de présenter, à des dates détermi-
nées, l’exécution de certains travaux, comme il est de
règle pour tous les boursiers de l’État et des villes.
De plus, par une précaution décentralisatrice dont
l’idée heureuse fait encore honneur à la prévoyance tou-
jours en éveil de M. Crost, l’élève, en acceptant la bourse
qui lui serait accordée, s’engagerait à résider, à l’expiration
de son temps d’apprentissage, au moins deux ans dans la
région à laquelle il appartient par son école, de façon à
lui permettre de trouver pendant ce temps une profession
dans son pays, de se greffer, s’il est possible, dans cette
région, et d’introduire dans l’industrie locale les amélio-
rations qu’il aurait apprises ou de la faire bénéficier de son
talent. Les villes se trouveraient ainsi rémunérées des
dépenses qu’elles ne manqueraient pas de faire pour aider
1. Dans le Courrier de l’Art.
2. Revue des Arts décoratifs.
(Mm?
J/if\
Panneau-aquarelle.
École de Lyon (cours de M. Castex-Dégranges). — (Exposition Universelle de 1889.)
L’ART.
invention nouvelle, ce n’est, si l'on tient compte des néces-
sités budgétaires, que trois ans après la demande que
l’École sera admise à en bénéficier, c’est-à-dire à un
moment où peut-être un nouveau système aura prévalu.
Le Conservatoire des Arts-et-Métiers, ce n’est pas peu
dire, en est réduit lui-même à se plaindre « de l’insuffi-
sance des moyens de démonstration dont il dispose et de
la nécessité de s’adresser aux fabricants pour leur emprun-
ter leurs outils, leurs types de fabrication et jusqu’aux
pièces actuelles qui, pour la plupart, font défaut1 ».
De plus, l’élève de l’Ecole manuelle d’apprentissage
pourra-t-il tenir compte dans ses travaux des conditions
économiques qui régissent si despotiquement les industries
modernes? Non, il ne le pourra pas.
L’enseignement professionnel doit-il donc être absolu-
ment condamné? S’ensuit-il que l’on ne puisse, dans
chaque école, joindre un
peu de pratique à la
théorie, comme complé-
ment d’instruction, pour
faire comprendre aux
futurs ouvriers les néces-
sités de chaque matière,
pour leur donner comme
une répétition en scène
de leurs idées? N’est-il
point de même naturel
que dans chaque école
l’enseignement soitdirigé
plus particulièrement
dans tel ou tel sens, sui-
vant les besoins de l’in-
dustrie locale ?
Nous avons vu que
l’Administration et les
municipalités n’ont pas
attendu que ces ques-
tions fussent posées.
Elles ont pris soin de les
résoudre d’avance. Pou-
vait-on oublier que ce
que l’on cherchait à faire,
c’était des ouvriers desti-
nés avant tout à desservir
leur région ? Qu’arrive-t-
il, d’ailleurs, nécessaire-
ment? Qui sont ces élèves
des écoles ? Des fils d’ou-
vriers, souvent ouvriers
eux-mêmes. Quel que
soit l’enseignement gé-
néral que vous leur accordiez, vous ne pourrez empêcher
qu’ils ne fassent en eux-mêmes l’application de vos théo-
ries à la profession de leur père, à celle qu’ils exercent
déjà peut-être comme apprentis.
L’enseignement général est donc incontestablement
préférable à l’enseignement professionnel, mais, tel qu’il
est organisé aujourd’hui, il n’est pas sans présenter, de
son côté, des inconvénients assez graves. M. Victor
Champier les signalait avec beaucoup de justesse dans le
remarquable article qu’il consacrait, dès l’an dernier, aux
réformes projetées par le bureau de l’Enseignement. Trop
souvent, les jeunes gens munis d’un enseignement pure-
ment théorique, ni tout à fait artistes, ni tout à fait
ouvriers, dépourvus de connaissances techniques, se
heurtent aux difficultés de la matière et finissent par gros-
i. Paul Dupré et Gustave Ollendorff, Traité de l’administra-
tion des Beaux-Arts, tome Ior, page 294.
sir le bataillon assez nombreux déjà des déclassés, des
ratés.
Quel doit être alors le complément de l’école où l’on
reçoit la théorie? C’est inévitablement l’atelier, qui, seul,
peut apprendre la pratique ; l’atelier, où l’élève devra tra-
vailler dans les conditions de temps, de matière, de
modes, de bon marché, exigées impérieusement par la
concurrence commerciale ; l'atelier, où les nécessités de
cette concurrence obligent sans tarder au renouvellement
incessant des instruments de travail; l’atelier en même
temps, où non seulement l’élève apprend, mais aussi où il
enseigne, où, même à son insu, il apporte de son école la
théorie, les principes du goût, la logique décorative. Cette
propagande des élèves dans l’atelier est une de celles qu’il
ne faut pas dédaigner.
Ainsi donc, l’école pour la théorie, l’atelier pour la
pratique. Comment l’Ad-
ministration peut-elle in-
tervenir dans l’atelier?
Que pourra-t-elle faire à
l’égard des élèves plus
particulièrement dignes
d’encouragement et qu’il
faudra pousser dans la
carrière d’un ouvrier
d’art supérieur?
C’est, pour rappeler
la combinaison ingé-
nieuse du chef de bureau
de l’Enseignement, déjà
signalée par le très re-
gretté Eugène Véron1 et
par M. V. Champier2,
au lieu de la création
d’écoles professionnelles
onéreuses pour l’Etat et
pour les communes et
improductives, l’établis-
sement de bourses d’ap-
prentissage données au
choix ou, mieux, au con-
cours. Le lauréat de cette
bourse spéciale serait
placé par l’Etat en ap-
prentissage chez un des
fabricants les plus re-
nommés dans l’industrie
à laquelle se destine le
jeune homme, avec obli-
gation de suivre les cours
du soir de l’École artis-
tique de la région, et de présenter, à des dates détermi-
nées, l’exécution de certains travaux, comme il est de
règle pour tous les boursiers de l’État et des villes.
De plus, par une précaution décentralisatrice dont
l’idée heureuse fait encore honneur à la prévoyance tou-
jours en éveil de M. Crost, l’élève, en acceptant la bourse
qui lui serait accordée, s’engagerait à résider, à l’expiration
de son temps d’apprentissage, au moins deux ans dans la
région à laquelle il appartient par son école, de façon à
lui permettre de trouver pendant ce temps une profession
dans son pays, de se greffer, s’il est possible, dans cette
région, et d’introduire dans l’industrie locale les amélio-
rations qu’il aurait apprises ou de la faire bénéficier de son
talent. Les villes se trouveraient ainsi rémunérées des
dépenses qu’elles ne manqueraient pas de faire pour aider
1. Dans le Courrier de l’Art.
2. Revue des Arts décoratifs.
(Mm?
J/if\
Panneau-aquarelle.
École de Lyon (cours de M. Castex-Dégranges). — (Exposition Universelle de 1889.)