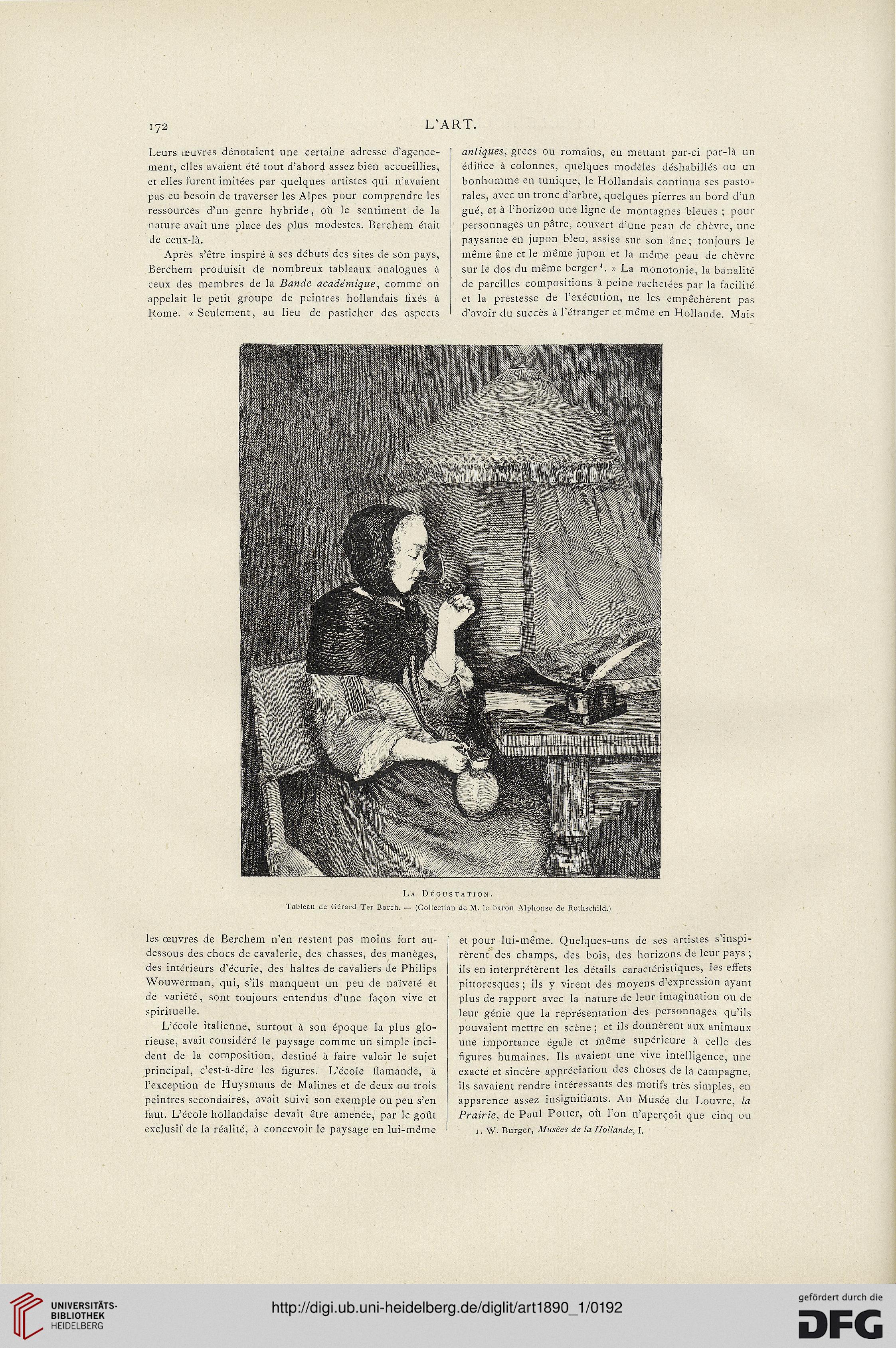172
L’ART.
Leurs œuvres dénotaient une certaine adresse d’agence-
ment, elles avaient été tout d’abord assez bien accueillies,
et elles furent imitées par quelques artistes qui n’avaient
pas eu besoin de traverser les Alpes pour comprendre les
ressources d’un genre hybride, où le sentiment de la
nature avait une place des plus modestes. Berchem était
de ceux-là.
Après s’être inspiré à ses débuts des sites de son pays,
Berchem produisit de nombreux tableaux analogues à
ceux des membres de la Bande académique, comme on
appelait le petit groupe de peintres hollandais fixés à
Rome. « Seulement, au lieu de pasticher des aspects
antiques, grecs ou romains, en mettant par-ci par-là un
édifice à colonnes, quelques modèles déshabillés ou un
bonhomme en tunique, le Hollandais continua ses pasto-
rales, avec un tronc d’arbre, quelques pierres au bord d’un
gué, et à l’horizon une ligne de montagnes bleues ; pour
personnages un pâtre, couvert d’une peau de chèvre, une
paysanne en jupon bleu, assise sur son àne; toujours le
même âne et le même jupon et la même peau de chèvre
sur le dos du même berger L » La monotonie, la banalité
de pareilles compositions à peine rachetées par la facilité
et la prestesse de l’exécution, ne les empêchèrent pas
d’avoir du succès à l’étranger et même en Hollande. Mais
La Dégustation.
Tableau de Gérard Ter Borch. — (Collection de M. le baron Alphonse de Rothschild.)
les œuvres de Berchem n’en restent pas moins fort au-
dessous des chocs de cavalerie, des chasses, des manèges,
des intérieurs d’écurie, des haltes de cavaliers de Philips
Wouwerman, qui, s’ils manquent un peu de na'iveté et
de variété, sont toujours entendus d’une façon vive et
spirituelle.
L’école italienne, surtout à son époque la plus glo-
rieuse, avait considéré le paysage comme un simple inci-
dent de la composition, destiné à faire valoir le sujet
principal, c’est-à-dire les figures. L’école flamande, à
l’exception de Huysmans de Malines et de deux ou trois
peintres secondaires, avait suivi son exemple ou peu s’en
faut. L’école hollandaise devait être amenée, par le goût
exclusif de la réalité, à concevoir le paysage en lui-même I
et pour lui-même. Quelques-uns de ses artistes s’inspi-
rèrent des champs, des bois, des horizons de leur pays ;
ils en interprétèrent les détails caractéristiques, les effets
pittoresques ; ils y virent des moyens d’expression ayant
plus de rapport avec la nature de leur imagination ou de
leur génie que la représentation des personnages qu’ils
pouvaient mettre en scène ; et ils donnèrent aux animaux
une importance égale et même supérieure à celle des
figures humaines. Ils avaient une vive intelligence, une
exacte et sincère appréciation des choses de la campagne,
ils savaient rendre intéressants des motifs très simples, en
apparence assez insignifiants. Au Musée du Louvre, la
Prairie, de Paul Potter, où 1 on n’aperçoit que cinq ou
1. W. Burger, Musées de la Hollande, I.
L’ART.
Leurs œuvres dénotaient une certaine adresse d’agence-
ment, elles avaient été tout d’abord assez bien accueillies,
et elles furent imitées par quelques artistes qui n’avaient
pas eu besoin de traverser les Alpes pour comprendre les
ressources d’un genre hybride, où le sentiment de la
nature avait une place des plus modestes. Berchem était
de ceux-là.
Après s’être inspiré à ses débuts des sites de son pays,
Berchem produisit de nombreux tableaux analogues à
ceux des membres de la Bande académique, comme on
appelait le petit groupe de peintres hollandais fixés à
Rome. « Seulement, au lieu de pasticher des aspects
antiques, grecs ou romains, en mettant par-ci par-là un
édifice à colonnes, quelques modèles déshabillés ou un
bonhomme en tunique, le Hollandais continua ses pasto-
rales, avec un tronc d’arbre, quelques pierres au bord d’un
gué, et à l’horizon une ligne de montagnes bleues ; pour
personnages un pâtre, couvert d’une peau de chèvre, une
paysanne en jupon bleu, assise sur son àne; toujours le
même âne et le même jupon et la même peau de chèvre
sur le dos du même berger L » La monotonie, la banalité
de pareilles compositions à peine rachetées par la facilité
et la prestesse de l’exécution, ne les empêchèrent pas
d’avoir du succès à l’étranger et même en Hollande. Mais
La Dégustation.
Tableau de Gérard Ter Borch. — (Collection de M. le baron Alphonse de Rothschild.)
les œuvres de Berchem n’en restent pas moins fort au-
dessous des chocs de cavalerie, des chasses, des manèges,
des intérieurs d’écurie, des haltes de cavaliers de Philips
Wouwerman, qui, s’ils manquent un peu de na'iveté et
de variété, sont toujours entendus d’une façon vive et
spirituelle.
L’école italienne, surtout à son époque la plus glo-
rieuse, avait considéré le paysage comme un simple inci-
dent de la composition, destiné à faire valoir le sujet
principal, c’est-à-dire les figures. L’école flamande, à
l’exception de Huysmans de Malines et de deux ou trois
peintres secondaires, avait suivi son exemple ou peu s’en
faut. L’école hollandaise devait être amenée, par le goût
exclusif de la réalité, à concevoir le paysage en lui-même I
et pour lui-même. Quelques-uns de ses artistes s’inspi-
rèrent des champs, des bois, des horizons de leur pays ;
ils en interprétèrent les détails caractéristiques, les effets
pittoresques ; ils y virent des moyens d’expression ayant
plus de rapport avec la nature de leur imagination ou de
leur génie que la représentation des personnages qu’ils
pouvaient mettre en scène ; et ils donnèrent aux animaux
une importance égale et même supérieure à celle des
figures humaines. Ils avaient une vive intelligence, une
exacte et sincère appréciation des choses de la campagne,
ils savaient rendre intéressants des motifs très simples, en
apparence assez insignifiants. Au Musée du Louvre, la
Prairie, de Paul Potter, où 1 on n’aperçoit que cinq ou
1. W. Burger, Musées de la Hollande, I.