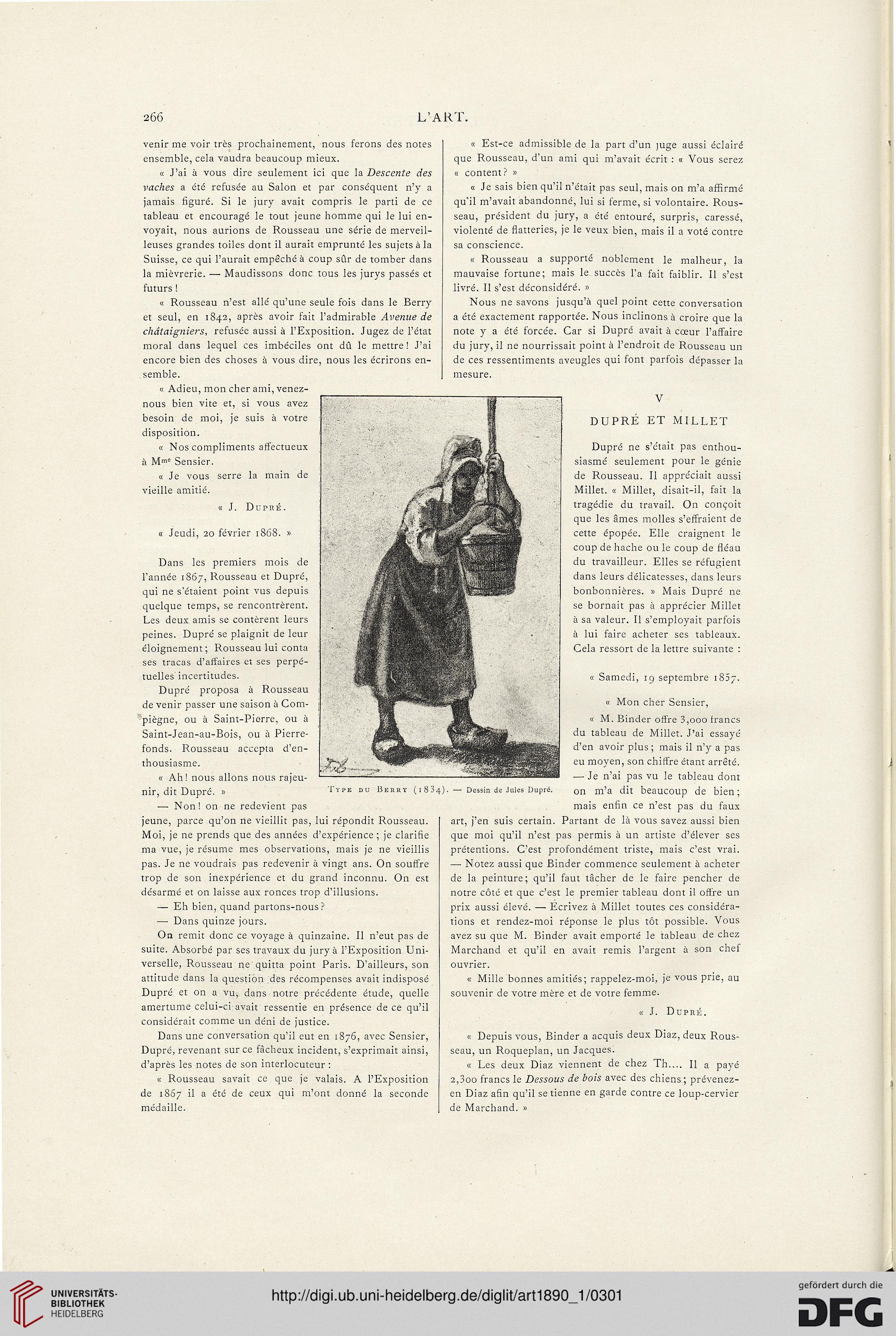266
L’ART.
venir me voir très prochainement, nous ferons des notes
ensemble, cela vaudra beaucoup mieux.
« J’ai à vous dire seulement ici que la Descente des
vaches a été refusée au Salon et par conséquent n’y a
jamais figuré. Si le jury avait compris le parti de ce
tableau et encouragé le tout jeune homme qui le lui en-
voyait, nous aurions de Rousseau une série de merveil-
leuses grandes toiles dont il aurait emprunté les sujets à la
Suisse, ce qui l’aurait empêché à coup sûr de tomber dans
la mièvrerie. — Maudissons donc tous les jurys passés et
futurs !
« Rousseau n’est allé qu’une seule fois dans le Berry
et seul, en 1842, après avoir fait l’admirable Avenue de
châtaigniers, refusée aussi à l’Exposition. Jugez de l’état
moral dans lequel ces imbéciles ont dû le mettre! J’ai
encore bien des choses à vous dire, nous les écrirons en-
semble.
« Adieu, mon cher ami, venez-
nous bien vite et, si vous avez
besoin de moi, je suis à votre
disposition.
« Nos compliments affectueux
à Mme Sensier.
« Je vous serre la main de
vieille amitié.
« J. Dupré.
« Jeudi, 20 février 1868. »
« Est-ce admissible de la part d’un juge aussi éclairé
que Rousseau, d’un ami qui m’avait écrit : « Vous serez
« content? »
« Je sais bien qu’il n’était pas seul, mais on m’a affirmé
qu'il m’avait abandonné, lui si ferme, si volontaire. Rous-
seau, président du jury, a été entouré, surpris, caressé,
violenté de flatteries, je le veux bien, mais il a voté contre
sa conscience.
« Rousseau a supporté noblement le malheur, la
mauvaise fortune; mais le succès l’a fait faiblir. Il s’est
livré. Il s’est déconsidéré. »
Nous ne savons jusqu’à quel point cette conversation
a été exactement rapportée. Nous inclinons à croire que la
note y a été forcée. Car si Dupré avait à cœur l’affaire
du jury, il ne nourrissait point à l’endroit de Rousseau un
de ces ressentiments aveugles qui font parfois dépasser la
mesure.
V
DUPRÉ ET MILLET
Dupré ne s’était pas enthou-
siasmé seulement pour le génie
de Rousseau. Il appréciait aussi
Millet. « Millet, disait-il, fait la
tragédie du travail. On conçoit
que les âmes molles s’effraient de
cette épopée. Elle craignent le
coup de hache ou le coup de fléau
du travailleur. Elles se réfugient
dans leurs délicatesses, dans leurs
bonbonnières. » Mais Dupré ne
se bornait pas à apprécier Millet
à sa valeur. Il s’employait parfois
à lui faire acheter ses tableaux.
Cela ressort de la lettre suivante :
« Samedi, 19 septembre i85y
Dans les premiers mois de
l’année 1867, Rousseau et Dupré,
qui ne s’étaient point vus depuis
quelque temps, se rencontrèrent.
Les deux amis se contèrent leurs
peines. Dupré se plaignit de leur
éloignement; Rousseau lui conta
ses tracas d’affaires et ses perpé-
tuelles incertitudes.
Dupré proposa à Rousseau
de venir passer une saison à Com-
piègne, ou à Saint-Pierre, ou à
Saint-Jean-au-Bois, ou à Pierre-
fonds. Rousseau accepta d’en-
thousiasme.
« Ah! nous allons nous rajeu-
nir, dit Dupré. »
— Non! on ne redevient pas
jeune, parce qu’on ne vieillit pas, lui répondit Rousseau.
Moi, je ne prends que des années d’expérience ; je clarifie
ma vue, je résume mes observations, mais je ne vieillis
pas. Je ne voudrais pas redevenir à vingt ans. On souffre
trop de son inexpérience et du grand inconnu. On est
désarmé et on laisse aux ronces trop d’illusions.
— Eh bien, quand partons-nous?
— Dans quinze jours.
On remit donc ce voyage à quinzaine. Il n’eut pas de
suite. Absorbé par ses travaux du jury à l’Exposition Uni-
verselle, Rousseau ne' quitta point Paris. D’ailleurs, son
attitude dans la question des récompenses avait indisposé
Dupré et on a vu, dans notre précédente étude, quelle
amertume celui-ci avait ressentie en présence de ce qu’il
considérait comme un déni de justice.
Dans une conversation qu’il eut en 1876, avec Sensier,
Dupré, revenant sur ce fâcheux incident, s’exprimait ainsi,
d’après les notes de son interlocuteur :
« Rousseau savait ce que je valais. A l’Exposition
de 1807 il a été de ceux qui m’ont donné la seconde
médaille.
« Mon cher Sensier,
« M. Binder offre 3,ooo francs
du tableau de Millet. J’ai essayé
d’en avoir plus ; mais il n’y a pas
eu moyen, son chiffre étant arrêté.
— Je n’ai pas vu le tableau dont
on m’a dit beaucoup de bien;
mais enfin ce n’est pas du faux
art, j’en suis certain. Partant de là vous savez aussi bien
que moi qu’il n’est pas permis à un artiste d’élever ses
prétentions. C’est profondément triste, mais c’est vrai.
— Notez aussi que Binder commence seulement à acheter
de la peinture; qu’il faut tâcher de le faire pencher de
notre côté et que c’est le premier tableau dont il offre un
prix aussi élevé. — Ecrivez à Millet toutes ces considéra-
tions et rendez-moi réponse le plus tôt possible. Vous
avez su que M. Binder avait emporté le tableau de chez
Marchand et qu’il en avait remis l’argent à son chef
ouvrier.
« Mille bonnes amitiés; rappelez-moi, je vous prie, au
souvenir de votre mère et de votre femme.
« J. Dupré.
« Depuis vous, Binder a acquis deux Diaz, deux Rous-
seau, un Roqueplan, un Jacques.
« Les deux Diaz viennent de chez Th.... Il a payé
2,3oo francs le Dessous de bois avec des chiens; prévenez-
en Diaz afin qu’il se tienne en garde contre ce loup-cervier
de Marchand. »
L’ART.
venir me voir très prochainement, nous ferons des notes
ensemble, cela vaudra beaucoup mieux.
« J’ai à vous dire seulement ici que la Descente des
vaches a été refusée au Salon et par conséquent n’y a
jamais figuré. Si le jury avait compris le parti de ce
tableau et encouragé le tout jeune homme qui le lui en-
voyait, nous aurions de Rousseau une série de merveil-
leuses grandes toiles dont il aurait emprunté les sujets à la
Suisse, ce qui l’aurait empêché à coup sûr de tomber dans
la mièvrerie. — Maudissons donc tous les jurys passés et
futurs !
« Rousseau n’est allé qu’une seule fois dans le Berry
et seul, en 1842, après avoir fait l’admirable Avenue de
châtaigniers, refusée aussi à l’Exposition. Jugez de l’état
moral dans lequel ces imbéciles ont dû le mettre! J’ai
encore bien des choses à vous dire, nous les écrirons en-
semble.
« Adieu, mon cher ami, venez-
nous bien vite et, si vous avez
besoin de moi, je suis à votre
disposition.
« Nos compliments affectueux
à Mme Sensier.
« Je vous serre la main de
vieille amitié.
« J. Dupré.
« Jeudi, 20 février 1868. »
« Est-ce admissible de la part d’un juge aussi éclairé
que Rousseau, d’un ami qui m’avait écrit : « Vous serez
« content? »
« Je sais bien qu’il n’était pas seul, mais on m’a affirmé
qu'il m’avait abandonné, lui si ferme, si volontaire. Rous-
seau, président du jury, a été entouré, surpris, caressé,
violenté de flatteries, je le veux bien, mais il a voté contre
sa conscience.
« Rousseau a supporté noblement le malheur, la
mauvaise fortune; mais le succès l’a fait faiblir. Il s’est
livré. Il s’est déconsidéré. »
Nous ne savons jusqu’à quel point cette conversation
a été exactement rapportée. Nous inclinons à croire que la
note y a été forcée. Car si Dupré avait à cœur l’affaire
du jury, il ne nourrissait point à l’endroit de Rousseau un
de ces ressentiments aveugles qui font parfois dépasser la
mesure.
V
DUPRÉ ET MILLET
Dupré ne s’était pas enthou-
siasmé seulement pour le génie
de Rousseau. Il appréciait aussi
Millet. « Millet, disait-il, fait la
tragédie du travail. On conçoit
que les âmes molles s’effraient de
cette épopée. Elle craignent le
coup de hache ou le coup de fléau
du travailleur. Elles se réfugient
dans leurs délicatesses, dans leurs
bonbonnières. » Mais Dupré ne
se bornait pas à apprécier Millet
à sa valeur. Il s’employait parfois
à lui faire acheter ses tableaux.
Cela ressort de la lettre suivante :
« Samedi, 19 septembre i85y
Dans les premiers mois de
l’année 1867, Rousseau et Dupré,
qui ne s’étaient point vus depuis
quelque temps, se rencontrèrent.
Les deux amis se contèrent leurs
peines. Dupré se plaignit de leur
éloignement; Rousseau lui conta
ses tracas d’affaires et ses perpé-
tuelles incertitudes.
Dupré proposa à Rousseau
de venir passer une saison à Com-
piègne, ou à Saint-Pierre, ou à
Saint-Jean-au-Bois, ou à Pierre-
fonds. Rousseau accepta d’en-
thousiasme.
« Ah! nous allons nous rajeu-
nir, dit Dupré. »
— Non! on ne redevient pas
jeune, parce qu’on ne vieillit pas, lui répondit Rousseau.
Moi, je ne prends que des années d’expérience ; je clarifie
ma vue, je résume mes observations, mais je ne vieillis
pas. Je ne voudrais pas redevenir à vingt ans. On souffre
trop de son inexpérience et du grand inconnu. On est
désarmé et on laisse aux ronces trop d’illusions.
— Eh bien, quand partons-nous?
— Dans quinze jours.
On remit donc ce voyage à quinzaine. Il n’eut pas de
suite. Absorbé par ses travaux du jury à l’Exposition Uni-
verselle, Rousseau ne' quitta point Paris. D’ailleurs, son
attitude dans la question des récompenses avait indisposé
Dupré et on a vu, dans notre précédente étude, quelle
amertume celui-ci avait ressentie en présence de ce qu’il
considérait comme un déni de justice.
Dans une conversation qu’il eut en 1876, avec Sensier,
Dupré, revenant sur ce fâcheux incident, s’exprimait ainsi,
d’après les notes de son interlocuteur :
« Rousseau savait ce que je valais. A l’Exposition
de 1807 il a été de ceux qui m’ont donné la seconde
médaille.
« Mon cher Sensier,
« M. Binder offre 3,ooo francs
du tableau de Millet. J’ai essayé
d’en avoir plus ; mais il n’y a pas
eu moyen, son chiffre étant arrêté.
— Je n’ai pas vu le tableau dont
on m’a dit beaucoup de bien;
mais enfin ce n’est pas du faux
art, j’en suis certain. Partant de là vous savez aussi bien
que moi qu’il n’est pas permis à un artiste d’élever ses
prétentions. C’est profondément triste, mais c’est vrai.
— Notez aussi que Binder commence seulement à acheter
de la peinture; qu’il faut tâcher de le faire pencher de
notre côté et que c’est le premier tableau dont il offre un
prix aussi élevé. — Ecrivez à Millet toutes ces considéra-
tions et rendez-moi réponse le plus tôt possible. Vous
avez su que M. Binder avait emporté le tableau de chez
Marchand et qu’il en avait remis l’argent à son chef
ouvrier.
« Mille bonnes amitiés; rappelez-moi, je vous prie, au
souvenir de votre mère et de votre femme.
« J. Dupré.
« Depuis vous, Binder a acquis deux Diaz, deux Rous-
seau, un Roqueplan, un Jacques.
« Les deux Diaz viennent de chez Th.... Il a payé
2,3oo francs le Dessous de bois avec des chiens; prévenez-
en Diaz afin qu’il se tienne en garde contre ce loup-cervier
de Marchand. »