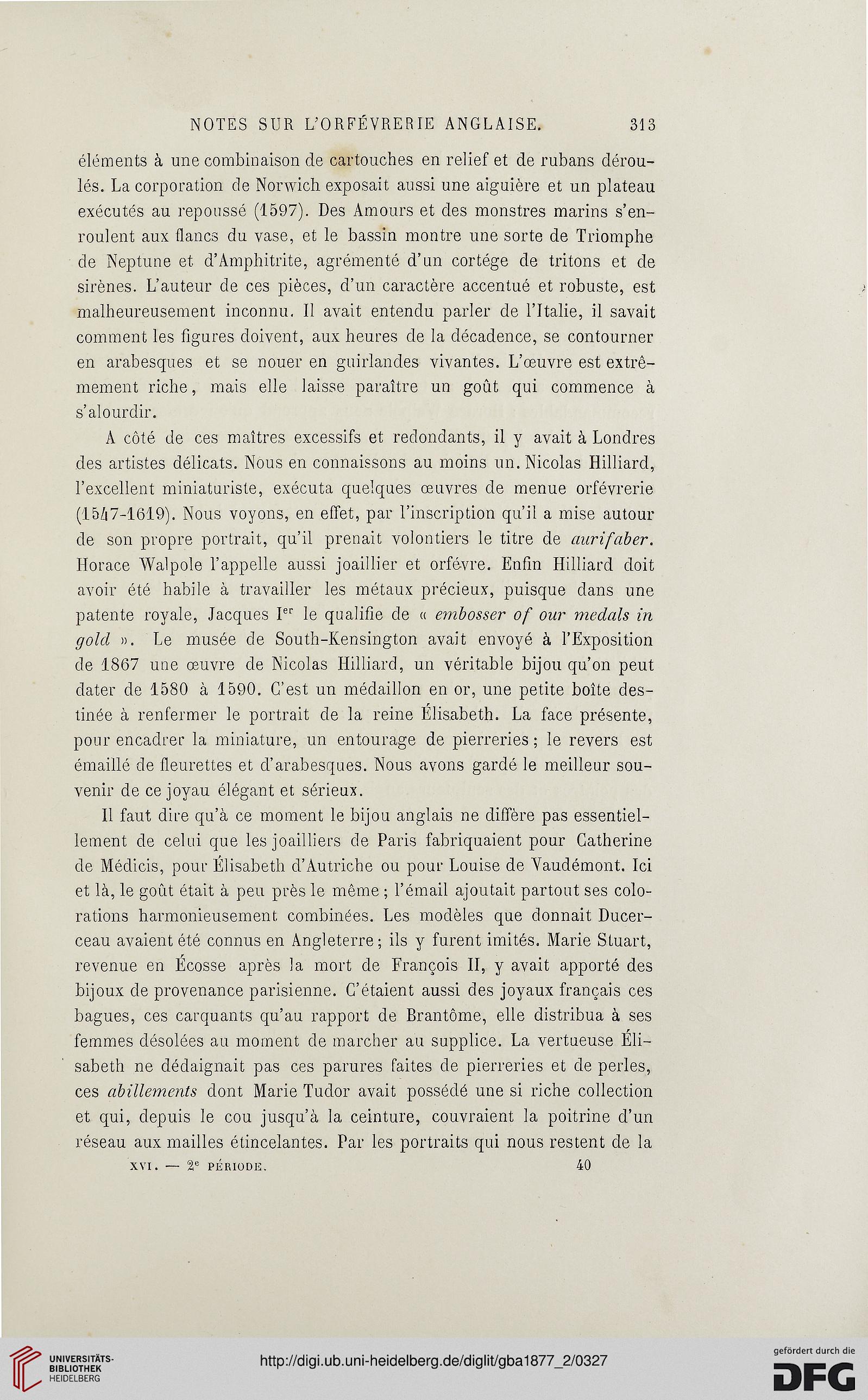NOTES SUR L'ORFÈVRERIE ANGLAISE.
313
éléments à une combinaison de cartouches en relief et de rubans dérou-
lés. La corporation de Norwich exposait aussi une aiguière et un plateau
exécutés au repoussé (1597). Des Amours et des monstres marins s’en-
roulent aux flancs du vase, et le bassin montre une sorte de Triomphe
de Neptune et d’Amphitrite, agrémenté d’un cortège de tritons et de
sirènes. L’auteur de ces pièces, d’un caractère accentué et robuste, est
malheureusement inconnu. Il avait entendu parler de l’Italie, il savait
comment les figures doivent, aux heures de la décadence, se contourner
en arabesques et se nouer en guirlandes vivantes. L’œuvre est extrê-
mement riche, mais elle laisse paraître un goût qui commence à
s’alourdir.
A côté de ces maîtres excessifs et redondants, il y avait à Londres
des artistes délicats. Nous en connaissons au moins un. Nicolas Hilliard,
l’excellent miniaturiste, exécuta quelques œuvres de menue orfèvrerie
(15Zi7-1619). Nous voyons, en effet, par l’inscription qu’il a mise autour
de son propre portrait, qu’il prenait volontiers le titre de aurifaber.
Horace Walpole l’appelle aussi joaillier et orfèvre. Enfin Hilliard doit
avoir été habile à travailler les métaux précieux, puisque dans une
patente royale, Jacques Ier le qualifie de « embosser of our medals in
gold ». Le musée de South-Kensington avait envoyé à l’Exposition
de 1867 une œuvre de Nicolas Hilliard, un véritable bijou qu’on peut
dater de 1580 à 1590. C’est un médaillon en or, une petite boîte des-
tinée à renfermer le portrait de la reine Elisabeth. La face présente,
pour encadrer la miniature, un entourage de pierreries ; le revers est
émaillé de fleurettes et d’arabesques. Nous avons gardé le meilleur sou-
venir de ce joyau élégant et sérieux.
Il faut dire qu’à ce moment le bijou anglais ne diffère pas essentiel-
lement de celui que les joailliers de Paris fabriquaient pour Catherine
de Médicis, pour Élisabeth d’Autriche ou pour Louise de Vaudémont. Ici
et là, le goût était à peu près le même ; l’émail ajoutait partout ses colo-
rations harmonieusement combinées. Les modèles que donnait Ducer-
ceau avaient été connus en Angleterre; ils y furent imités. Marie Stuart,
revenue en Écosse après la mort de François II, y avait apporté des
bijoux de provenance parisienne. C’étaient aussi des joyaux français ces
bagues, ces carquants qu’au rapport de Brantôme, elle distribua à ses
femmes désolées au moment de marcher au supplice. La vertueuse Éli-
sabeth ne dédaignait pas ces parures faites de pierreries et de perles,
ces abillements dont Marie Tudor avait possédé une si riche collection
et qui, depuis le cou jusqu’à la ceinture, couvraient la poitrine d’un
réseau aux mailles étincelantes. Par les portraits qui nous restent de la
— 2e PÉRIODE. 40
XVI.
313
éléments à une combinaison de cartouches en relief et de rubans dérou-
lés. La corporation de Norwich exposait aussi une aiguière et un plateau
exécutés au repoussé (1597). Des Amours et des monstres marins s’en-
roulent aux flancs du vase, et le bassin montre une sorte de Triomphe
de Neptune et d’Amphitrite, agrémenté d’un cortège de tritons et de
sirènes. L’auteur de ces pièces, d’un caractère accentué et robuste, est
malheureusement inconnu. Il avait entendu parler de l’Italie, il savait
comment les figures doivent, aux heures de la décadence, se contourner
en arabesques et se nouer en guirlandes vivantes. L’œuvre est extrê-
mement riche, mais elle laisse paraître un goût qui commence à
s’alourdir.
A côté de ces maîtres excessifs et redondants, il y avait à Londres
des artistes délicats. Nous en connaissons au moins un. Nicolas Hilliard,
l’excellent miniaturiste, exécuta quelques œuvres de menue orfèvrerie
(15Zi7-1619). Nous voyons, en effet, par l’inscription qu’il a mise autour
de son propre portrait, qu’il prenait volontiers le titre de aurifaber.
Horace Walpole l’appelle aussi joaillier et orfèvre. Enfin Hilliard doit
avoir été habile à travailler les métaux précieux, puisque dans une
patente royale, Jacques Ier le qualifie de « embosser of our medals in
gold ». Le musée de South-Kensington avait envoyé à l’Exposition
de 1867 une œuvre de Nicolas Hilliard, un véritable bijou qu’on peut
dater de 1580 à 1590. C’est un médaillon en or, une petite boîte des-
tinée à renfermer le portrait de la reine Elisabeth. La face présente,
pour encadrer la miniature, un entourage de pierreries ; le revers est
émaillé de fleurettes et d’arabesques. Nous avons gardé le meilleur sou-
venir de ce joyau élégant et sérieux.
Il faut dire qu’à ce moment le bijou anglais ne diffère pas essentiel-
lement de celui que les joailliers de Paris fabriquaient pour Catherine
de Médicis, pour Élisabeth d’Autriche ou pour Louise de Vaudémont. Ici
et là, le goût était à peu près le même ; l’émail ajoutait partout ses colo-
rations harmonieusement combinées. Les modèles que donnait Ducer-
ceau avaient été connus en Angleterre; ils y furent imités. Marie Stuart,
revenue en Écosse après la mort de François II, y avait apporté des
bijoux de provenance parisienne. C’étaient aussi des joyaux français ces
bagues, ces carquants qu’au rapport de Brantôme, elle distribua à ses
femmes désolées au moment de marcher au supplice. La vertueuse Éli-
sabeth ne dédaignait pas ces parures faites de pierreries et de perles,
ces abillements dont Marie Tudor avait possédé une si riche collection
et qui, depuis le cou jusqu’à la ceinture, couvraient la poitrine d’un
réseau aux mailles étincelantes. Par les portraits qui nous restent de la
— 2e PÉRIODE. 40
XVI.