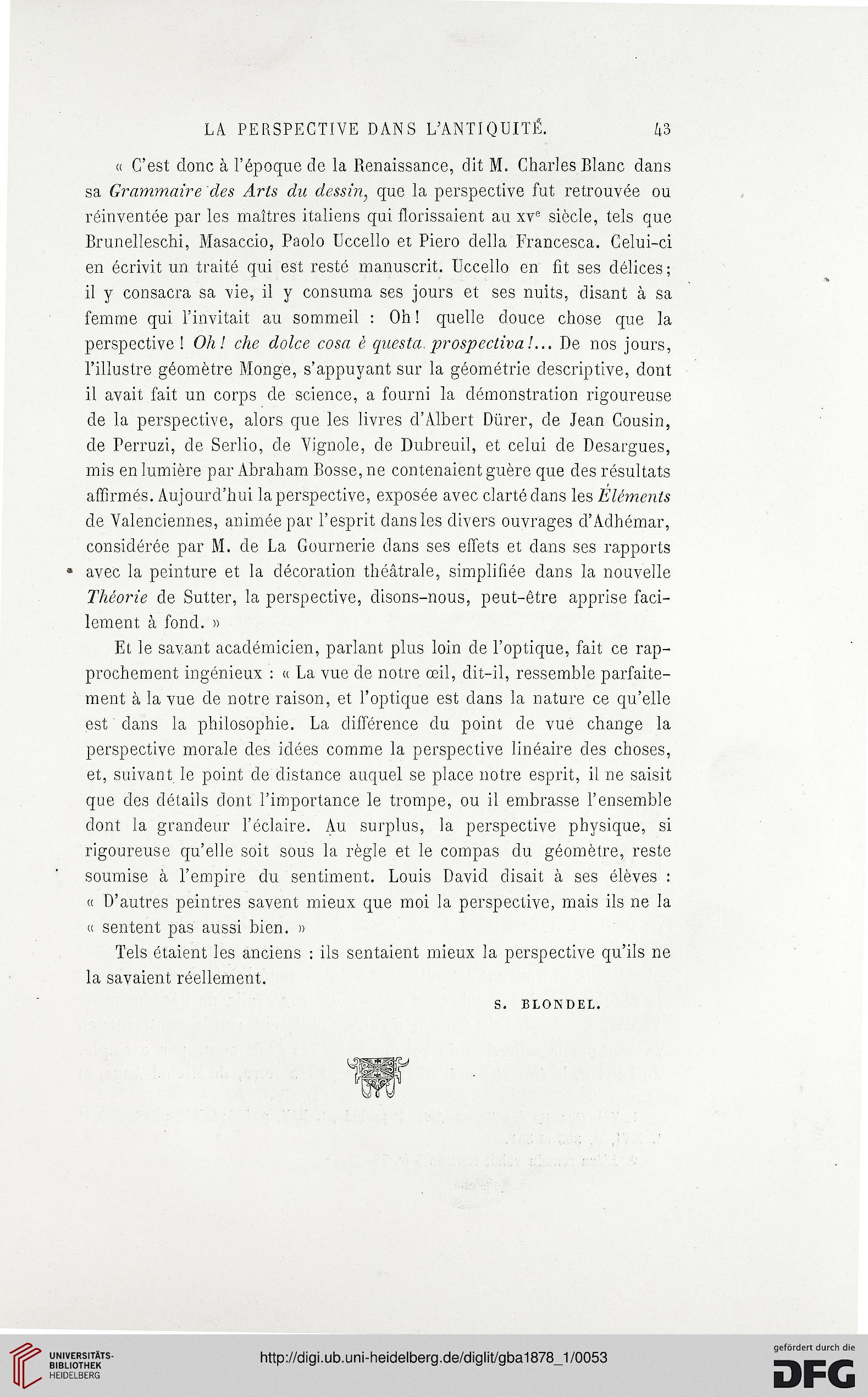LÀ PERSPECTIVE DANS L'ANTIQUITÉ.
« C'est donc à l'époque de la Renaissance, dit M. Charles Blanc dans
sa Grammaire des Arts du dessin, que la perspective fut retrouvée ou
réinventée par les maîtres italiens qui finissaient an xve siècle, tels que
Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uccello et Piero délia Francesca. Celui-ci
en écrivit un traité qui est resté manuscrit. Uccello en fit ses délices ;
il y consacra sa vie, il y consuma ses jours et ses nuits, disant à sa
femme qui l'invitait au sommeil : Oh! quelle douce chose que la
perspective ! Oh! che dolce cosa è questa prospectiva !... De nos jours,
l'illustre géomètre Monge, s'appuyant sur la géométrie descriptive, dont
il avait fait un corps de science, a fourni la démonstration rigoureuse
de la perspective, alors que les livres d'Albert Durer, de Jean Cousin,
de Perruzi, de Serlio, de Vignole, de Dubreuil, et celui de Desargues,
mis en lumière par Abraham Bosse, ne contenaient guère que des résultats
affirmés. Aujourd'hui la perspective, exposée avec clarté clans les Éléments
de Valenciennes, animée par l'esprit dans les divers ouvrages cl'Adhémar,
considérée par M. de La Gournerie clans ses effets et dans ses rapports
* avec la peinture et la décoration théâtrale, simplifiée dans la nouvelle
Théorie de Sutter, la perspective, disons-nous, peut-être apprise faci-
lement à fond. »
Et le savant académicien, parlant plus loin de l'optique, fait ce rap-
prochement ingénieux : « La vue de notre œil, dit-il, ressemble parfaite-
ment à la vue de notre raison, et l'optique est dans la nature ce qu'elle
est clans la philosophie. La différence du point de vue change la
perspective morale des idées comme la perspective linéaire des choses,
et, suivant le point de distance auquel se place notre esprit, il ne saisit
que des détails dont l'importance le trompe, ou il embrasse l'ensemble
dont la grandeur l'éclairé. Au surplus, la perspective physique, si
rigoureuse qu'elle soit sous la règle et le compas du géomètre, reste
soumise à l'empire du sentiment. Louis David disait à ses élèves :
« D'autres peintres savent mieux que moi la perspective, mais ils ne la
« sentent pas aussi bien. »
Tels étaient les anciens : ils sentaient mieux la perspective qu'ils ne
la savaient réellement.
S. BLOND EL.
« C'est donc à l'époque de la Renaissance, dit M. Charles Blanc dans
sa Grammaire des Arts du dessin, que la perspective fut retrouvée ou
réinventée par les maîtres italiens qui finissaient an xve siècle, tels que
Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uccello et Piero délia Francesca. Celui-ci
en écrivit un traité qui est resté manuscrit. Uccello en fit ses délices ;
il y consacra sa vie, il y consuma ses jours et ses nuits, disant à sa
femme qui l'invitait au sommeil : Oh! quelle douce chose que la
perspective ! Oh! che dolce cosa è questa prospectiva !... De nos jours,
l'illustre géomètre Monge, s'appuyant sur la géométrie descriptive, dont
il avait fait un corps de science, a fourni la démonstration rigoureuse
de la perspective, alors que les livres d'Albert Durer, de Jean Cousin,
de Perruzi, de Serlio, de Vignole, de Dubreuil, et celui de Desargues,
mis en lumière par Abraham Bosse, ne contenaient guère que des résultats
affirmés. Aujourd'hui la perspective, exposée avec clarté clans les Éléments
de Valenciennes, animée par l'esprit dans les divers ouvrages cl'Adhémar,
considérée par M. de La Gournerie clans ses effets et dans ses rapports
* avec la peinture et la décoration théâtrale, simplifiée dans la nouvelle
Théorie de Sutter, la perspective, disons-nous, peut-être apprise faci-
lement à fond. »
Et le savant académicien, parlant plus loin de l'optique, fait ce rap-
prochement ingénieux : « La vue de notre œil, dit-il, ressemble parfaite-
ment à la vue de notre raison, et l'optique est dans la nature ce qu'elle
est clans la philosophie. La différence du point de vue change la
perspective morale des idées comme la perspective linéaire des choses,
et, suivant le point de distance auquel se place notre esprit, il ne saisit
que des détails dont l'importance le trompe, ou il embrasse l'ensemble
dont la grandeur l'éclairé. Au surplus, la perspective physique, si
rigoureuse qu'elle soit sous la règle et le compas du géomètre, reste
soumise à l'empire du sentiment. Louis David disait à ses élèves :
« D'autres peintres savent mieux que moi la perspective, mais ils ne la
« sentent pas aussi bien. »
Tels étaient les anciens : ils sentaient mieux la perspective qu'ils ne
la savaient réellement.
S. BLOND EL.