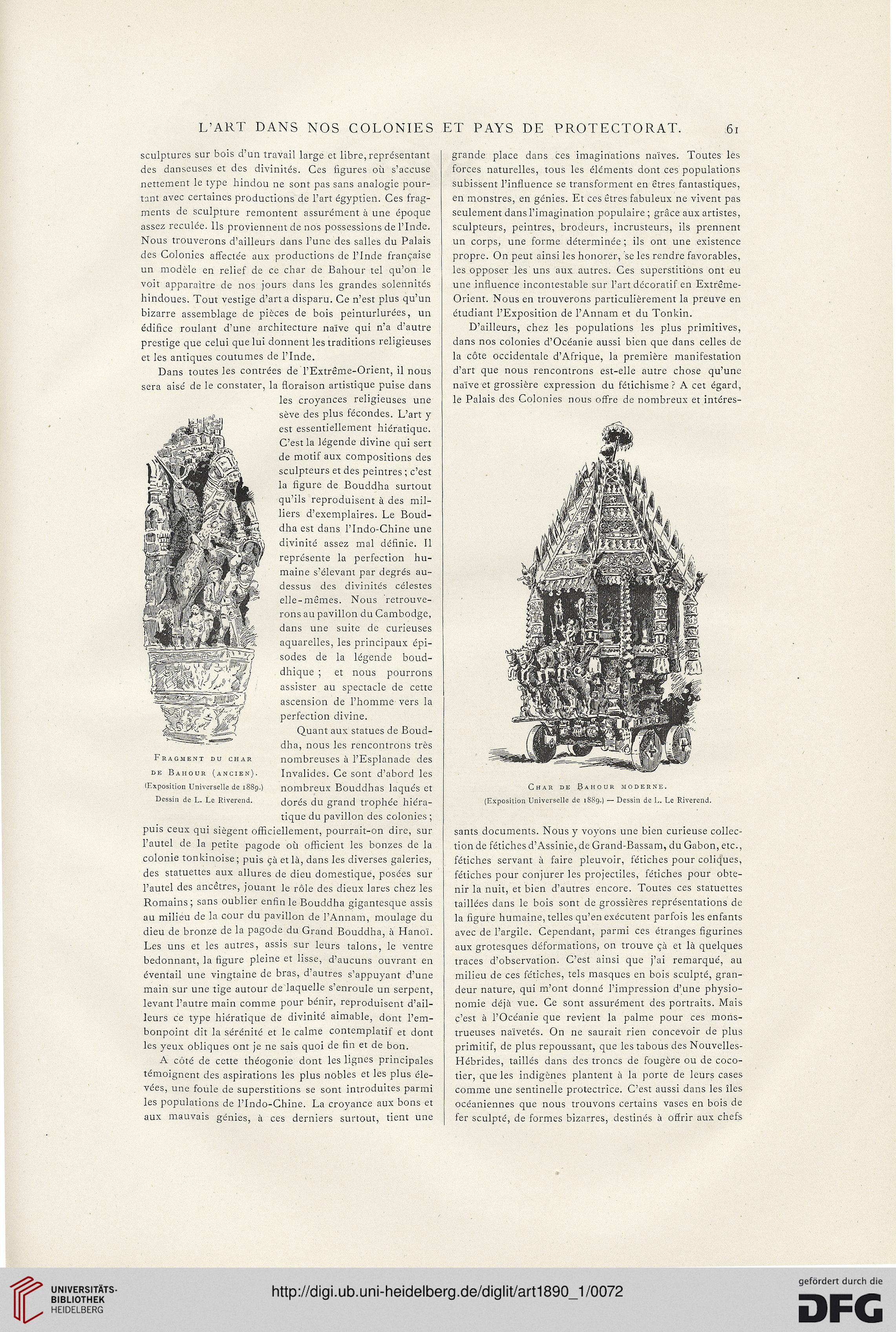L’ART DANS NOS COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT.
61
sculptures sur bois d’un travail large et libre, représentant
des danseuses et des divinités. Ces figures où s’accuse
nettement le type hindou ne sont pas sans analogie pour-
tant avec certaines productions de l’art égyptien. Ces frag-
ments de sculpture remontent assurément à une époque
assez reculée. Ils proviennent de nos possessions de l’Inde.
Nous trouverons d’ailleurs dans l’une des salles du Palais
des Colonies affectée aux productions de l’Inde française
un modèle en relief de ce char de Bahour tel qu’on le
voit apparaître de nos jours dans les grandes solennités
hindoues. Tout vestige d’art a disparu. Ce n’est plus qu’un
bizarre assemblage de pièces de bois peinturlurées, un
édifice roulant d'une architecture naïve qui n’a d’autre
prestige que celui que lui donnent les traditions religieuses
et les antiques coutumes de l’Inde.
Dans toutes les contrées de l’Extrême-Orient, il nous
sera aisé de le constater, la floraison artistique puise dans
les croyances religieuses une
sève des plus fécondes. L’art y
est essentiellement hiératique.
C’est la légende divine qui sert
de motif aux compositions des
sculpteurs et des peintres ; c’est
la figure de Bouddha surtout
qu’ils reproduisent à des mil-
liers d’exemplaires. Le Boud-
dha est dans l’Indo-Chine une
divinité assez mal définie. Il
représente la perfection hu-
maine s’élevant par degrés au-
dessus des divinités célestes
elle-mêmes. Nous retrouve-
rons au pavillon du Cambodge,
dans une suite de curieuses
aquarelles, les principaux épi-
sodes de la légende boud-
dhique ; et nous pourrons
assister au spectacle de cette
ascension de l’homme vers la
perfection divine.
Quant aux statues de Boud-
dha, nous les rencontrons très
nombreuses à l’Esplanade des
Invalides. Ce sont d’abord les
nombreux Bouddhas laqués et
dorés du grand trophée hiéra-
tique du pavillon des colonies ;
puis ceux qui siègent officiellement, pourrait-on dire, sur
l’autel de la petite pagode où officient les bonzes de la
colonie tonkinoise ; puis çà et là, dans les diverses galeries,
des statuettes aux allures de dieu domestique, posées sur
l’autel des ancêtres, jouant le rôle des dieux lares chez les
Romains; sans oublier enfin le Bouddha gigantesque assis
au milieu de la cour du pavillon de l’Annam, moulage du
dieu de bronze de la pagode du Grand Bouddha, à Hanoï.
Les uns et les autres, assis sur leurs talons, le ventre
bedonnant, la figure pleine et lisse, d’aucuns ouvrant en
éventail une vingtaine de bras, d’autres s’appuyant d’une
main sur une tige autour de laquelle s’enroule un serpent,
levant l’autre main comme pour bénir, reproduisent d’ail-
leurs ce type hiératique de divinité aimable, dont l’em-
bonpoint dit la sérénité et le calme contemplatif et dont
les yeux obliques ont je ne sais quoi de fin et de bon.
A côté de cette théogonie dont les lignes principales
témoignent des aspirations les plus nobles et les plus éle-
vées, une foule de superstitions se sont introduites parmi
les populations de l’Indo-Chine. La croyance aux bons et
aux mauvais génies, à ces derniers surtout, tient une
grande place dans ces imaginations naïves. Toutes les
forces naturelles, tous les éléments dont ces populations
subissent l’influence se transforment en êtres fantastiques,
en monstres, en génies. Et ces êtres fabuleux ne vivent pas
seulement dans l’imagination populaire; grâce aux artistes,
sculpteurs, peintres, brodeurs, incrusteurs, ils prennent
un corps, une forme déterminée ; ils ont une existence
propre. On peut ainsi les honorer, se les rendre favorables,
les opposer les uns aux autres. Ces superstitions ont eu
une influence incontestable sur l’art décoratif en Extrême-
Orient. Nous en trouverons particulièrement la preuve en
étudiant l’Exposition de l’Annam et du Tonkin.
D’ailleurs, chez les populations les plus primitives,
dans nos colonies d’Océanie aussi bien que dans celles de
la côte occidentale d’Afrique, la première manifestation
d’art que nous rencontrons est-elle autre chose qu’une
naïve et grossière expression du fétichisme ? A cet égard,
le Palais des Colonies nous offre de nombreux et intéres-
Char de Bahour moderne.
(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.
sants documents. Nous y voyons une bien curieuse collec-
tion de fétiches d’Assinie, de Grand-Bassam, du Gabon, etc.,
fétiches servant à faire pleuvoir, fétiches pour coliques,
fétiches pour conjurer les projectiles, fétiches pour obte-
nir la nuit, et bien d’autres encore. Toutes ces statuettes
taillées dans le bois sont de grossières représentations de
la figure humaine, telles qu’en exécutent parfois les enfants
avec de l’argile. Cependant, parmi ces étranges figurines
aux grotesques déformations, on trouve çà et là quelques
traces d’observation. C’est ainsi que j’ai remarqué, au
milieu de ces fétiches, tels masques en bois sculpté, gran-
deur nature, qui m’ont donné l’impression d’une physio-
nomie déjà vue. Ce sont assurément des portraits. Mais
c’est à l’Océanie que revient la palme pour ces mons-
trueuses naïvetés. On ne saurait rien concevoir de plus
primitif, de plus repoussant, que les tabous des Nouvelles-
Hébrides, taillés dans des troncs de fougère ou de coco-
tier, que les indigènes plantent à la porte de leurs cases
comme une sentinelle protectrice. C’est aussi dans les îles
océaniennes que nous trouvons certains vases en bois de
fer sculpté, de formes bizarres, destinés à offrir aux chefs
Fragment du char
de Bahour (ancien).
(Exposition Universelle de 1889.)
Dessin de L. Le Riverend.
61
sculptures sur bois d’un travail large et libre, représentant
des danseuses et des divinités. Ces figures où s’accuse
nettement le type hindou ne sont pas sans analogie pour-
tant avec certaines productions de l’art égyptien. Ces frag-
ments de sculpture remontent assurément à une époque
assez reculée. Ils proviennent de nos possessions de l’Inde.
Nous trouverons d’ailleurs dans l’une des salles du Palais
des Colonies affectée aux productions de l’Inde française
un modèle en relief de ce char de Bahour tel qu’on le
voit apparaître de nos jours dans les grandes solennités
hindoues. Tout vestige d’art a disparu. Ce n’est plus qu’un
bizarre assemblage de pièces de bois peinturlurées, un
édifice roulant d'une architecture naïve qui n’a d’autre
prestige que celui que lui donnent les traditions religieuses
et les antiques coutumes de l’Inde.
Dans toutes les contrées de l’Extrême-Orient, il nous
sera aisé de le constater, la floraison artistique puise dans
les croyances religieuses une
sève des plus fécondes. L’art y
est essentiellement hiératique.
C’est la légende divine qui sert
de motif aux compositions des
sculpteurs et des peintres ; c’est
la figure de Bouddha surtout
qu’ils reproduisent à des mil-
liers d’exemplaires. Le Boud-
dha est dans l’Indo-Chine une
divinité assez mal définie. Il
représente la perfection hu-
maine s’élevant par degrés au-
dessus des divinités célestes
elle-mêmes. Nous retrouve-
rons au pavillon du Cambodge,
dans une suite de curieuses
aquarelles, les principaux épi-
sodes de la légende boud-
dhique ; et nous pourrons
assister au spectacle de cette
ascension de l’homme vers la
perfection divine.
Quant aux statues de Boud-
dha, nous les rencontrons très
nombreuses à l’Esplanade des
Invalides. Ce sont d’abord les
nombreux Bouddhas laqués et
dorés du grand trophée hiéra-
tique du pavillon des colonies ;
puis ceux qui siègent officiellement, pourrait-on dire, sur
l’autel de la petite pagode où officient les bonzes de la
colonie tonkinoise ; puis çà et là, dans les diverses galeries,
des statuettes aux allures de dieu domestique, posées sur
l’autel des ancêtres, jouant le rôle des dieux lares chez les
Romains; sans oublier enfin le Bouddha gigantesque assis
au milieu de la cour du pavillon de l’Annam, moulage du
dieu de bronze de la pagode du Grand Bouddha, à Hanoï.
Les uns et les autres, assis sur leurs talons, le ventre
bedonnant, la figure pleine et lisse, d’aucuns ouvrant en
éventail une vingtaine de bras, d’autres s’appuyant d’une
main sur une tige autour de laquelle s’enroule un serpent,
levant l’autre main comme pour bénir, reproduisent d’ail-
leurs ce type hiératique de divinité aimable, dont l’em-
bonpoint dit la sérénité et le calme contemplatif et dont
les yeux obliques ont je ne sais quoi de fin et de bon.
A côté de cette théogonie dont les lignes principales
témoignent des aspirations les plus nobles et les plus éle-
vées, une foule de superstitions se sont introduites parmi
les populations de l’Indo-Chine. La croyance aux bons et
aux mauvais génies, à ces derniers surtout, tient une
grande place dans ces imaginations naïves. Toutes les
forces naturelles, tous les éléments dont ces populations
subissent l’influence se transforment en êtres fantastiques,
en monstres, en génies. Et ces êtres fabuleux ne vivent pas
seulement dans l’imagination populaire; grâce aux artistes,
sculpteurs, peintres, brodeurs, incrusteurs, ils prennent
un corps, une forme déterminée ; ils ont une existence
propre. On peut ainsi les honorer, se les rendre favorables,
les opposer les uns aux autres. Ces superstitions ont eu
une influence incontestable sur l’art décoratif en Extrême-
Orient. Nous en trouverons particulièrement la preuve en
étudiant l’Exposition de l’Annam et du Tonkin.
D’ailleurs, chez les populations les plus primitives,
dans nos colonies d’Océanie aussi bien que dans celles de
la côte occidentale d’Afrique, la première manifestation
d’art que nous rencontrons est-elle autre chose qu’une
naïve et grossière expression du fétichisme ? A cet égard,
le Palais des Colonies nous offre de nombreux et intéres-
Char de Bahour moderne.
(Exposition Universelle de 1889.) — Dessin de L. Le Riverend.
sants documents. Nous y voyons une bien curieuse collec-
tion de fétiches d’Assinie, de Grand-Bassam, du Gabon, etc.,
fétiches servant à faire pleuvoir, fétiches pour coliques,
fétiches pour conjurer les projectiles, fétiches pour obte-
nir la nuit, et bien d’autres encore. Toutes ces statuettes
taillées dans le bois sont de grossières représentations de
la figure humaine, telles qu’en exécutent parfois les enfants
avec de l’argile. Cependant, parmi ces étranges figurines
aux grotesques déformations, on trouve çà et là quelques
traces d’observation. C’est ainsi que j’ai remarqué, au
milieu de ces fétiches, tels masques en bois sculpté, gran-
deur nature, qui m’ont donné l’impression d’une physio-
nomie déjà vue. Ce sont assurément des portraits. Mais
c’est à l’Océanie que revient la palme pour ces mons-
trueuses naïvetés. On ne saurait rien concevoir de plus
primitif, de plus repoussant, que les tabous des Nouvelles-
Hébrides, taillés dans des troncs de fougère ou de coco-
tier, que les indigènes plantent à la porte de leurs cases
comme une sentinelle protectrice. C’est aussi dans les îles
océaniennes que nous trouvons certains vases en bois de
fer sculpté, de formes bizarres, destinés à offrir aux chefs
Fragment du char
de Bahour (ancien).
(Exposition Universelle de 1889.)
Dessin de L. Le Riverend.