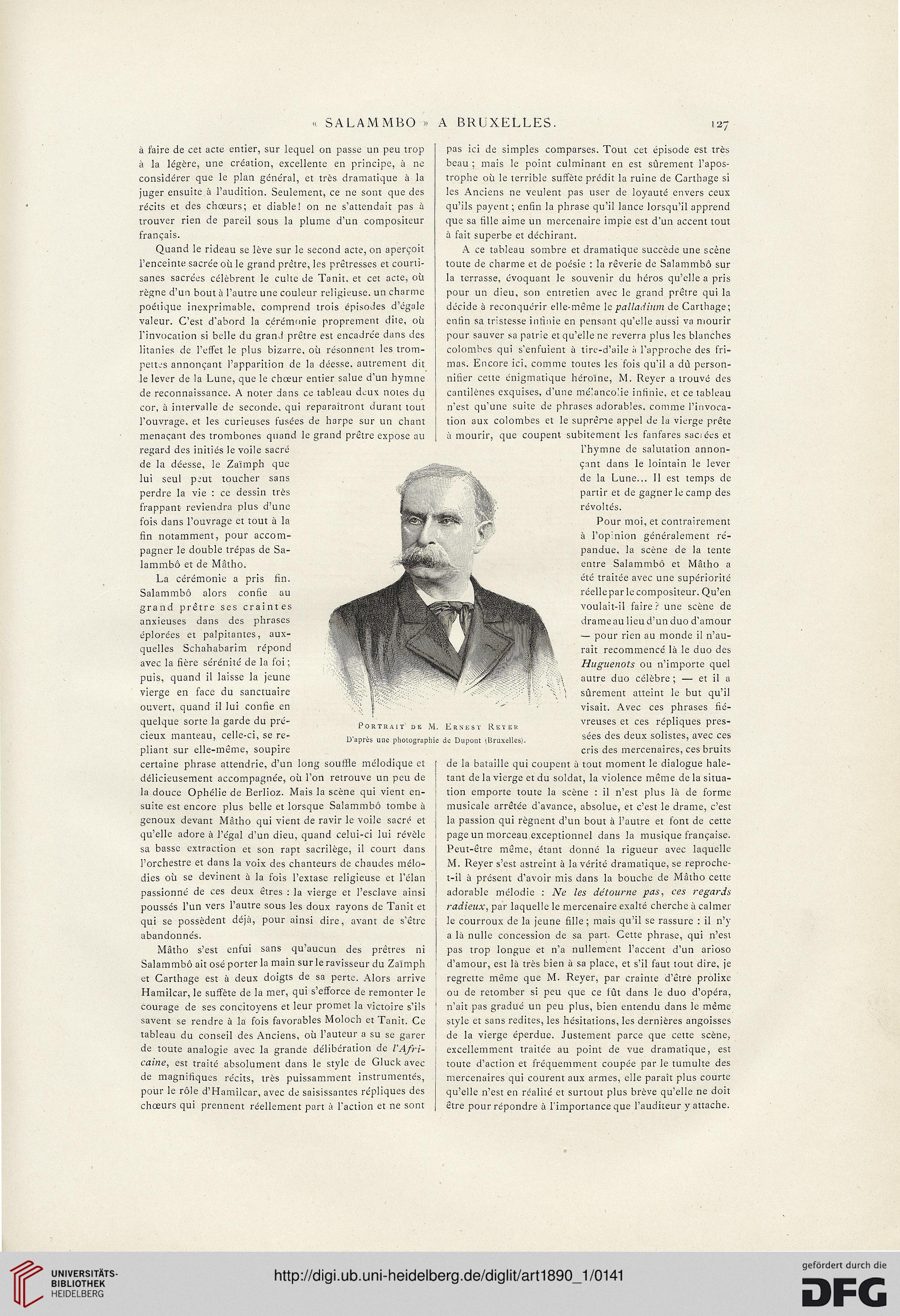SALAMMBO » A BRUXELLES.
à faire de cet acte entier, sur lequel on passe un peu trop
à la légère, une création, excellente en principe, à ne
considérer que le plan général, et très dramatique à la
juger ensuite à l’audition. Seulement, ce ne sont que des
récits et des chœurs; et diable! on ne s’attendait pas à
trouver rien de pareil sous la plume d’un compositeur
français.
Quand le rideau se lève sur le second acte, on aperçoit
l’enceinte sacrée où le grand prêtre, les prêtresses et courti-
sanes sacrées célèbrent le culte de Tanit. et cet acte, où
règne d’un bout à l’autre une couleur religieuse, un charme
poétique inexprimable, comprend trois épisodes d’égale
valeur. C’est d'abord la cérémonie proprement dite, où
l'invocation si belle du grand prêtre est encadrée dans des
litanies de l’effet le plus bizarre, où résonnent les trom-
pettes annonçant l’apparition de la déesse, autrement dit
le lever de la Lune, que le chœur entier salue d’un hymne
de reconnaissance. A noter dans ce tableau deux notes du
cor, à intervalle de seconde, qui reparaîtront durant tout
l'ouvrage, et les curieuses fusées de harpe sur un chant
menaçant des trombones quand le grand prêtre expose au
regard des initiés le voile sacré
de la déesse, le Zaïmph que
lui seul peut toucher sans
perdre la vie : ce dessin très
frappant reviendra plus d’une
fois dans l’ouvrage et tout à la
fin notamment, pour accom-
pagner le double trépas de Sa-
lammbô et de Mâtho.
La cérémonie a pris fin.
Salammbô alors confie au
grand prêtre ses craintes
anxieuses dans des phrases
éplorées et palpitantes, aux-
quelles Schahabarim répond
avec la fière sérénité de la foi ;
puis, quand il laisse la jeune
vierge en face du sanctuaire
ouvert, quand il lui confie en
quelque sorte la garde du pré-
cieux manteau, celle-ci, se re-
pliant sur elle-même, soupire
certaine phrase attendrie, d’un long souffle mélodique et
délicieusement accompagnée, où l’on retrouve un peu de
la douce Ophélie de Berlioz. Mais la scène qui vient en-
suite est encore plus belle et lorsque Salammbô tombe à
genoux devant Mâtho qui vient de ravir le voile sacré et
qu’elle adore à l’égal d’un dieu, quand celui-ci lui révèle
sa basse extraction et son rapt sacrilège, il court dans
l’orchestre et dans la voix des chanteurs de chaudes mélo-
dies où se devinent à la fois l’extase religieuse et l'élan
passionné de ces deux êtres : la vierge et l’esclave ainsi
poussés l’un vers l’autre sous les doux rayons de Tanit et
qui se possèdent déjà, pour ainsi dire, avant de s’être
abandonnés.
Mâtho s’est enfui sans qu’aucun des prêtres ni
Salammbô ait osé porter la main sur le ravisseur du Zaïmph
et Carthage est à deux doigts de sa perte. Alors arrive
Hamilcar, le suffète de la mer, qui s’efforce de remonter le
courage de ses concitoyens et leur promet la victoire s’ils
savent se rendre à la fois favorables Moloch et Tanit. Ce
tableau du conseil des Anciens, où l’auteur a su se garer
de toute analogie avec la grande délibération de l’Afri-
caine, est traité absolument dans le style de Gluck avec
de magnifiques récits, très puissamment instrumentés,
pour le rôle d’Hamilcar, avec de saisissantes répliques des
chœurs qui prennent réellement part à l'action et ne sont
127
pas ici de simples comparses. Tout cet épisode est très
beau ; mais le point culminant en est sûrement l’apos-
trophe où le terrible suffète prédit la ruine de Carthage si
les Anciens ne veulent pas user de loyauté envers ceux
qu’ils payent ; enfin la phrase qu’il lance lorsqu’il apprend
que sa fille aime un mercenaire impie est d’un accent tout
à fait superbe et déchirant.
A ce tableau sombre et dramatique succède une scène
toute de charme et de poésie : la rêverie de Salammbô sur
la terrasse, évoquant le souvenir du héros qu’elle a pris
pour un dieu, son entretien avec le grand prêtre qui la
décide à reconquérir elle-même le palladium de Carthage;
enfin sa tristesse infinie en pensant qu’elle aussi va mourir
pour sauver sa patrie et qu’elle ne reverra plus les blanches
colombes qui s'enfuient à tire-d’aile à l’approche des fri-
mas. Encore ici, comme toutes les fois qu’il a dù person-
nifier cette énigmatique héroïne, M. Reyer a trouvé des
cantilènes exquises, d’une mélancolie infinie, et ce tableau
n’est qu’une suite de phrases adorables, comme l’invoca-
tion aux colombes et le suprême appel de la vierge prête
à mourir, que coupent subitement les fanfares saciées et
l'hymne de salutation annon-
çant dans le lointain le lever
de la Lune... Il est temps de
partir et de gagner le camp des
révoltés.
Pour moi, et contrairement
à l’opinion généralement ré-
pandue, la scène de la tente
entre Salammbô et Mâtho a
été traitée avec une supériorité
réelleparlecompositeur. Qu’en
voulait-il faire? une scène de
drameau lieu d’un duo d’amour
— pour rien au monde il n’au-
rait recommencé là le duo des
Huguenots ou n’importe quel
autre duo célèbre ; — et il a
sûrement atteint le but qu’il
visait. Avec ces phrases fié-
vreuses et ces répliques pres-
sées des deux solistes, avec ces
cris des mercenaires, ces bruits
de la bataille qui coupent à tout moment le dialogue hale-
tant de la vierge et du soldat, la violence même de la situa-
tion emporte toute la scène : il n’est plus là de forme
musicale arrêtée d'avance, absolue, et c’est le drame, c’est
la passion qui régnent d’un bout à l’autre et font de cette
page un morceau exceptionnel dans la musique française.
Peut-être même, étant donné la rigueur avec laquelle
M. Reyer s’est astreint à la vérité dramatique, se reproche-
t-il à présent d’avoir mis dans la bouche de Mâtho cette
adorable mélodie : Ne les détourne pas, ces regards
radieux, par laquelle le mercenaire exalté cherche à calmer
le courroux de la jeune fille ; mais qu’il se rassure : il n’y
a là nulle concession de sa part. Cette phrase, qui n’est
pas trop longue et n’a nullement l’accent d’un arioso
d’amour, est là très bien à sa place, et s’il faut tout dire, je
regrette même que M. Reyer, par crainte d’êtré prolixe
ou de retomber si peu que ce fût dans le duo d’opéra,
n’ait pas gradué un peu plus, bien entendu dans le même
I style et sans redites, les hésitations, les dernières angoisses
de la vierge éperdue. Justement parce que cette scène,
excellemment traitée au point de vue dramatique, est
toute d’action et fréquemment coupée par le tumulte des
mercenaires qui courent aux armes, elle paraît plus courte
qu’elle n’est en réalité et surtout plus brève qu’elle ne doit
être pour répondre à l’importance que l’auditeur y attache.
Portrait de M. Ernest Reyer
D'après une photographie de Dupont (Bruxelles).
à faire de cet acte entier, sur lequel on passe un peu trop
à la légère, une création, excellente en principe, à ne
considérer que le plan général, et très dramatique à la
juger ensuite à l’audition. Seulement, ce ne sont que des
récits et des chœurs; et diable! on ne s’attendait pas à
trouver rien de pareil sous la plume d’un compositeur
français.
Quand le rideau se lève sur le second acte, on aperçoit
l’enceinte sacrée où le grand prêtre, les prêtresses et courti-
sanes sacrées célèbrent le culte de Tanit. et cet acte, où
règne d’un bout à l’autre une couleur religieuse, un charme
poétique inexprimable, comprend trois épisodes d’égale
valeur. C’est d'abord la cérémonie proprement dite, où
l'invocation si belle du grand prêtre est encadrée dans des
litanies de l’effet le plus bizarre, où résonnent les trom-
pettes annonçant l’apparition de la déesse, autrement dit
le lever de la Lune, que le chœur entier salue d’un hymne
de reconnaissance. A noter dans ce tableau deux notes du
cor, à intervalle de seconde, qui reparaîtront durant tout
l'ouvrage, et les curieuses fusées de harpe sur un chant
menaçant des trombones quand le grand prêtre expose au
regard des initiés le voile sacré
de la déesse, le Zaïmph que
lui seul peut toucher sans
perdre la vie : ce dessin très
frappant reviendra plus d’une
fois dans l’ouvrage et tout à la
fin notamment, pour accom-
pagner le double trépas de Sa-
lammbô et de Mâtho.
La cérémonie a pris fin.
Salammbô alors confie au
grand prêtre ses craintes
anxieuses dans des phrases
éplorées et palpitantes, aux-
quelles Schahabarim répond
avec la fière sérénité de la foi ;
puis, quand il laisse la jeune
vierge en face du sanctuaire
ouvert, quand il lui confie en
quelque sorte la garde du pré-
cieux manteau, celle-ci, se re-
pliant sur elle-même, soupire
certaine phrase attendrie, d’un long souffle mélodique et
délicieusement accompagnée, où l’on retrouve un peu de
la douce Ophélie de Berlioz. Mais la scène qui vient en-
suite est encore plus belle et lorsque Salammbô tombe à
genoux devant Mâtho qui vient de ravir le voile sacré et
qu’elle adore à l’égal d’un dieu, quand celui-ci lui révèle
sa basse extraction et son rapt sacrilège, il court dans
l’orchestre et dans la voix des chanteurs de chaudes mélo-
dies où se devinent à la fois l’extase religieuse et l'élan
passionné de ces deux êtres : la vierge et l’esclave ainsi
poussés l’un vers l’autre sous les doux rayons de Tanit et
qui se possèdent déjà, pour ainsi dire, avant de s’être
abandonnés.
Mâtho s’est enfui sans qu’aucun des prêtres ni
Salammbô ait osé porter la main sur le ravisseur du Zaïmph
et Carthage est à deux doigts de sa perte. Alors arrive
Hamilcar, le suffète de la mer, qui s’efforce de remonter le
courage de ses concitoyens et leur promet la victoire s’ils
savent se rendre à la fois favorables Moloch et Tanit. Ce
tableau du conseil des Anciens, où l’auteur a su se garer
de toute analogie avec la grande délibération de l’Afri-
caine, est traité absolument dans le style de Gluck avec
de magnifiques récits, très puissamment instrumentés,
pour le rôle d’Hamilcar, avec de saisissantes répliques des
chœurs qui prennent réellement part à l'action et ne sont
127
pas ici de simples comparses. Tout cet épisode est très
beau ; mais le point culminant en est sûrement l’apos-
trophe où le terrible suffète prédit la ruine de Carthage si
les Anciens ne veulent pas user de loyauté envers ceux
qu’ils payent ; enfin la phrase qu’il lance lorsqu’il apprend
que sa fille aime un mercenaire impie est d’un accent tout
à fait superbe et déchirant.
A ce tableau sombre et dramatique succède une scène
toute de charme et de poésie : la rêverie de Salammbô sur
la terrasse, évoquant le souvenir du héros qu’elle a pris
pour un dieu, son entretien avec le grand prêtre qui la
décide à reconquérir elle-même le palladium de Carthage;
enfin sa tristesse infinie en pensant qu’elle aussi va mourir
pour sauver sa patrie et qu’elle ne reverra plus les blanches
colombes qui s'enfuient à tire-d’aile à l’approche des fri-
mas. Encore ici, comme toutes les fois qu’il a dù person-
nifier cette énigmatique héroïne, M. Reyer a trouvé des
cantilènes exquises, d’une mélancolie infinie, et ce tableau
n’est qu’une suite de phrases adorables, comme l’invoca-
tion aux colombes et le suprême appel de la vierge prête
à mourir, que coupent subitement les fanfares saciées et
l'hymne de salutation annon-
çant dans le lointain le lever
de la Lune... Il est temps de
partir et de gagner le camp des
révoltés.
Pour moi, et contrairement
à l’opinion généralement ré-
pandue, la scène de la tente
entre Salammbô et Mâtho a
été traitée avec une supériorité
réelleparlecompositeur. Qu’en
voulait-il faire? une scène de
drameau lieu d’un duo d’amour
— pour rien au monde il n’au-
rait recommencé là le duo des
Huguenots ou n’importe quel
autre duo célèbre ; — et il a
sûrement atteint le but qu’il
visait. Avec ces phrases fié-
vreuses et ces répliques pres-
sées des deux solistes, avec ces
cris des mercenaires, ces bruits
de la bataille qui coupent à tout moment le dialogue hale-
tant de la vierge et du soldat, la violence même de la situa-
tion emporte toute la scène : il n’est plus là de forme
musicale arrêtée d'avance, absolue, et c’est le drame, c’est
la passion qui régnent d’un bout à l’autre et font de cette
page un morceau exceptionnel dans la musique française.
Peut-être même, étant donné la rigueur avec laquelle
M. Reyer s’est astreint à la vérité dramatique, se reproche-
t-il à présent d’avoir mis dans la bouche de Mâtho cette
adorable mélodie : Ne les détourne pas, ces regards
radieux, par laquelle le mercenaire exalté cherche à calmer
le courroux de la jeune fille ; mais qu’il se rassure : il n’y
a là nulle concession de sa part. Cette phrase, qui n’est
pas trop longue et n’a nullement l’accent d’un arioso
d’amour, est là très bien à sa place, et s’il faut tout dire, je
regrette même que M. Reyer, par crainte d’êtré prolixe
ou de retomber si peu que ce fût dans le duo d’opéra,
n’ait pas gradué un peu plus, bien entendu dans le même
I style et sans redites, les hésitations, les dernières angoisses
de la vierge éperdue. Justement parce que cette scène,
excellemment traitée au point de vue dramatique, est
toute d’action et fréquemment coupée par le tumulte des
mercenaires qui courent aux armes, elle paraît plus courte
qu’elle n’est en réalité et surtout plus brève qu’elle ne doit
être pour répondre à l’importance que l’auditeur y attache.
Portrait de M. Ernest Reyer
D'après une photographie de Dupont (Bruxelles).