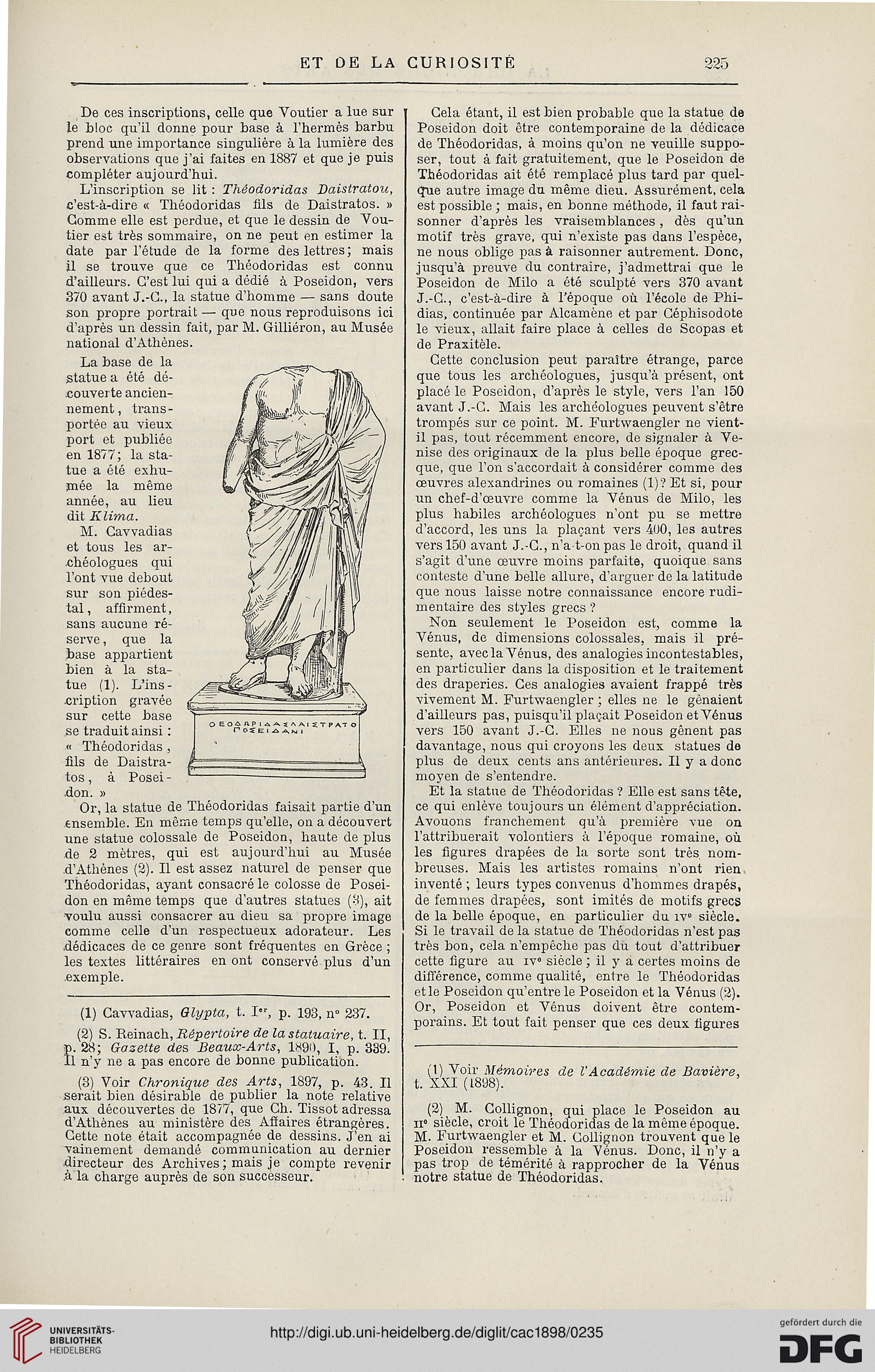ET ÛE LA CURIOSITÉ
De ces inscriptions, celle que Voutier a lue sur
le bloc qu'il donne pour base à l'hermès barbu
prend une importance singulière à la lumière des
observations que j'ai faites en 1887 et que je puis
compléter aujourd'hui.
L'inscription se lit : Théodoridas Daistratou,
c'est-à-dire « Théodoridas fils de Daistratos. »
Gomme elle est perdue, et que le dessin de Vou-
tier est très sommaire, on ne peut en estimer la
date par l'étude de la forme des lettres; mais
il se trouve que ce Théodoridas est connu
d'ailleurs. C'est lui qui a dédié à Poséidon, vers
370 avant J.-G., la statue d'homme — sans doute
son propre portrait — que nous reproduisons ici
d'après un dessin fait, par M. Gilliéron, au Musée
national d'Athènes.
La base de la
statue a été dé-
couverte ancien-
nement, trans-
portée au vieux
port et publiée
en 1877; la sta-
tue a été exhu-
mée la même
année, au lieu
dit Klima.
M. Cavvadias
et tous les ar-
chéologues qui
l'ont vue debout
sur son piédes-
tal , affirment,
sans aucune ré-
serve , que la
base appartient
bien à la sta-
tue (1). L'ins-
cription gravée
sur cette base
se traduit ainsi :
« Théodoridas ,
fils de Daistra-
tos, à Poséi-
don. »
Or, la statue de Théodoridas faisait partie d'un
ensemble. En même temps qu'elle, on a découvert
une statue colossale de Poséidon, haute de plus
de 2 mètres, qui est aujourd'hui au Musée
d'Athènes (2). Il est assez naturel de penser que
Théodoridas, ayant consacré le colosse de Poséi-
don en même temps que d'autres statues (3), ait
voulu aussi consacrer au dieu sa propre image
comme celle d'un respectueux adorateur. Les
.dédicaces de ce genre sont fréquentes en Grèce ;
les textes littéraires en ont conservé plus d'un
exemple.
(1) Cavvadias, Olypta, t. I", p. 193, n° 237.
(2) S. Reinach, Répertoire de la statuaire, t. II,
p. 28; Gazette des Beaux-Arts, 1x90, I, p. 339.
Il n'y ne a pas encore de bonne publication.
(3) Voir Chronique des Arts, 1897, p. 43. Il
serait bien désirable de publier la note relative
aux découvertes de 1877, que Ch. Tissot adressa
d'Athènes au ministère des Affaires étrangères.
Cette note était accompagnée de dessins. J'en ai
vainement demandé communication au dernier
directeur des Archives ; mais je compte revenir
à la charge auprès de son successeur.
Cela étant, il est bien probable que la statue de
Poséidon doit être contemporaine de la dédicace
de Théodoridas, à moins qu'on ne veuille suppo-
ser, tout à fait gratuitement, que le Poséidon de
Théodoridas ait été remplacé plus tard par quel-
que autre image du même dieu. Assurément, cela
est possible ; mais, en bonne méthode, il faut rai-
sonner d'après les vraisemblances, dès qu'un
motif très grave, qui n'existe pas dans l'espèce,
ne nous oblige pas à raisonner autrement. Donc,
jusqu'à preuve du contraire, j'admettrai que le
Poséidon de Milo a été sculpté vers 370 avant
J.-C, c'est-à-dire à l'époque où l'école de Phi-
dias, continuée par Alcamène et par Géphisodote
le vieux, allait faire place à celles de Scopas et
de Praxitèle.
Cette conclusion peut paraître étrange, parce
que tous les archéologues, jusqu'à présont, ont
placé le Poséidon, d'après le style, vers l'an 150
avant J.-C. Mais les archéologues peuvent s'être
trompés sur ce point. M. Furtwaengler ne vient-
il pas, tout récemment encore, de signaler à Ve-
nise des originaux de la plus belle époque grec-
que, que l'on s'accordait à considérer comme des
oeuvres alexandrines ou romaines (1)'? Et si, pour
un chef-d'oeuvre comme la Vénus de Milo, les
plus habiles archéologues n'ont pu se mettre
d'accord, les uns la plaçant vers 400, les autres
vers 150 avant J.-C, n'a t-onpas le droit, quand il
s'agit d'une œuvre moins parfaite, quoique sans
conteste d'une belle allure, d'arguer de la latitude
que nous laisse notre connaissance encore rudi-
mentaire des styles grecs ?
Non seulement le Poséidon est, comme la
Vénus, de dimensions colossales, mais il pré-
sente, avec la Vénus, des analogies incontestables,
en particulier dans la disposition et le traitement
des draperies. Ces analogies avaient frappé très
vivement M. Furtwaengler ; elles ne le gênaient
d'ailleurs pas, puisqu'il plaçait Poséidon et Vénus
vers 150 avant J.-G. Elles ne nous gênent pas
davantage, nous qui croyons les deux statues de
plus de deux cents ans antérieures. Il y a donc
moyen de s'entendre.
Et la statue de Théodoridas ? Elle est sans tête,
ce qui enlève toujours un élément d'appréciation.
Avouons franchement qu'à première vue on
l'attribuerait volontiers à l'époque romaine, où
les figures drapées de la sorte sont très, nom-
breuses. Mais les artistes romains n'ont rien,
inventé; leurs types convenus d'hommes drapés,
de femmes drapées, sont imités de motifs grecs
de la belle époque, en particulier du iv° siècle.
Si le travail de la statue de Théodoridas n'est pas
très bon, cela n'empêche pas du tout d'attribuer
cette figure au ive siècle ; il y à certes moins de
différence, comme qualité, entre le Théodoridas
et le Poséidon qu'entre le Poséidon et la Vénus (2).
Or, Poséidon et Vénus doivent être contem-
porains. Et tout fait penser que ces deux ligures
(1) Voir Mémoires de VAcadémie de Bavière,
t. XXI (1898).
(2) M. Collignon, qui place le Poséidon au
n» siècle, croit le Théodoridas de la même époque.
M. Furtwaengler et M. Collignon trouvent que le
Poséidon ressemble à la Vénus. Donc, il n'y a
pas trop de témérité à rapprocher de la Vénus
notre statue de Théodoridas.
De ces inscriptions, celle que Voutier a lue sur
le bloc qu'il donne pour base à l'hermès barbu
prend une importance singulière à la lumière des
observations que j'ai faites en 1887 et que je puis
compléter aujourd'hui.
L'inscription se lit : Théodoridas Daistratou,
c'est-à-dire « Théodoridas fils de Daistratos. »
Gomme elle est perdue, et que le dessin de Vou-
tier est très sommaire, on ne peut en estimer la
date par l'étude de la forme des lettres; mais
il se trouve que ce Théodoridas est connu
d'ailleurs. C'est lui qui a dédié à Poséidon, vers
370 avant J.-G., la statue d'homme — sans doute
son propre portrait — que nous reproduisons ici
d'après un dessin fait, par M. Gilliéron, au Musée
national d'Athènes.
La base de la
statue a été dé-
couverte ancien-
nement, trans-
portée au vieux
port et publiée
en 1877; la sta-
tue a été exhu-
mée la même
année, au lieu
dit Klima.
M. Cavvadias
et tous les ar-
chéologues qui
l'ont vue debout
sur son piédes-
tal , affirment,
sans aucune ré-
serve , que la
base appartient
bien à la sta-
tue (1). L'ins-
cription gravée
sur cette base
se traduit ainsi :
« Théodoridas ,
fils de Daistra-
tos, à Poséi-
don. »
Or, la statue de Théodoridas faisait partie d'un
ensemble. En même temps qu'elle, on a découvert
une statue colossale de Poséidon, haute de plus
de 2 mètres, qui est aujourd'hui au Musée
d'Athènes (2). Il est assez naturel de penser que
Théodoridas, ayant consacré le colosse de Poséi-
don en même temps que d'autres statues (3), ait
voulu aussi consacrer au dieu sa propre image
comme celle d'un respectueux adorateur. Les
.dédicaces de ce genre sont fréquentes en Grèce ;
les textes littéraires en ont conservé plus d'un
exemple.
(1) Cavvadias, Olypta, t. I", p. 193, n° 237.
(2) S. Reinach, Répertoire de la statuaire, t. II,
p. 28; Gazette des Beaux-Arts, 1x90, I, p. 339.
Il n'y ne a pas encore de bonne publication.
(3) Voir Chronique des Arts, 1897, p. 43. Il
serait bien désirable de publier la note relative
aux découvertes de 1877, que Ch. Tissot adressa
d'Athènes au ministère des Affaires étrangères.
Cette note était accompagnée de dessins. J'en ai
vainement demandé communication au dernier
directeur des Archives ; mais je compte revenir
à la charge auprès de son successeur.
Cela étant, il est bien probable que la statue de
Poséidon doit être contemporaine de la dédicace
de Théodoridas, à moins qu'on ne veuille suppo-
ser, tout à fait gratuitement, que le Poséidon de
Théodoridas ait été remplacé plus tard par quel-
que autre image du même dieu. Assurément, cela
est possible ; mais, en bonne méthode, il faut rai-
sonner d'après les vraisemblances, dès qu'un
motif très grave, qui n'existe pas dans l'espèce,
ne nous oblige pas à raisonner autrement. Donc,
jusqu'à preuve du contraire, j'admettrai que le
Poséidon de Milo a été sculpté vers 370 avant
J.-C, c'est-à-dire à l'époque où l'école de Phi-
dias, continuée par Alcamène et par Géphisodote
le vieux, allait faire place à celles de Scopas et
de Praxitèle.
Cette conclusion peut paraître étrange, parce
que tous les archéologues, jusqu'à présont, ont
placé le Poséidon, d'après le style, vers l'an 150
avant J.-C. Mais les archéologues peuvent s'être
trompés sur ce point. M. Furtwaengler ne vient-
il pas, tout récemment encore, de signaler à Ve-
nise des originaux de la plus belle époque grec-
que, que l'on s'accordait à considérer comme des
oeuvres alexandrines ou romaines (1)'? Et si, pour
un chef-d'oeuvre comme la Vénus de Milo, les
plus habiles archéologues n'ont pu se mettre
d'accord, les uns la plaçant vers 400, les autres
vers 150 avant J.-C, n'a t-onpas le droit, quand il
s'agit d'une œuvre moins parfaite, quoique sans
conteste d'une belle allure, d'arguer de la latitude
que nous laisse notre connaissance encore rudi-
mentaire des styles grecs ?
Non seulement le Poséidon est, comme la
Vénus, de dimensions colossales, mais il pré-
sente, avec la Vénus, des analogies incontestables,
en particulier dans la disposition et le traitement
des draperies. Ces analogies avaient frappé très
vivement M. Furtwaengler ; elles ne le gênaient
d'ailleurs pas, puisqu'il plaçait Poséidon et Vénus
vers 150 avant J.-G. Elles ne nous gênent pas
davantage, nous qui croyons les deux statues de
plus de deux cents ans antérieures. Il y a donc
moyen de s'entendre.
Et la statue de Théodoridas ? Elle est sans tête,
ce qui enlève toujours un élément d'appréciation.
Avouons franchement qu'à première vue on
l'attribuerait volontiers à l'époque romaine, où
les figures drapées de la sorte sont très, nom-
breuses. Mais les artistes romains n'ont rien,
inventé; leurs types convenus d'hommes drapés,
de femmes drapées, sont imités de motifs grecs
de la belle époque, en particulier du iv° siècle.
Si le travail de la statue de Théodoridas n'est pas
très bon, cela n'empêche pas du tout d'attribuer
cette figure au ive siècle ; il y à certes moins de
différence, comme qualité, entre le Théodoridas
et le Poséidon qu'entre le Poséidon et la Vénus (2).
Or, Poséidon et Vénus doivent être contem-
porains. Et tout fait penser que ces deux ligures
(1) Voir Mémoires de VAcadémie de Bavière,
t. XXI (1898).
(2) M. Collignon, qui place le Poséidon au
n» siècle, croit le Théodoridas de la même époque.
M. Furtwaengler et M. Collignon trouvent que le
Poséidon ressemble à la Vénus. Donc, il n'y a
pas trop de témérité à rapprocher de la Vénus
notre statue de Théodoridas.