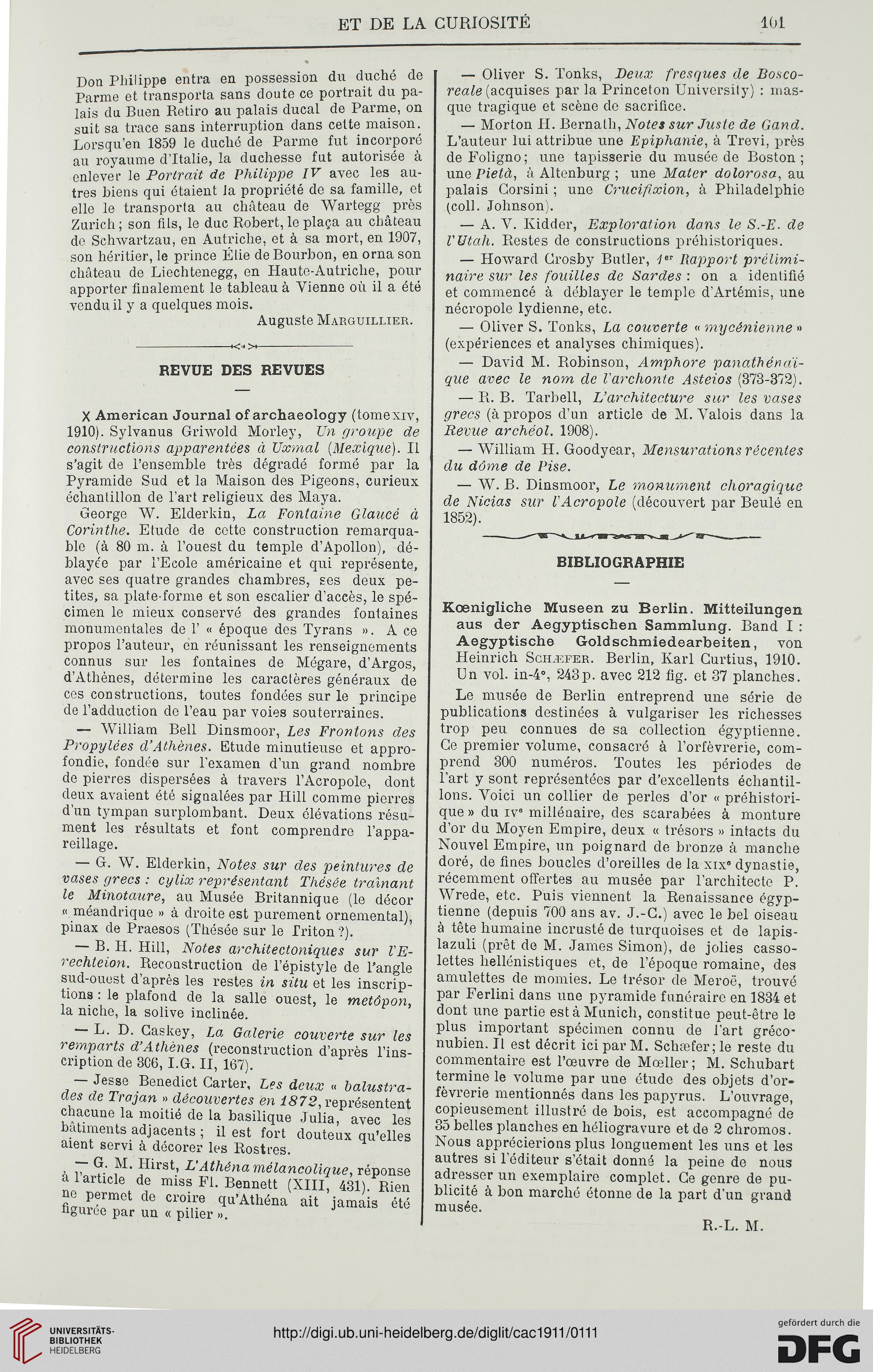ET DE LA CURIOSITÉ 101
Don Philippe entra en possession du duché de
Parme et transporta sans doute ce portrait du pa-
lais du Buen Retiro au palais ducal de Parme, on
suit sa trace sans interruption dans celte maison.
Lorsqu'en 1859 le duché de Parme fut incorpore
au royaume d'Italie, la duchesse fut autorisée à
enlever le Portrait de Philippe IV avec les au-
tres biens qui étaient Ja propriété de sa famille, et
elle le transporta au château de Wartegg près
Zurich ; son fils, le duc Robert, le plaça au château
do Schwartzau, en Autriche, et à sa mort, en 1907,
son héritier, le prince Élie de Bourbon, en orna son
château de Liechtenegg, en Haute-Autriche, pour
apporter finalement le tableau à Vienne où il a été
vendu il y a quelques mois.
Auguste Marguillier.
REVUE DES REVUES
X American Journal of archaeology (tomexiv,
1910). Sylvanus Griwold Morley, Un groupe de
constructions apparentées à Uxmal (Mexique). Il
s'agit de l'ensemble très dégradé formé par la
Pyramide Sud et la Maison des Pigeons, curieux
échantillon de l'art religieux des Maya.
George W. Elderkin, La Fontaine Glaucé à
Corinthe. Etude de cette construction remarqua-
ble (à 80 m. à l'ouest du temple d'Apollon), dé-
blayée par l'Ecole américaine et qui représente,
avec ses quatre grandes chambres, ses deux pe-
tites, sa plate-forme et son escalier d'accès, le spé-
cimen le mieux conservé des grandes fontaines
monumentales de 1' « époque des Tyrans ». A ce
propos l'auteur, en réunissant les renseignements
connus sur les fontaines de Mégare, d'Argos,
d'Athènes, détermine les caractères généraux de
ces constructions, toutes fondées sur le principe
de l'adduction do l'eau par voies souterraines.
— William Bell Dinsmoor, Les Frontons des
Propylées d'Athènes. Etude minutieuse et appro-
fondie, fondée sur l'examen d'un grand nombre
de pierres dispersées à travers l'Acropole, dont
deux avaient été signalées par Hill comme pierres
d'un tympan surplombant. Deux élévations résu-
ment les résultats et font comprendre l'appa-
reillage.
— G. W. Elderkin, Notes sur des peintures de
vases grecs : cylix représentant Thésée traînant
le Minotaure, au Musée Britannique (le décor
« méandrique » à droite est purement ornemental),
pinax de Praesos (Thésée sur le Triton?).
— B. H. Hill, Notes architectoniques sur VE-
rechteion. Reconstruction de l'épistyle de l'angle
sud-ouest d'après les restes in situ et les inscrip-
tions : le plafond de la salle ouest, le metôpon,
la niche, la solive inclinée.
— L. D. Caskey, La Galerie couverte sur les
remparts d'Athènes (reconstruction d'après l'ins-
cription de 3C6, I.G. II, 167).
— Jesse Benedict Carter, Les deux « balustra-
des de Trajan » découvertes en 1872, représentent
chacune la moitié de la basilique Julia, avec les
bâtiments adjacents ; il est fort douteux qu'elles
aient servi à décorer les Rostres.
— G. M. Hirst, L'Athéna mélancolique, réponse
al article de miss Fl. Bennett (XIII, 431). Rien
ne permet de croire qu'Athéna ait jamais été
nguree par un « pilier ».
— Oliver S. Tonks, Deux fresques de Bosco-
reale (acquises par la Princeton University) : mas-
que tragique et scène do sacrifice.
— Morton H. Bernath, Notes sur Juste de Gand.
L'auteur lui attribue une Epiphanie, à Trevi, près
de Foligno ; une tapisserie du musée de Boston ;
une Pietà, à Altenburg ; une Mater dolorosa, au
palais Gorsini ; une Crucifixion, à Philadelphie
(coll. Johnson).
— A. V. Kidder, Exploration dans le S.-E. de
VUtah. Restes de constructions préhistoriques.
— Howard Grosby Butler, 4er Rapport prélimi-
naire sur les fouilles de Sardes : on a identifié
et commencé à déblayer le temple d'Artémis, une
nécropole lydienne, etc.
— Oliver S. Tonks, La couverte « mycénienne »
(expériences et analyses chimiques).
— David M. Robinson, Amphore panathénaï-
que avec le nom de Varchonte Asteios (373-372).
— R. B. Tarbell, L'architecture sur les vases
grecs (àpropos d'un article de M.Valois dans la
Revue archéol. 1908).
— William H. Goodyear, Mensurations récentes
du dôme de Pise.
— W. B. Dinsmoor, Le monument choragique
de Nicias sur VAcropole (découvert par Beulé en
1852).
BIBLIOGRAPHIE
Kœnigliche Museen zu Berlin. Mitteilungen
aus der Aegyptischen Sammlung. Band I :
Aegyptische Goldschmiedearbeiten, von
Heinrich Sgii^fer. Berlin, Karl Gurtius, 1910.
Un vol. in-4°, 243p. avec 212 fig. et 37 planches.
Le musée de Berlin entreprend une série de
publications destinées à vulgariser les richesses
trop peu connues de sa collection égyptienne.
Ge premier volume, consacré à l'orfèvrerie, com-
prend 300 numéros. Toutes les périodes de
l'art y sont représentées par d'excellents échantil-
lons. Voici un collier de perles d'or « préhistori-
que » du ive millénaire, des scarabées à monture
d'or du Moyen Empire, deux « trésors » intacts du
Nouvel Empire, un poignard de bronze à manche
doré, de fines boucles d'oreilles de la xix° dynastie,
récemment offertes au musée par l'architecte P.
Wrede, etc. Puis viennent la Renaissance égyp-
tienne (depuis 700 ans av. J.-G.) avec le bel oiseau
à tête humaine incrusté de turquoises et de lapis-
lazuli (prêt de M. James Simon), de jolies casso-
lettes hellénistiques et, de l'époque romaine, des
amulettes de momies. Le trésor de Meroë, trouvé
par Ferlini dans une pyramide funéraire en 1834 et
dont une partie est à Munich, constitue peut-être le
plus important spécimen connu de l'art gréco-
nubien. Il est décrit ici par M. Schœfer;le reste du
commentaire est l'œuvre de Mœller ; M. Schubart
termine le volume par une étude des objets d'or-
fèvrerie mentionnés dans les papyrus. L'ouvrage,
copieusement illustré de bois, est accompagné de
35 belles planches en héliogravure et de 2 chromos.
Nous apprécierions plus longuement les uns et les
autres si l'éditeur s'était donné la peine de nous
adresser un exemplaire complet. Ge genre de pu-
blicité à bon marché étonne de la part d'un grand
musée.
R.-L. M.
Don Philippe entra en possession du duché de
Parme et transporta sans doute ce portrait du pa-
lais du Buen Retiro au palais ducal de Parme, on
suit sa trace sans interruption dans celte maison.
Lorsqu'en 1859 le duché de Parme fut incorpore
au royaume d'Italie, la duchesse fut autorisée à
enlever le Portrait de Philippe IV avec les au-
tres biens qui étaient Ja propriété de sa famille, et
elle le transporta au château de Wartegg près
Zurich ; son fils, le duc Robert, le plaça au château
do Schwartzau, en Autriche, et à sa mort, en 1907,
son héritier, le prince Élie de Bourbon, en orna son
château de Liechtenegg, en Haute-Autriche, pour
apporter finalement le tableau à Vienne où il a été
vendu il y a quelques mois.
Auguste Marguillier.
REVUE DES REVUES
X American Journal of archaeology (tomexiv,
1910). Sylvanus Griwold Morley, Un groupe de
constructions apparentées à Uxmal (Mexique). Il
s'agit de l'ensemble très dégradé formé par la
Pyramide Sud et la Maison des Pigeons, curieux
échantillon de l'art religieux des Maya.
George W. Elderkin, La Fontaine Glaucé à
Corinthe. Etude de cette construction remarqua-
ble (à 80 m. à l'ouest du temple d'Apollon), dé-
blayée par l'Ecole américaine et qui représente,
avec ses quatre grandes chambres, ses deux pe-
tites, sa plate-forme et son escalier d'accès, le spé-
cimen le mieux conservé des grandes fontaines
monumentales de 1' « époque des Tyrans ». A ce
propos l'auteur, en réunissant les renseignements
connus sur les fontaines de Mégare, d'Argos,
d'Athènes, détermine les caractères généraux de
ces constructions, toutes fondées sur le principe
de l'adduction do l'eau par voies souterraines.
— William Bell Dinsmoor, Les Frontons des
Propylées d'Athènes. Etude minutieuse et appro-
fondie, fondée sur l'examen d'un grand nombre
de pierres dispersées à travers l'Acropole, dont
deux avaient été signalées par Hill comme pierres
d'un tympan surplombant. Deux élévations résu-
ment les résultats et font comprendre l'appa-
reillage.
— G. W. Elderkin, Notes sur des peintures de
vases grecs : cylix représentant Thésée traînant
le Minotaure, au Musée Britannique (le décor
« méandrique » à droite est purement ornemental),
pinax de Praesos (Thésée sur le Triton?).
— B. H. Hill, Notes architectoniques sur VE-
rechteion. Reconstruction de l'épistyle de l'angle
sud-ouest d'après les restes in situ et les inscrip-
tions : le plafond de la salle ouest, le metôpon,
la niche, la solive inclinée.
— L. D. Caskey, La Galerie couverte sur les
remparts d'Athènes (reconstruction d'après l'ins-
cription de 3C6, I.G. II, 167).
— Jesse Benedict Carter, Les deux « balustra-
des de Trajan » découvertes en 1872, représentent
chacune la moitié de la basilique Julia, avec les
bâtiments adjacents ; il est fort douteux qu'elles
aient servi à décorer les Rostres.
— G. M. Hirst, L'Athéna mélancolique, réponse
al article de miss Fl. Bennett (XIII, 431). Rien
ne permet de croire qu'Athéna ait jamais été
nguree par un « pilier ».
— Oliver S. Tonks, Deux fresques de Bosco-
reale (acquises par la Princeton University) : mas-
que tragique et scène do sacrifice.
— Morton H. Bernath, Notes sur Juste de Gand.
L'auteur lui attribue une Epiphanie, à Trevi, près
de Foligno ; une tapisserie du musée de Boston ;
une Pietà, à Altenburg ; une Mater dolorosa, au
palais Gorsini ; une Crucifixion, à Philadelphie
(coll. Johnson).
— A. V. Kidder, Exploration dans le S.-E. de
VUtah. Restes de constructions préhistoriques.
— Howard Grosby Butler, 4er Rapport prélimi-
naire sur les fouilles de Sardes : on a identifié
et commencé à déblayer le temple d'Artémis, une
nécropole lydienne, etc.
— Oliver S. Tonks, La couverte « mycénienne »
(expériences et analyses chimiques).
— David M. Robinson, Amphore panathénaï-
que avec le nom de Varchonte Asteios (373-372).
— R. B. Tarbell, L'architecture sur les vases
grecs (àpropos d'un article de M.Valois dans la
Revue archéol. 1908).
— William H. Goodyear, Mensurations récentes
du dôme de Pise.
— W. B. Dinsmoor, Le monument choragique
de Nicias sur VAcropole (découvert par Beulé en
1852).
BIBLIOGRAPHIE
Kœnigliche Museen zu Berlin. Mitteilungen
aus der Aegyptischen Sammlung. Band I :
Aegyptische Goldschmiedearbeiten, von
Heinrich Sgii^fer. Berlin, Karl Gurtius, 1910.
Un vol. in-4°, 243p. avec 212 fig. et 37 planches.
Le musée de Berlin entreprend une série de
publications destinées à vulgariser les richesses
trop peu connues de sa collection égyptienne.
Ge premier volume, consacré à l'orfèvrerie, com-
prend 300 numéros. Toutes les périodes de
l'art y sont représentées par d'excellents échantil-
lons. Voici un collier de perles d'or « préhistori-
que » du ive millénaire, des scarabées à monture
d'or du Moyen Empire, deux « trésors » intacts du
Nouvel Empire, un poignard de bronze à manche
doré, de fines boucles d'oreilles de la xix° dynastie,
récemment offertes au musée par l'architecte P.
Wrede, etc. Puis viennent la Renaissance égyp-
tienne (depuis 700 ans av. J.-G.) avec le bel oiseau
à tête humaine incrusté de turquoises et de lapis-
lazuli (prêt de M. James Simon), de jolies casso-
lettes hellénistiques et, de l'époque romaine, des
amulettes de momies. Le trésor de Meroë, trouvé
par Ferlini dans une pyramide funéraire en 1834 et
dont une partie est à Munich, constitue peut-être le
plus important spécimen connu de l'art gréco-
nubien. Il est décrit ici par M. Schœfer;le reste du
commentaire est l'œuvre de Mœller ; M. Schubart
termine le volume par une étude des objets d'or-
fèvrerie mentionnés dans les papyrus. L'ouvrage,
copieusement illustré de bois, est accompagné de
35 belles planches en héliogravure et de 2 chromos.
Nous apprécierions plus longuement les uns et les
autres si l'éditeur s'était donné la peine de nous
adresser un exemplaire complet. Ge genre de pu-
blicité à bon marché étonne de la part d'un grand
musée.
R.-L. M.