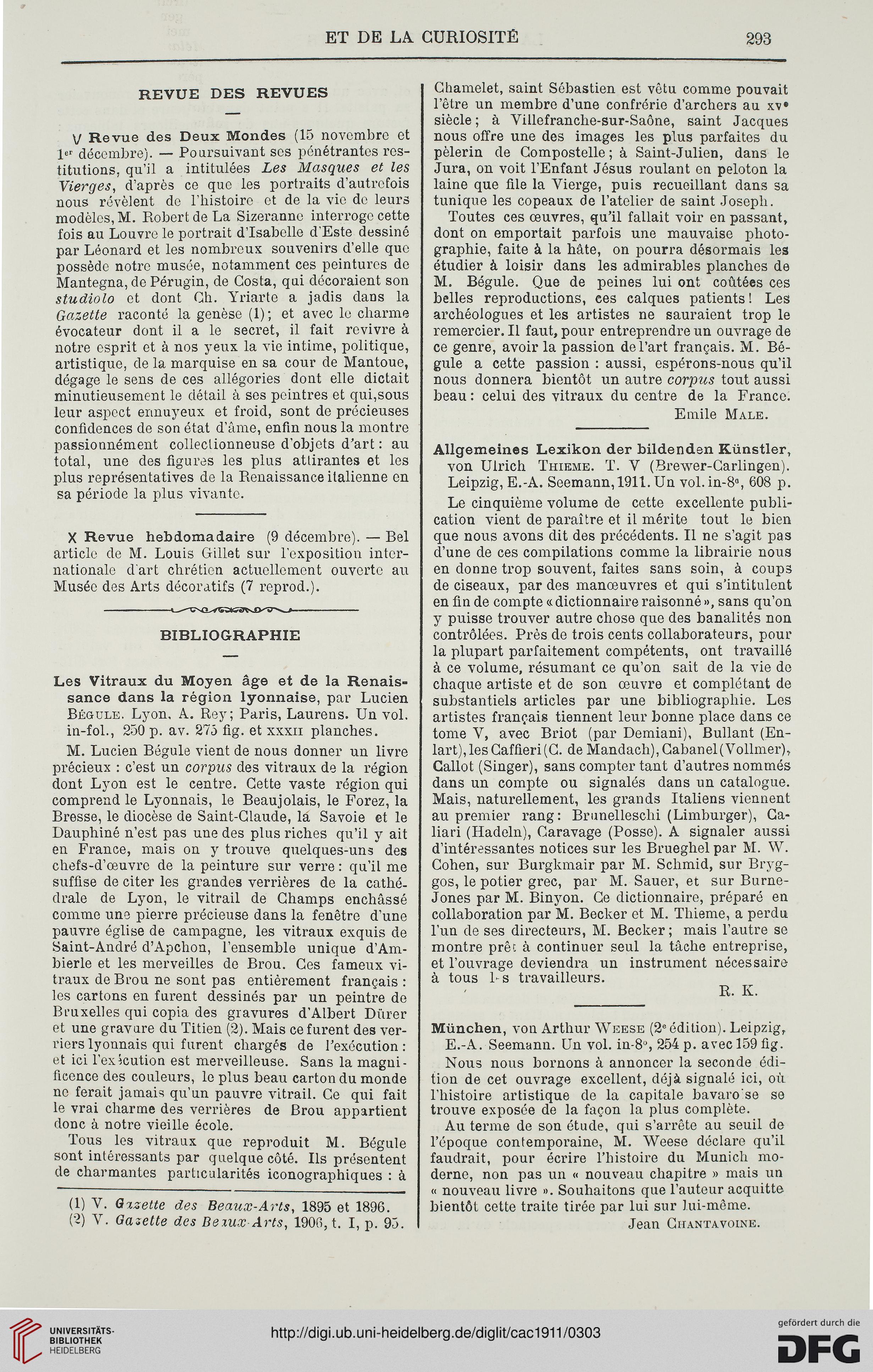ET DE LA.
REVUE DES REVUES
\f Revue des Deux Mondes (15 novembre et
1er décembre). — Poursuivant ses pénétrantes res-
titutions, qu'il a intitulées Les Masques et les
Vierges, d'après ce que les portraits d'autrefois
nous révèlent de l'histoire et de la vie de leurs
modèles, M. Robert de La Sizeranne interroge cette
fois au Louvre le portrait d'Isabelle d'Esté dessiné
par Léonard et les nombreux souvenirs d'elle que
possède notre musée, notamment ces peintures de
Mantegna, de Pérugin, de Costa, qui décoraient son
studiolo et dont Ch. Yriarte a jadis dans la
Gazette raconté la genèse (1); et avec le charme
évocateur dont il a le secret, il fait revivre à
notre esprit et à nos yeux la vie intime, politique,
artistique, de la marquise en sa cour de Mantoue,
dégage le sens de ces allégories dont elle dictait
minutieusement le détail à ses peintres et qui,sous
leur aspect ennuyeux et froid, sont de précieuses
confidences de son état d'âme, enfin nous la montre
passionnément collectionneuse d'objets d'art : au
total, une des figures les plus attirantes et les
plus représentatives de la Renaissance italienne en
sa période la plus vivante.
X Revue hebdomadaire (9 décembre). — Rel
article de M. Louis Gillet sur l'exposition inter-
nationale d'art chrétien actuellement ouverte au
Musée des Arts décoratifs (7 reprod.).
BIBLIOGRAPHIE
Les Vitraux du Moyen âge et de la Renais-
sance dans la région lyonnaise, par Lucien
Bégule. Lyon, A. Rey; Paris, Laurens. Un vol.
in-fol., 250 p. av. 275 fig. et xxxn planches.
M. Lucien Bégule vient de nous donner un livre
précieux : c'est un corpus des vitraux de la région
dont Lyon est le centre. Cette vaste région qui
comprend le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez, la
Bresse, le diocèse de Saint-Claude, la Savoie et le
Dauphiné n'est pas une des plus riches qu'il y ait
en France, mais on y trouve quelques-uns des
chefs-d'œuvre de la peinture sur verre : qu'il me
suffise de citer les grandes verrières de la cathé-
drale de Lyon, le vitrail de Champs enchâssé
comme une pierre précieuse dans la fenêtre d'une
pauvre église de campagne, les vitraux exquis de
Saint-André d'Apchon, l'ensemble unique d'Am-
bierle et les merveilles de Brou. Ces fameux vi-
traux de Brou ne sont pas entièrement français :
les cartons en furent dessinés par un peintre de
Bruxelles qui copia des gravures d'Albert Durer
et une gravure du Titien (2). Mais ce furent des ver-
riers lyonnais qui furent chargés de l'exécution :
et ici l'exkution est merveilleuse. Sans la magni-
ficence des couleurs, le plus beau carton du monde
ne ferait jamais qu'un pauvre vitrail. Ce qui fait
le vrai charme des verrières de Brou appartient
donc à notre vieille école.
Tous les vitraux que reproduit M. Bégule
sont intéressants par quelque côté. Ils présentent
de charmantes particularités iconographiques : à
(1) V. Qnzette des Beaux-Arts, 1895 et 1896.
(2) V. Gazette des Beiux Arts, 1900, t. I, p. 95.
CURIOSITÉ 293
Ghamelet, saint Sébastien est vêtu comme pouvait
l'être un membre d'une confrérie d'archers au xv»
siècle ; à Villefranche-sur-Saône, saint Jacques
nous offre une des images les plus parfaites du
pèlerin de Compostelle ; à Saint-Julien, dans le
Jura, on voit l'Enfant Jésus roulant en peloton la
laine que file la Vierge, puis recueillant dans sa
tunique les copeaux de l'atelier de saint Joseph.
Toutes ces œuvres, qu'il fallait voir en passant,
dont on emportait parfois une mauvaise photo-
graphie, faite à la hâte, on pourra désormais les
étudier à loisir dans les admirables planches de
M. Bégule. Que de peines lui ont coûtées ces
belles reproductions, ces calques patients ! Les
archéologues et les artistes ne sauraient trop le
remercier.il faut, pour entreprendre un ouvrage de
ce genre, avoir la passion de l'art français. M. Bé-
gule a cette passion : aussi, espérons-nous qu'il
nous donnera bientôt un autre corpus tout aussi
beau : celui des vitraux du centre de la France.
Emile Male.
Allgemeines Lexikon der bildenden Kùnstler,
von Ulrich Thikme. T. V (Brewer-Carlingen).
Leipzig, E.-A. Seemann,1911. Un vol. in-8°, 608 p.
Le cinquième volume de cette excellente publi-
cation vient de paraître et il mérite tout le bien
que nous avons dit des précédents. Il ne s'agit pas
d'une de ces compilations comme la librairie nous
en donne trop souvent, faites sans soin, à coups
de ciseaux, par des manœuvres et qui s'intitulent
en fin de compte «dictionnaire raisonné », sans qu'on
y puisse trouver autre chose que des banalités non
contrôlées. Près de trois cents collaborateurs, pour
la plupart parfaitement compétents, ont travaillé
à ce volume, résumant ce qu'on sait de la vie de
chaque artiste et de son œuvre et complétant de
substantiels articles par une bibliographie. Les
artistes français tiennent leur bonne place dans ce
tome V, avec Briot (par Demiani), Bullant (En-
lart),lesCaffieri(C. de Mandach),Cabanel(Vollmer),
Callot (Singer), sans compter tant d'autres nommés
dans un compte ou signalés dans un catalogue.
Mais, naturellement, les grands Italiens viennent
au premier rang: Brunelleschi (Limburger), Ca-
liari (Hadeln), Caravage (Posse). A signaler aussi
d'intéressantes notices sur les Brueghel par M. W.
Cohen, sur Burgkmair par M. Schmid, sur Bryg-
gos, le potier grec, par M. Sauer, et sur Burne-
Jones par M. Binyon. Ce dictionnaire, préparé en
collaboration par M. Becker et M. Thieme, a perdu
l'un de ses directeurs, M. Becker; mais l'autre se
montre prêt à continuer seul la tâche entreprise,
et l'ouvrage deviendra un instrument nécessaire
à tous 1-s travailleurs.
R. K.
Mùnchen, von Arthur Weese (2e édition). Leipzig,
E.-A. Seemann. Un vol. in-8% 254 p. avec 159 fig.
Nous nous bornons à annoncer la seconde édi-
tion de cet ouvrage excellent, déjà signalé ici, où
l'histoire artistique de la capitale bavaro'se se
trouve exposée de la façon la plus complète.
Au terme de son étude, qui s'arrête au seuil de
l'époque contemporaine, M. Weese déclare qu'il
faudrait, pour écrire l'histoire du Munich mo-
derne, non pas un « nouveau chapitre » mais un
« nouveau livre ». Souhaitons que l'auteur acquitte
bientôt cette traite tirée par lui sur lui-même.
Jean Chantavoine.
REVUE DES REVUES
\f Revue des Deux Mondes (15 novembre et
1er décembre). — Poursuivant ses pénétrantes res-
titutions, qu'il a intitulées Les Masques et les
Vierges, d'après ce que les portraits d'autrefois
nous révèlent de l'histoire et de la vie de leurs
modèles, M. Robert de La Sizeranne interroge cette
fois au Louvre le portrait d'Isabelle d'Esté dessiné
par Léonard et les nombreux souvenirs d'elle que
possède notre musée, notamment ces peintures de
Mantegna, de Pérugin, de Costa, qui décoraient son
studiolo et dont Ch. Yriarte a jadis dans la
Gazette raconté la genèse (1); et avec le charme
évocateur dont il a le secret, il fait revivre à
notre esprit et à nos yeux la vie intime, politique,
artistique, de la marquise en sa cour de Mantoue,
dégage le sens de ces allégories dont elle dictait
minutieusement le détail à ses peintres et qui,sous
leur aspect ennuyeux et froid, sont de précieuses
confidences de son état d'âme, enfin nous la montre
passionnément collectionneuse d'objets d'art : au
total, une des figures les plus attirantes et les
plus représentatives de la Renaissance italienne en
sa période la plus vivante.
X Revue hebdomadaire (9 décembre). — Rel
article de M. Louis Gillet sur l'exposition inter-
nationale d'art chrétien actuellement ouverte au
Musée des Arts décoratifs (7 reprod.).
BIBLIOGRAPHIE
Les Vitraux du Moyen âge et de la Renais-
sance dans la région lyonnaise, par Lucien
Bégule. Lyon, A. Rey; Paris, Laurens. Un vol.
in-fol., 250 p. av. 275 fig. et xxxn planches.
M. Lucien Bégule vient de nous donner un livre
précieux : c'est un corpus des vitraux de la région
dont Lyon est le centre. Cette vaste région qui
comprend le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez, la
Bresse, le diocèse de Saint-Claude, la Savoie et le
Dauphiné n'est pas une des plus riches qu'il y ait
en France, mais on y trouve quelques-uns des
chefs-d'œuvre de la peinture sur verre : qu'il me
suffise de citer les grandes verrières de la cathé-
drale de Lyon, le vitrail de Champs enchâssé
comme une pierre précieuse dans la fenêtre d'une
pauvre église de campagne, les vitraux exquis de
Saint-André d'Apchon, l'ensemble unique d'Am-
bierle et les merveilles de Brou. Ces fameux vi-
traux de Brou ne sont pas entièrement français :
les cartons en furent dessinés par un peintre de
Bruxelles qui copia des gravures d'Albert Durer
et une gravure du Titien (2). Mais ce furent des ver-
riers lyonnais qui furent chargés de l'exécution :
et ici l'exkution est merveilleuse. Sans la magni-
ficence des couleurs, le plus beau carton du monde
ne ferait jamais qu'un pauvre vitrail. Ce qui fait
le vrai charme des verrières de Brou appartient
donc à notre vieille école.
Tous les vitraux que reproduit M. Bégule
sont intéressants par quelque côté. Ils présentent
de charmantes particularités iconographiques : à
(1) V. Qnzette des Beaux-Arts, 1895 et 1896.
(2) V. Gazette des Beiux Arts, 1900, t. I, p. 95.
CURIOSITÉ 293
Ghamelet, saint Sébastien est vêtu comme pouvait
l'être un membre d'une confrérie d'archers au xv»
siècle ; à Villefranche-sur-Saône, saint Jacques
nous offre une des images les plus parfaites du
pèlerin de Compostelle ; à Saint-Julien, dans le
Jura, on voit l'Enfant Jésus roulant en peloton la
laine que file la Vierge, puis recueillant dans sa
tunique les copeaux de l'atelier de saint Joseph.
Toutes ces œuvres, qu'il fallait voir en passant,
dont on emportait parfois une mauvaise photo-
graphie, faite à la hâte, on pourra désormais les
étudier à loisir dans les admirables planches de
M. Bégule. Que de peines lui ont coûtées ces
belles reproductions, ces calques patients ! Les
archéologues et les artistes ne sauraient trop le
remercier.il faut, pour entreprendre un ouvrage de
ce genre, avoir la passion de l'art français. M. Bé-
gule a cette passion : aussi, espérons-nous qu'il
nous donnera bientôt un autre corpus tout aussi
beau : celui des vitraux du centre de la France.
Emile Male.
Allgemeines Lexikon der bildenden Kùnstler,
von Ulrich Thikme. T. V (Brewer-Carlingen).
Leipzig, E.-A. Seemann,1911. Un vol. in-8°, 608 p.
Le cinquième volume de cette excellente publi-
cation vient de paraître et il mérite tout le bien
que nous avons dit des précédents. Il ne s'agit pas
d'une de ces compilations comme la librairie nous
en donne trop souvent, faites sans soin, à coups
de ciseaux, par des manœuvres et qui s'intitulent
en fin de compte «dictionnaire raisonné », sans qu'on
y puisse trouver autre chose que des banalités non
contrôlées. Près de trois cents collaborateurs, pour
la plupart parfaitement compétents, ont travaillé
à ce volume, résumant ce qu'on sait de la vie de
chaque artiste et de son œuvre et complétant de
substantiels articles par une bibliographie. Les
artistes français tiennent leur bonne place dans ce
tome V, avec Briot (par Demiani), Bullant (En-
lart),lesCaffieri(C. de Mandach),Cabanel(Vollmer),
Callot (Singer), sans compter tant d'autres nommés
dans un compte ou signalés dans un catalogue.
Mais, naturellement, les grands Italiens viennent
au premier rang: Brunelleschi (Limburger), Ca-
liari (Hadeln), Caravage (Posse). A signaler aussi
d'intéressantes notices sur les Brueghel par M. W.
Cohen, sur Burgkmair par M. Schmid, sur Bryg-
gos, le potier grec, par M. Sauer, et sur Burne-
Jones par M. Binyon. Ce dictionnaire, préparé en
collaboration par M. Becker et M. Thieme, a perdu
l'un de ses directeurs, M. Becker; mais l'autre se
montre prêt à continuer seul la tâche entreprise,
et l'ouvrage deviendra un instrument nécessaire
à tous 1-s travailleurs.
R. K.
Mùnchen, von Arthur Weese (2e édition). Leipzig,
E.-A. Seemann. Un vol. in-8% 254 p. avec 159 fig.
Nous nous bornons à annoncer la seconde édi-
tion de cet ouvrage excellent, déjà signalé ici, où
l'histoire artistique de la capitale bavaro'se se
trouve exposée de la façon la plus complète.
Au terme de son étude, qui s'arrête au seuil de
l'époque contemporaine, M. Weese déclare qu'il
faudrait, pour écrire l'histoire du Munich mo-
derne, non pas un « nouveau chapitre » mais un
« nouveau livre ». Souhaitons que l'auteur acquitte
bientôt cette traite tirée par lui sur lui-même.
Jean Chantavoine.