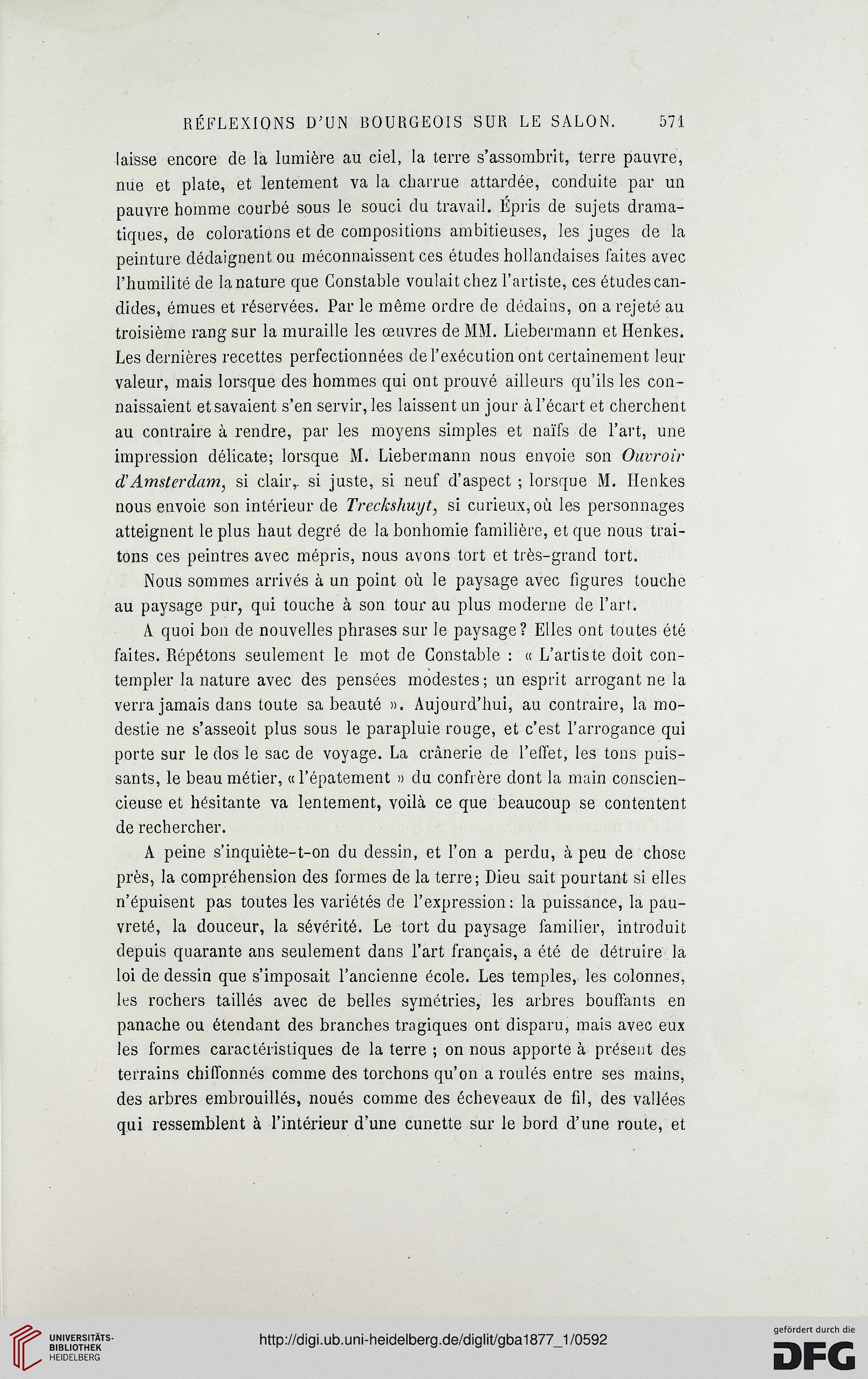RÉFLEXIONS D’UN BOURGEOIS SUR LE SALON.
571
laisse encore de la lumière au ciel, la terre s’assombrit, terre pauvre,
nue et plate, et lentement va la charrue attardée, conduite par un
pauvre homme courbé sous le souci du travail. Épris de sujets drama-
tiques, de colorations et de compositions ambitieuses, les juges de la
peinture dédaignent ou méconnaissent ces études hollandaises faites avec
l’humilité de la nature que Constable voulait chez l’artiste, ces études can-
dides, émues et réservées. Par le même ordre de dédains, on a rejeté au
troisième rang sur la muraille les œuvres de MM. Liebermann et Henkes.
Les dernières recettes perfectionnées de l’exécution ont certainement leur
valeur, mais lorsque des hommes qui ont prouvé ailleurs qu’ils les con-
naissaient etsavaient s’en servir, les laissent un jour à l’écart et cherchent
au contraire à rendre, par les moyens simples et naïfs de l’art, une
impression délicate; lorsque M. Liebermann nous envoie son Ouvroir
d’Amsterdam, si clairr si juste, si neuf d’aspect ; lorsque M. Henkes
nous envoie son intérieur de Treckshuyt, si curieux, où les personnages
atteignent le plus haut degré de la bonhomie familière, et que nous trai-
tons ces peintres avec mépris, nous avons tort et très-grand tort.
Nous sommes arrivés à un point où le paysage avec figures touche
au paysage pur, qui touche à son tour au plus moderne de l’art.
A quoi bon de nouvelles phrases sur le paysage? Elles ont toutes été
faites. Piépôtons seulement le mot de Constable : « L’artiste doit con-
templer la nature avec des pensées modestes; un esprit arrogant ne la
verra jamais dans toute sa beauté ». Aujourd’hui, au contraire, la mo-
destie ne s’asseoit plus sous le parapluie rouge, et c’est l’arrogance qui
porte sur le dos le sac de voyage. La crânerie de l’effet, les tons puis-
sants, le beau métier, «l’épatement » du confrère dont la main conscien-
cieuse et hésitante va lentement, voilà ce que beaucoup se contentent
de rechercher.
A peine s’inquiète-t-on du dessin, et l’on a perdu, à peu de chose
près, la compréhension des formes de la terre; Dieu sait pourtant si elles
n’épuisent pas toutes les variétés de l’expression: la puissance, la pau-
vreté, la douceur, la sévérité. Le tort du paysage familier, introduit
depuis quarante ans seulement dans l’art français, a été de détruire la
loi de dessin que s’imposait l’ancienne école. Les temples, les colonnes,
les rochers taillés avec de belles symétries, les arbres bouffants en
panache ou étendant des branches tragiques ont disparu, mais avec eux
les formes caractéristiques de la terre ; on nous apporte à présent des
terrains chiffonnés comme des torchons qu’on a roulés entre ses mains,
des arbres embrouillés, noués comme des écheveaux de fil, des vallées
qui ressemblent à l’intérieur d’une cunette sur le bord d’une route, et
571
laisse encore de la lumière au ciel, la terre s’assombrit, terre pauvre,
nue et plate, et lentement va la charrue attardée, conduite par un
pauvre homme courbé sous le souci du travail. Épris de sujets drama-
tiques, de colorations et de compositions ambitieuses, les juges de la
peinture dédaignent ou méconnaissent ces études hollandaises faites avec
l’humilité de la nature que Constable voulait chez l’artiste, ces études can-
dides, émues et réservées. Par le même ordre de dédains, on a rejeté au
troisième rang sur la muraille les œuvres de MM. Liebermann et Henkes.
Les dernières recettes perfectionnées de l’exécution ont certainement leur
valeur, mais lorsque des hommes qui ont prouvé ailleurs qu’ils les con-
naissaient etsavaient s’en servir, les laissent un jour à l’écart et cherchent
au contraire à rendre, par les moyens simples et naïfs de l’art, une
impression délicate; lorsque M. Liebermann nous envoie son Ouvroir
d’Amsterdam, si clairr si juste, si neuf d’aspect ; lorsque M. Henkes
nous envoie son intérieur de Treckshuyt, si curieux, où les personnages
atteignent le plus haut degré de la bonhomie familière, et que nous trai-
tons ces peintres avec mépris, nous avons tort et très-grand tort.
Nous sommes arrivés à un point où le paysage avec figures touche
au paysage pur, qui touche à son tour au plus moderne de l’art.
A quoi bon de nouvelles phrases sur le paysage? Elles ont toutes été
faites. Piépôtons seulement le mot de Constable : « L’artiste doit con-
templer la nature avec des pensées modestes; un esprit arrogant ne la
verra jamais dans toute sa beauté ». Aujourd’hui, au contraire, la mo-
destie ne s’asseoit plus sous le parapluie rouge, et c’est l’arrogance qui
porte sur le dos le sac de voyage. La crânerie de l’effet, les tons puis-
sants, le beau métier, «l’épatement » du confrère dont la main conscien-
cieuse et hésitante va lentement, voilà ce que beaucoup se contentent
de rechercher.
A peine s’inquiète-t-on du dessin, et l’on a perdu, à peu de chose
près, la compréhension des formes de la terre; Dieu sait pourtant si elles
n’épuisent pas toutes les variétés de l’expression: la puissance, la pau-
vreté, la douceur, la sévérité. Le tort du paysage familier, introduit
depuis quarante ans seulement dans l’art français, a été de détruire la
loi de dessin que s’imposait l’ancienne école. Les temples, les colonnes,
les rochers taillés avec de belles symétries, les arbres bouffants en
panache ou étendant des branches tragiques ont disparu, mais avec eux
les formes caractéristiques de la terre ; on nous apporte à présent des
terrains chiffonnés comme des torchons qu’on a roulés entre ses mains,
des arbres embrouillés, noués comme des écheveaux de fil, des vallées
qui ressemblent à l’intérieur d’une cunette sur le bord d’une route, et