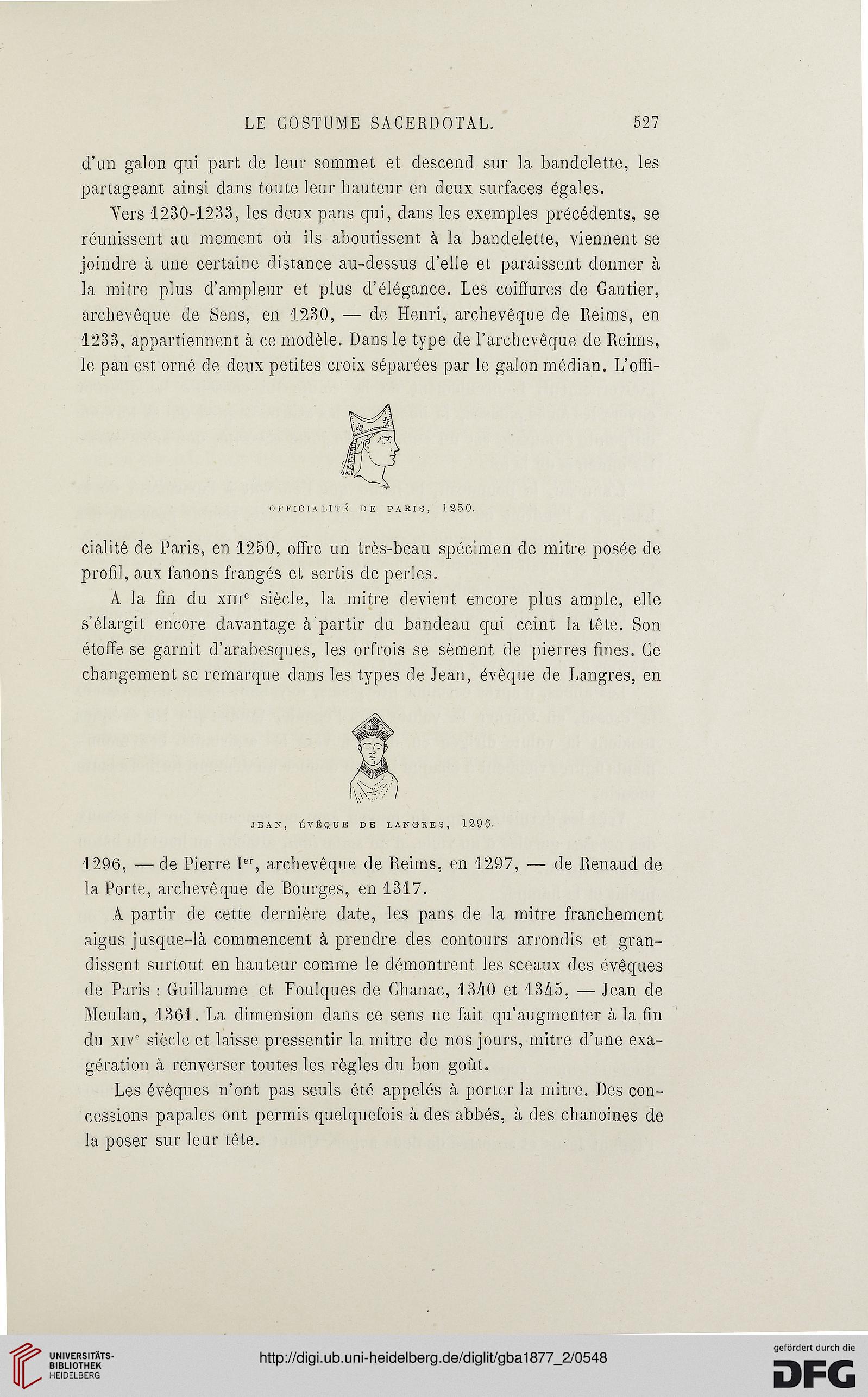LE COSTUME SACERDOTAL.
527
d’un galon qui part de leur sommet et descend sur la bandelette, les
partageant ainsi dans toute leur hauteur en deux surfaces égales.
Vers 1230-1233, les deux pans qui, dans les exemples précédents, se
réunissent au moment où ils aboutissent à la bandelette, viennent se
joindre à une certaine distance au-dessus d’elle et paraissent donner à
la mitre plus d’ampleur et plus d’élégance. Les coiffures de Gautier,
archevêque de Sens, en 1230, — de Henri, archevêque de Reims, en
1233, appartiennent à ce modèle. Dans le type de l’archevêque de Reims,
le pan est orné de deux petites croix séparées par le galon médian. L’offi-
OFFICIALITÉ DE PARIS, 125 0.
cialité de Paris, en 1250, offre un très-beau spécimen de mitre posée de
profil, aux fanons frangés et sertis de perles.
A la fin du xme siècle, la mitre devient encore plus ample, elle
s’élargit encore davantage à partir du bandeau qui ceint la tête. Son
étoffe se garnit d’arabesques, les orfrois se sèment de pierres fines. Ce
changement se remarque dans les types de Jean, évêque de Langres, en
JEAN, ÉVÊQUE DE LANGRES, 1296.
1296, — de Pierre Ier, archevêque de Reims, en 1297, — de Renaud de
la Porte, archevêque de Bourges, en 1317.
A partir de cette dernière date, les pans de la mitre franchement
aigus jusque-là commencent à prendre des contours arrondis et gran-
dissent surtout en hauteur comme le démontrent les sceaux des évêques
de Paris : Guillaume et Foulques de Chanac, 13à0 et 1345, — Jean de
Meulan, 1361. La dimension dans ce sens ne fait qu’augmenter à la fin
du xive siècle et laisse pressentir la mitre de nos jours, mitre d’une exa-
gération à renverser toutes les règles du bon goût.
Les évêques n’ont pas seuls été appelés à porter la mitre. Des con-
cessions papales ont permis quelquefois à des abbés, à des chanoines de
la poser sur leur tête.
527
d’un galon qui part de leur sommet et descend sur la bandelette, les
partageant ainsi dans toute leur hauteur en deux surfaces égales.
Vers 1230-1233, les deux pans qui, dans les exemples précédents, se
réunissent au moment où ils aboutissent à la bandelette, viennent se
joindre à une certaine distance au-dessus d’elle et paraissent donner à
la mitre plus d’ampleur et plus d’élégance. Les coiffures de Gautier,
archevêque de Sens, en 1230, — de Henri, archevêque de Reims, en
1233, appartiennent à ce modèle. Dans le type de l’archevêque de Reims,
le pan est orné de deux petites croix séparées par le galon médian. L’offi-
OFFICIALITÉ DE PARIS, 125 0.
cialité de Paris, en 1250, offre un très-beau spécimen de mitre posée de
profil, aux fanons frangés et sertis de perles.
A la fin du xme siècle, la mitre devient encore plus ample, elle
s’élargit encore davantage à partir du bandeau qui ceint la tête. Son
étoffe se garnit d’arabesques, les orfrois se sèment de pierres fines. Ce
changement se remarque dans les types de Jean, évêque de Langres, en
JEAN, ÉVÊQUE DE LANGRES, 1296.
1296, — de Pierre Ier, archevêque de Reims, en 1297, — de Renaud de
la Porte, archevêque de Bourges, en 1317.
A partir de cette dernière date, les pans de la mitre franchement
aigus jusque-là commencent à prendre des contours arrondis et gran-
dissent surtout en hauteur comme le démontrent les sceaux des évêques
de Paris : Guillaume et Foulques de Chanac, 13à0 et 1345, — Jean de
Meulan, 1361. La dimension dans ce sens ne fait qu’augmenter à la fin
du xive siècle et laisse pressentir la mitre de nos jours, mitre d’une exa-
gération à renverser toutes les règles du bon goût.
Les évêques n’ont pas seuls été appelés à porter la mitre. Des con-
cessions papales ont permis quelquefois à des abbés, à des chanoines de
la poser sur leur tête.