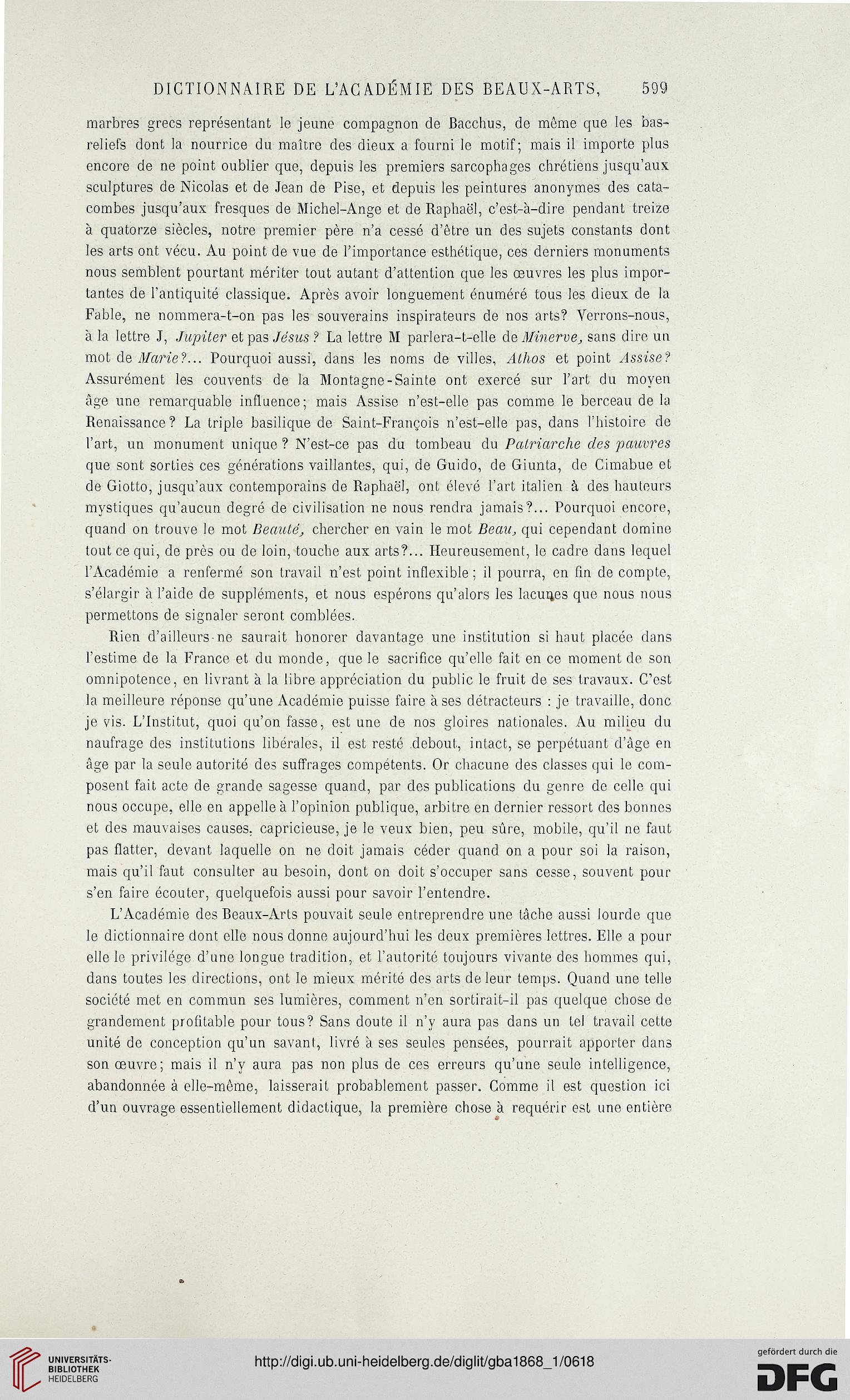DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS,
599
marbres grecs représentant le jeune compagnon de Bacchus, de môme que les bas-
reliefs dont la nourrice du maître des dieux a fourni le motif; mais il importe plus
encore de ne point oublier que, depuis les premiers sarcophages chrétiens jusqu'aux
sculptures de Nicolas et de Jean de Pise, et depuis les peintures anonymes des cata-
combes jusqu'aux fresques de Michel-Ange et de Raphaël, c'est-à-dire pendant treize
à quatorze siècles, notre premier père n'a cessé d'être un des sujets constants dont
les arts ont vécu. Au point de vue de l'importance esthétique, ces derniers monuments
nous semblent pourtant mériter tout autant d'attention que les œuvres les plus impor-
tantes de l'antiquité classique. Après avoir longuement énuméré tous les dieux de la
Fable, ne nommera-t-on pas les souverains inspirateurs de nos arts? Verrons-nous,
à la lettre J, Jupiter et pas Jésus ? La lettre M parlera-t-elle de Minerve, sans dire un
mot de Marie?... Pourquoi aussi, dans les noms de villes, Aihos et point Assise?
Assurément les couvents de la Montagne-Sainte ont exercé sur l'art du moyen
âge une remarquable influence; mais Assise n'est-elle pas comme le berceau de la
Renaissance? La triple basilique de Saint-François n'est-elle pas, dans l'histoire de
l'art, un monument unique ? N'est-ce pas du tombeau du Patriarche des pauvres
que sont sorties ces générations vaillantes, qui, de Guido, de Giunta, de Cimabue et
de Giotto, jusqu'aux contemporains de Raphaël, ont élevé l'art italien à des hauteurs
mystiques qu'aucun degré de civilisation ne nous rendra jamais?... Pourquoi encore,
quand on trouve le mot Beauté, chercher en vain le mot Beau, qui cependant domine
tout ce qui, de près ou de loin, touche aux arts?... Heureusement, le cadre dans lequel
l'Académie a renfermé son travail n'est point inflexible ; il pourra, en fin de compte,
s'élargir à l'aide de suppléments, et nous espérons qu'alors les lacun.es que nous nous
permettons de signaler seront comblées.
Rien d'ailleurs-ne saurait honorer davantage une institution si haut placée dans
l'estime de la France et du monde, que le sacrifice qu'elle fait en ce moment de son
omnipotence, en livrant à la libre appréciation du public le fruit de ses travaux. C'est
la meilleure réponse qu'une Académie puisse faire à ses détracteurs : je travaille, donc
je vis. L'Institut, quoi qu'on fasse, est une de nos gloires nationales. Au milieu du
naufrage des institutions libérales, il est resté .debout, intact, se perpétuant d'âge en
âge par la seule autorité des suffrages compétents. Or chacune des classes qui le com-
posent fait acte de grande sagesse quand, par des publications du genre de celle qui
nous occupe, elle en appelle à l'opinion publique, arbitre en dernier ressort des bonnes
et des mauvaises causes, capricieuse, je le veux bien, peu sûre, mobile, qu'il ne faut
pas flatter, devant laquelle on ne doit jamais céder quand on a pour soi la raison,
mais qu'il faut consulter au besoin, dont on doit s'occuper sans cesse, souvent pour
s'en faire écouter, quelquefois aussi pour savoir l'entendre.
L'Académie des Beaux-Arts pouvait seule entreprendre une tâche aussi lourde que
le dictionnaire dont elle nous donne aujourd'hui les deux premières lettres. Elle a pour
elle le privilège d'une longue tradition, et l'autorité toujours vivante des hommes qui,
dans toutes les directions, ont le mieux mérité des arts de leur temps. Quand une telle
société met en commun ses lumières, comment n'en sortirait-il pas quelque chose de
grandement profitable pour tous? Sans doute il n'y aura pas dans un tel travail cette
unité de conception qu'un savant, livré à ses seules pensées, pourrait apporter dans
son œuvre; mais il n'y aura pas non plus de ces erreurs qu'une seule intelligence,
abandonnée à elle-même, laisserait probablement passer. Gomme il est question ici
d'un ouvrage essentiellement didactique, la première chose à requérir est une entière
599
marbres grecs représentant le jeune compagnon de Bacchus, de môme que les bas-
reliefs dont la nourrice du maître des dieux a fourni le motif; mais il importe plus
encore de ne point oublier que, depuis les premiers sarcophages chrétiens jusqu'aux
sculptures de Nicolas et de Jean de Pise, et depuis les peintures anonymes des cata-
combes jusqu'aux fresques de Michel-Ange et de Raphaël, c'est-à-dire pendant treize
à quatorze siècles, notre premier père n'a cessé d'être un des sujets constants dont
les arts ont vécu. Au point de vue de l'importance esthétique, ces derniers monuments
nous semblent pourtant mériter tout autant d'attention que les œuvres les plus impor-
tantes de l'antiquité classique. Après avoir longuement énuméré tous les dieux de la
Fable, ne nommera-t-on pas les souverains inspirateurs de nos arts? Verrons-nous,
à la lettre J, Jupiter et pas Jésus ? La lettre M parlera-t-elle de Minerve, sans dire un
mot de Marie?... Pourquoi aussi, dans les noms de villes, Aihos et point Assise?
Assurément les couvents de la Montagne-Sainte ont exercé sur l'art du moyen
âge une remarquable influence; mais Assise n'est-elle pas comme le berceau de la
Renaissance? La triple basilique de Saint-François n'est-elle pas, dans l'histoire de
l'art, un monument unique ? N'est-ce pas du tombeau du Patriarche des pauvres
que sont sorties ces générations vaillantes, qui, de Guido, de Giunta, de Cimabue et
de Giotto, jusqu'aux contemporains de Raphaël, ont élevé l'art italien à des hauteurs
mystiques qu'aucun degré de civilisation ne nous rendra jamais?... Pourquoi encore,
quand on trouve le mot Beauté, chercher en vain le mot Beau, qui cependant domine
tout ce qui, de près ou de loin, touche aux arts?... Heureusement, le cadre dans lequel
l'Académie a renfermé son travail n'est point inflexible ; il pourra, en fin de compte,
s'élargir à l'aide de suppléments, et nous espérons qu'alors les lacun.es que nous nous
permettons de signaler seront comblées.
Rien d'ailleurs-ne saurait honorer davantage une institution si haut placée dans
l'estime de la France et du monde, que le sacrifice qu'elle fait en ce moment de son
omnipotence, en livrant à la libre appréciation du public le fruit de ses travaux. C'est
la meilleure réponse qu'une Académie puisse faire à ses détracteurs : je travaille, donc
je vis. L'Institut, quoi qu'on fasse, est une de nos gloires nationales. Au milieu du
naufrage des institutions libérales, il est resté .debout, intact, se perpétuant d'âge en
âge par la seule autorité des suffrages compétents. Or chacune des classes qui le com-
posent fait acte de grande sagesse quand, par des publications du genre de celle qui
nous occupe, elle en appelle à l'opinion publique, arbitre en dernier ressort des bonnes
et des mauvaises causes, capricieuse, je le veux bien, peu sûre, mobile, qu'il ne faut
pas flatter, devant laquelle on ne doit jamais céder quand on a pour soi la raison,
mais qu'il faut consulter au besoin, dont on doit s'occuper sans cesse, souvent pour
s'en faire écouter, quelquefois aussi pour savoir l'entendre.
L'Académie des Beaux-Arts pouvait seule entreprendre une tâche aussi lourde que
le dictionnaire dont elle nous donne aujourd'hui les deux premières lettres. Elle a pour
elle le privilège d'une longue tradition, et l'autorité toujours vivante des hommes qui,
dans toutes les directions, ont le mieux mérité des arts de leur temps. Quand une telle
société met en commun ses lumières, comment n'en sortirait-il pas quelque chose de
grandement profitable pour tous? Sans doute il n'y aura pas dans un tel travail cette
unité de conception qu'un savant, livré à ses seules pensées, pourrait apporter dans
son œuvre; mais il n'y aura pas non plus de ces erreurs qu'une seule intelligence,
abandonnée à elle-même, laisserait probablement passer. Gomme il est question ici
d'un ouvrage essentiellement didactique, la première chose à requérir est une entière