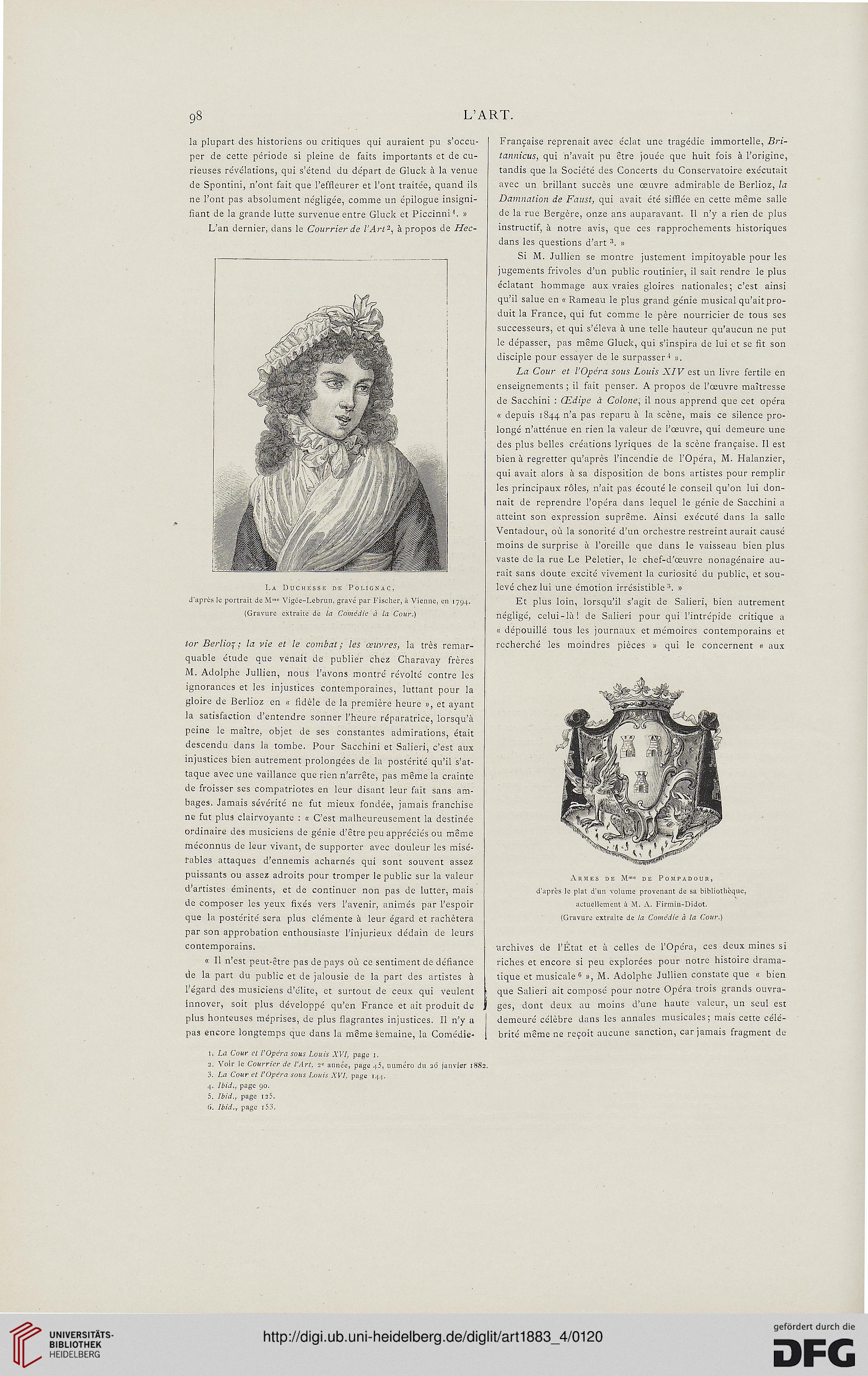98
L'ART.
la plupart des historiens ou critiques qui auraient pu s'occu-
per de cette période si pleine de faits importants et de cu-
rieuses révélations, qui s'étend du départ de Gluck à la venue
de Spontini, n'ont fait que l'effleurer et l'ont traitée, quand ils
ne l'ont pas absolument négligée, comme un épilogue insigni-
fiant de la grande lutte survenue entre Gluck et Piccinni '. »
L'an dernier, dans le Courrier de l'Art-, à propos de Hec-
La Duchesse de P'ômgnaç,
d'après le portrait de Mme Vigée-Lebruu. gravé par Fischer, à Vienne, en 1794.
(Gravure extraite de la Comédie à la Cour.)
(or Berlioj ; la vie et le combat; les œuvres, la très remar-
quable étude que venait de publier chez Charavay frères
M. Adolphe Jullien, nous l'avons montré révolté contre les
ignorances et les injustices contemporaines, luttant pour la
gloire de Berlioz en « fidèle de la première heure », et ayant
la satisfaction d'entendre sonner l'heure réparatrice, lorsqu'à
peine le maître, objet de ses constantes admirations, était
descendu dans la tombe. Pour Sacchini et Salieri, c'est aux
injustices bien autrement prolongées de la postérité qu'il s'at-
taque avec une vaillance que rien n'arrête, pas même la crainte
de froisser ses compatriotes en leur disant leur fait sans am-
bages. Jamais sévérité ne fut mieux fondée, jamais franchise
ne fut plus clairvoyante : « C'est malheureusement la destinée
ordinaire des musiciens de génie d'être peu appréciés ou même
méconnus de leur vivant, de supporter avec douleur les misé-
rables attaques d'ennemis acharnés qui sont souvent assez
puissants ou assez adroits pour tromper le public sur la valeur
d'artistes éminents, et de continuer non pas de lutter, mais
de composer les yeux fixés vers l'avenir, animés par l'espoir
que la postérité sera plus clémente à leur égard et rachètera
par son approbation enthousiaste l'injurieux dédain de leurs
contemporains.
« Il n'est peut-être pas de pays où ce sentiment de défiance
de la part du public et de jalousie de la part des artistes à
l'égard des musiciens d'élite, et surtout de ceux qui veulent
innover, soit plus développé qu'en France et ait produit de f
plus honteuses méprises, de plus flagrantes injustices. Il n'y a
pas encore longtemps que dans la même semaine, la Comédie-
1. La Cour et l'Opéra sous Louis XVI, page t.
2. Voir le Courrier de l'Art, 2' année, puge 45, numéro du 16 janvier 18S2.
3. La Cour et l'Opéra sous Louis XVI. page 141.
4. Ibid., page go.
5. Ibid., page 12?.
(t. Ibid., page 153.
Française reprenait avec éclat une tragédie immortelle, Bri-
tannicus, qui n'avait pu être jouée que huit fois à l'origine,
tandis que la Société des Concerts du Conservatoire exécutait
avec un brillant succès une œuvre admirable de Berlioz, la
Damnation de Faust, qui avait été sifHée en cette même salle
de la rue Bergère, onze ans auparavant. Il n'y a rien de plus
instructif, à notre avis, que ces rapprochements historiques
dans les questions d'art :i. »
Si M. Jullien se montre justement impitoyable pour les
jugements frivoles d'un public routinier, il sait rendre le plus
éclatant hommage aux vraies gloires nationales; c'est ainsi
qu'il salue en « Rameau le plus grand génie musical qu'ait pro-
duit la France, qui fut comme le père nourricier de tous ses
successeurs, et qui s'éleva à une telle hauteur qu'aucun ne put
le dépasser, pas même Gluck, qui s'inspira de lui et se fit son
disciple pour essayer de le surpasser ' ».
La Cour et l'Opéra sous Louis XIV est un livre fertile en
enseignements ; il fait penser. A propos de l'œuvre maîtresse
de Sacchini : Œdipe à Colone, il nous apprend que cet opéra
« depuis 1844 n'a pas reparu à la scène, mais ce silence pro-
longé n'atténue en rien la valeur de l'œuvre, qui demeure une
des plus belles créations lyriques de la scène française. Il est
bien à regretter qu'après l'incendie de l'Opéra, M. Halanzier,
qui avait alors à sa disposition de bons artistes pour remplir
les principaux rôles, n'ait pas écouté le conseil qu'on lui don-
nait de reprendre l'opéra dans lequel le génie de Sacchini a
atteint son expression suprême. Ainsi exécuté dans la salle
Ventadour, où la sonorité d'un orchestre restreint aurait causé
moins de surprise à l'oreille que dans le vaisseau bien plus
vaste de la rue Le Peletier, le chef-d'œuvre nonagénaire au-
rait sans doute excité vivement la curiosité du public, et sou-
levé chez lui une émotion irrésistible '■>. »
Et plus loin, lorsqu'il s'agit de Salieri, bien autrement
négligé, celui-là! de Salieri pour qui l'intrépide critique a
« dépouillé tous les journaux et mémoires contemporains et
recherché les moindres pièces » qui le concernent « aux
Armes de Mm" de Pompadour,
d'après le plat d'un volume provenant de sa bibliothèque,
actuellement à M. A. Firmin-Didot.
(Gravure extraite de la Comédie à la Cour.)
'archives de l'État et à celles de l'Opéra, ces deux mines si
riches et encore si peu explorées pour notre histoire drama-
tique et musicale11 », M. Adolphe Jullien constate que « bien
que Salieri ait composé pour notre Opéra trois grands ouvra-
ges, dont deux au moins d'une haute valeur, un seul est
demeuré célèbre dans les annales musicales ; mais cette célé-
brité même ne reçoit aucune sanction, car jamais fragment de
L'ART.
la plupart des historiens ou critiques qui auraient pu s'occu-
per de cette période si pleine de faits importants et de cu-
rieuses révélations, qui s'étend du départ de Gluck à la venue
de Spontini, n'ont fait que l'effleurer et l'ont traitée, quand ils
ne l'ont pas absolument négligée, comme un épilogue insigni-
fiant de la grande lutte survenue entre Gluck et Piccinni '. »
L'an dernier, dans le Courrier de l'Art-, à propos de Hec-
La Duchesse de P'ômgnaç,
d'après le portrait de Mme Vigée-Lebruu. gravé par Fischer, à Vienne, en 1794.
(Gravure extraite de la Comédie à la Cour.)
(or Berlioj ; la vie et le combat; les œuvres, la très remar-
quable étude que venait de publier chez Charavay frères
M. Adolphe Jullien, nous l'avons montré révolté contre les
ignorances et les injustices contemporaines, luttant pour la
gloire de Berlioz en « fidèle de la première heure », et ayant
la satisfaction d'entendre sonner l'heure réparatrice, lorsqu'à
peine le maître, objet de ses constantes admirations, était
descendu dans la tombe. Pour Sacchini et Salieri, c'est aux
injustices bien autrement prolongées de la postérité qu'il s'at-
taque avec une vaillance que rien n'arrête, pas même la crainte
de froisser ses compatriotes en leur disant leur fait sans am-
bages. Jamais sévérité ne fut mieux fondée, jamais franchise
ne fut plus clairvoyante : « C'est malheureusement la destinée
ordinaire des musiciens de génie d'être peu appréciés ou même
méconnus de leur vivant, de supporter avec douleur les misé-
rables attaques d'ennemis acharnés qui sont souvent assez
puissants ou assez adroits pour tromper le public sur la valeur
d'artistes éminents, et de continuer non pas de lutter, mais
de composer les yeux fixés vers l'avenir, animés par l'espoir
que la postérité sera plus clémente à leur égard et rachètera
par son approbation enthousiaste l'injurieux dédain de leurs
contemporains.
« Il n'est peut-être pas de pays où ce sentiment de défiance
de la part du public et de jalousie de la part des artistes à
l'égard des musiciens d'élite, et surtout de ceux qui veulent
innover, soit plus développé qu'en France et ait produit de f
plus honteuses méprises, de plus flagrantes injustices. Il n'y a
pas encore longtemps que dans la même semaine, la Comédie-
1. La Cour et l'Opéra sous Louis XVI, page t.
2. Voir le Courrier de l'Art, 2' année, puge 45, numéro du 16 janvier 18S2.
3. La Cour et l'Opéra sous Louis XVI. page 141.
4. Ibid., page go.
5. Ibid., page 12?.
(t. Ibid., page 153.
Française reprenait avec éclat une tragédie immortelle, Bri-
tannicus, qui n'avait pu être jouée que huit fois à l'origine,
tandis que la Société des Concerts du Conservatoire exécutait
avec un brillant succès une œuvre admirable de Berlioz, la
Damnation de Faust, qui avait été sifHée en cette même salle
de la rue Bergère, onze ans auparavant. Il n'y a rien de plus
instructif, à notre avis, que ces rapprochements historiques
dans les questions d'art :i. »
Si M. Jullien se montre justement impitoyable pour les
jugements frivoles d'un public routinier, il sait rendre le plus
éclatant hommage aux vraies gloires nationales; c'est ainsi
qu'il salue en « Rameau le plus grand génie musical qu'ait pro-
duit la France, qui fut comme le père nourricier de tous ses
successeurs, et qui s'éleva à une telle hauteur qu'aucun ne put
le dépasser, pas même Gluck, qui s'inspira de lui et se fit son
disciple pour essayer de le surpasser ' ».
La Cour et l'Opéra sous Louis XIV est un livre fertile en
enseignements ; il fait penser. A propos de l'œuvre maîtresse
de Sacchini : Œdipe à Colone, il nous apprend que cet opéra
« depuis 1844 n'a pas reparu à la scène, mais ce silence pro-
longé n'atténue en rien la valeur de l'œuvre, qui demeure une
des plus belles créations lyriques de la scène française. Il est
bien à regretter qu'après l'incendie de l'Opéra, M. Halanzier,
qui avait alors à sa disposition de bons artistes pour remplir
les principaux rôles, n'ait pas écouté le conseil qu'on lui don-
nait de reprendre l'opéra dans lequel le génie de Sacchini a
atteint son expression suprême. Ainsi exécuté dans la salle
Ventadour, où la sonorité d'un orchestre restreint aurait causé
moins de surprise à l'oreille que dans le vaisseau bien plus
vaste de la rue Le Peletier, le chef-d'œuvre nonagénaire au-
rait sans doute excité vivement la curiosité du public, et sou-
levé chez lui une émotion irrésistible '■>. »
Et plus loin, lorsqu'il s'agit de Salieri, bien autrement
négligé, celui-là! de Salieri pour qui l'intrépide critique a
« dépouillé tous les journaux et mémoires contemporains et
recherché les moindres pièces » qui le concernent « aux
Armes de Mm" de Pompadour,
d'après le plat d'un volume provenant de sa bibliothèque,
actuellement à M. A. Firmin-Didot.
(Gravure extraite de la Comédie à la Cour.)
'archives de l'État et à celles de l'Opéra, ces deux mines si
riches et encore si peu explorées pour notre histoire drama-
tique et musicale11 », M. Adolphe Jullien constate que « bien
que Salieri ait composé pour notre Opéra trois grands ouvra-
ges, dont deux au moins d'une haute valeur, un seul est
demeuré célèbre dans les annales musicales ; mais cette célé-
brité même ne reçoit aucune sanction, car jamais fragment de