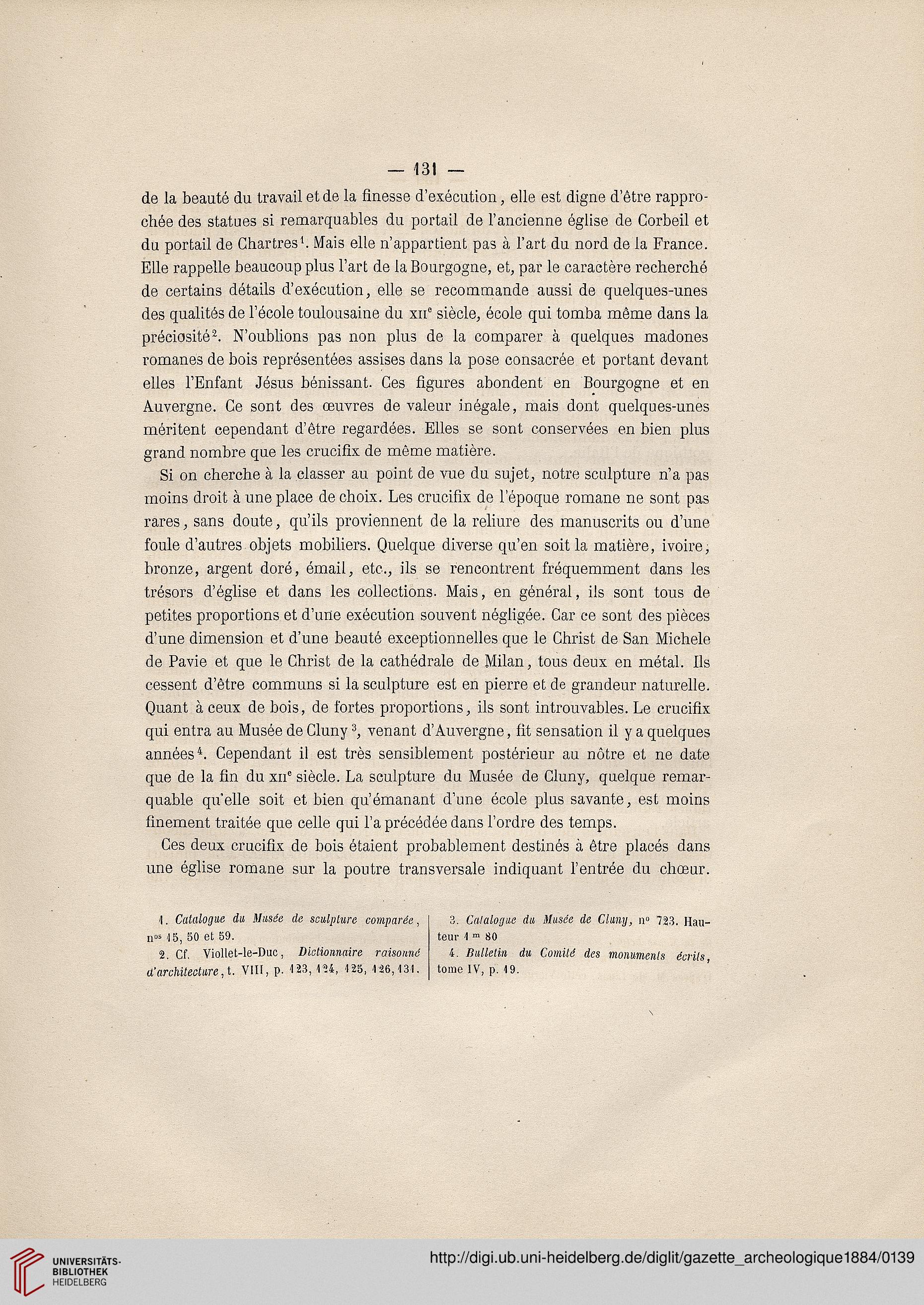— 131 —
de la beauté du travail et de la finesse d’exécution, elle est digne d’être rappro-
chée des statues si remarquables du portail de l’ancienne église de Corbeil et
du portail de Chartres 1. Mais elle n’appartient pas à l’art du nord de la France.
Elle rappelle beaucoup plus l’art de ia Bourgogne, et, par le caractère recherché
de certains détails d’exécution, elle se recommande aussi de quelques-unes
des qualités de l’école toulousaine du xu° siècle, école qui tomba meme dans la
préciosité 2. N’oublions pas non plus de la comparer à quelques madones
romanes de bois représentées assises dans la pose consacrée et portant devant
elles l’Enfant Jésus bénissant. Ces figures abondent en Bourgogne et en
Auvergne. Ce sont des œuvres de valeur inégale, mais dont quelques-unes
méritent cependant d’ètre regardées. Elles se sont conservées en bien plus
grand nombre que les crucifîx de mème matière.
Si on cherche à la classer au point de vue du sujet, notre sculpture n’a pas
moins droit àuneplace dechoix. Les crucifix de lepoque romane ne sont pas
rares, sans doute, qu’ils proviennent de la reliure des manuscrits ou d’une
foule d’autres objets mobiliers. Quelque diverse qu’en soit la matière, ivoire,
bronze, argent doré, émail, etc., ils se rencontrent fréquemment dans les
trésors d’église et dans les collections. Mais, en général, ils sont tous de
petites proportions et d’une exécution souvent négligée. Gar ce sont des pièces
d’une dimension et d’une beauté exceptionnelles que le Christ de San Michele
de Pavie et que le Christ de la cathédrale de Milan, tous deux en métal. Ils
cessent d’être communs si la sculpture est en pierre et de grandeur naturelle.
Quant à ceux de bois, de fortes proportions, ils sont introuvables. Le crucifix
qui entra au Musée de Cluny 3, venant d’Auvergne, fit sensation il y a quelques
années 4. Cependant il est très sensiblement postérieur au nôtre et ne date
que de la fin du xn c siècle. La sculpture du Musée de Cluny, quelque remar-
quable qu’elle soit et bien qu’émanant d’une école plus savante, est moins
finement traitée que celle qui l’a précédée dans i’ordre des temps.
Ces deux crucifîx de bois étaient probablement destinés à être placés dans
une église romane sur la poutre transversale indiquant l’entrée du choeur.
<1. Caialogue da Mnsde de scuiplure comparée,
n° s -15, 50 et 59.
2. Cf. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonnc
d'architectare,t. VIII, p. 123, 124, 125, 126,131.
3. Calalogue dn Musde de Cluny, n° 723. Hau-
teur 1 m 80
4. Dulletin du Comité des mommenls écvils,
tome IV, p. 19.
de la beauté du travail et de la finesse d’exécution, elle est digne d’être rappro-
chée des statues si remarquables du portail de l’ancienne église de Corbeil et
du portail de Chartres 1. Mais elle n’appartient pas à l’art du nord de la France.
Elle rappelle beaucoup plus l’art de ia Bourgogne, et, par le caractère recherché
de certains détails d’exécution, elle se recommande aussi de quelques-unes
des qualités de l’école toulousaine du xu° siècle, école qui tomba meme dans la
préciosité 2. N’oublions pas non plus de la comparer à quelques madones
romanes de bois représentées assises dans la pose consacrée et portant devant
elles l’Enfant Jésus bénissant. Ces figures abondent en Bourgogne et en
Auvergne. Ce sont des œuvres de valeur inégale, mais dont quelques-unes
méritent cependant d’ètre regardées. Elles se sont conservées en bien plus
grand nombre que les crucifîx de mème matière.
Si on cherche à la classer au point de vue du sujet, notre sculpture n’a pas
moins droit àuneplace dechoix. Les crucifix de lepoque romane ne sont pas
rares, sans doute, qu’ils proviennent de la reliure des manuscrits ou d’une
foule d’autres objets mobiliers. Quelque diverse qu’en soit la matière, ivoire,
bronze, argent doré, émail, etc., ils se rencontrent fréquemment dans les
trésors d’église et dans les collections. Mais, en général, ils sont tous de
petites proportions et d’une exécution souvent négligée. Gar ce sont des pièces
d’une dimension et d’une beauté exceptionnelles que le Christ de San Michele
de Pavie et que le Christ de la cathédrale de Milan, tous deux en métal. Ils
cessent d’être communs si la sculpture est en pierre et de grandeur naturelle.
Quant à ceux de bois, de fortes proportions, ils sont introuvables. Le crucifix
qui entra au Musée de Cluny 3, venant d’Auvergne, fit sensation il y a quelques
années 4. Cependant il est très sensiblement postérieur au nôtre et ne date
que de la fin du xn c siècle. La sculpture du Musée de Cluny, quelque remar-
quable qu’elle soit et bien qu’émanant d’une école plus savante, est moins
finement traitée que celle qui l’a précédée dans i’ordre des temps.
Ces deux crucifîx de bois étaient probablement destinés à être placés dans
une église romane sur la poutre transversale indiquant l’entrée du choeur.
<1. Caialogue da Mnsde de scuiplure comparée,
n° s -15, 50 et 59.
2. Cf. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonnc
d'architectare,t. VIII, p. 123, 124, 125, 126,131.
3. Calalogue dn Musde de Cluny, n° 723. Hau-
teur 1 m 80
4. Dulletin du Comité des mommenls écvils,
tome IV, p. 19.