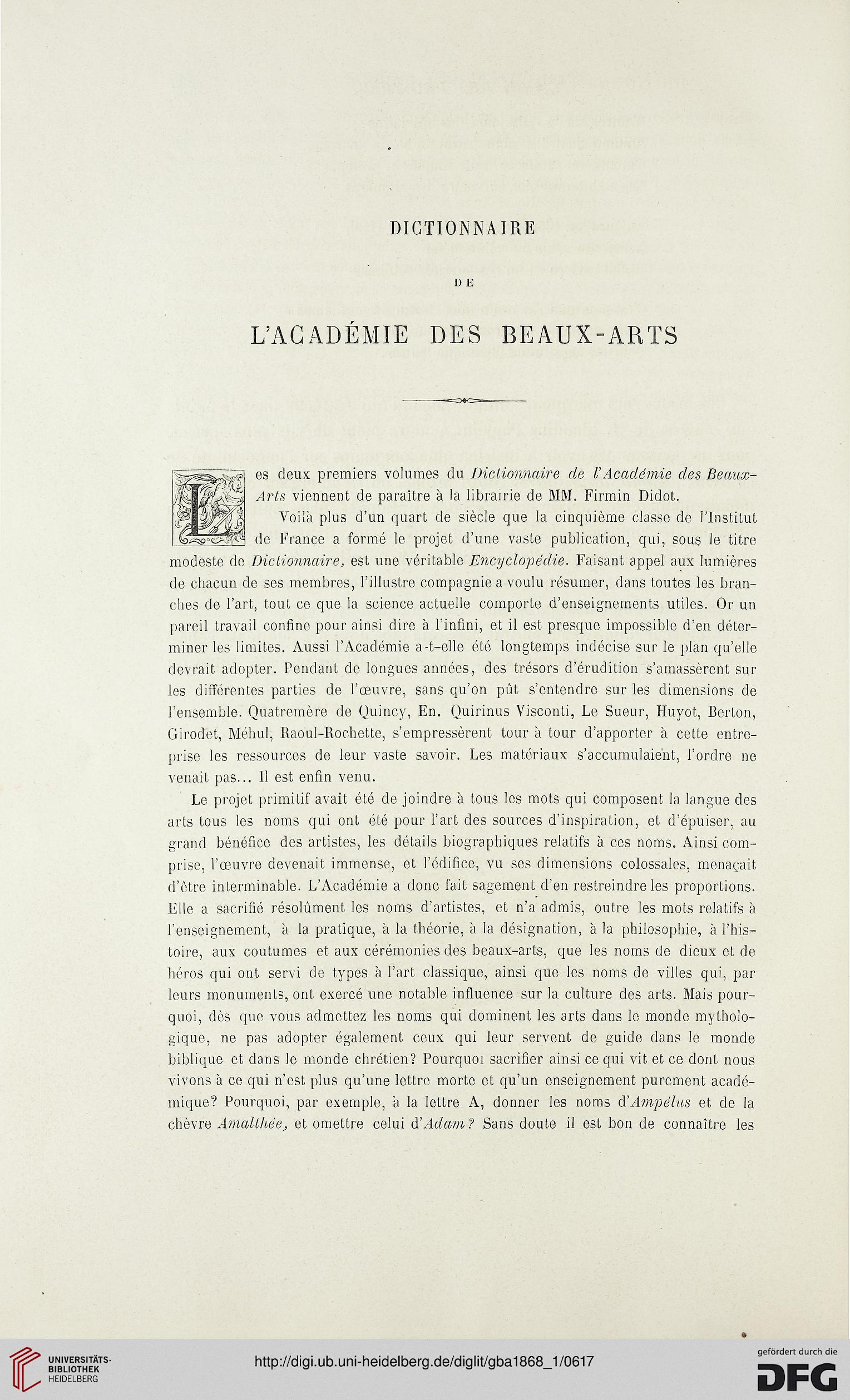DICTIONNAIRE
L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
es deux premiers volumes du Dictionnaire de VAcadémie des Beaux-
Arts viennent de paraître à la librairie de MM. Firmin Didot.
Voilà plus d'un quart de siècle que la cinquième classe de l'Institut
de France a formé le projet d'une vaste publication, qui, sous le titre
modeste de Dictionnaire, est une véritable Encyclopédie. Faisant appel aux lumières
de chacun de ses membres, l'illustre compagnie a voulu résumer, dans toutes les bran-
ches de l'art, (oui ce que la science actuelle comporte d'enseignements utiles. Or un
pareil travail confine pour ainsi dire à l'infini, et il est presque impossible d'en déter-
miner les limites. Aussi l'Académie a-t-elle été longtemps indécise sur le plan qu'elle
devrait adopter. Pendant de longues années, des trésors d'érudition s'amassèrent sur
les différentes parties de l'œuvre, sans qu'on pût s'entendre sur les dimensions de
l'ensemble. Quatremère de Quincy, En. Ouirinus Visconti, Le Sueur, Huyot, Berton,
Girodet, Méhul, Raoul-Rochette, s'empressèrent tour à tour d'apporter à cette entre-
prise les ressources de leur vaste savoir. Les matériaux s'accumulaient, l'ordre ne
venait pas... 11 est enfin venu.
Le projet primitif avait été de joindre à tous les mots qui composent la langue des
arts tous les noms qui ont été pour l'art des sources d'inspiration, et d'épuiser, au
grand bénéfice des artistes, les détails biographiques relatifs à ces noms. Ainsi com-
prise, l'œuvre devenait immense, et l'édifice, vu ses dimensions colossales, menaçait
d'être interminable. L'Académie a donc fait sagement d'en restreindre les proportions.
Elle a sacrifié résolûment les noms d'artistes, et n'a admis, outre les mots relatifs à
l'enseignement, à la pratique, k la théorie, à la désignation, à la philosophie, à l'his-
toire, aux coutumes et aux cérémonies des beaux-arts, que les noms de dieux et de
héros qui ont servi de types à l'art classique, ainsi que les noms de villes qui, par
leurs monuments, ont exercé une notable influence sur la culture des arts. Mais pour-
quoi, dès que vous admettez les noms qui dominent les arts dans le monde mytholo-
gique, ne pas adopter également ceux qui leur servent de guide dans le monde
biblique et dans le monde chrétien? Pourquoi sacrifier ainsi ce qui vit et ce dont nous
vivons à ce qui n'est plus qu'une lettre morte et qu'un enseignement purement acadé-
mique? Pourquoi, par exemple, à la lettre A, donner les noms d'Ampélus et de la
chèvre Amallkée, et omettre celui d'Adam? Sans doute il est bon de connaître les
L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
es deux premiers volumes du Dictionnaire de VAcadémie des Beaux-
Arts viennent de paraître à la librairie de MM. Firmin Didot.
Voilà plus d'un quart de siècle que la cinquième classe de l'Institut
de France a formé le projet d'une vaste publication, qui, sous le titre
modeste de Dictionnaire, est une véritable Encyclopédie. Faisant appel aux lumières
de chacun de ses membres, l'illustre compagnie a voulu résumer, dans toutes les bran-
ches de l'art, (oui ce que la science actuelle comporte d'enseignements utiles. Or un
pareil travail confine pour ainsi dire à l'infini, et il est presque impossible d'en déter-
miner les limites. Aussi l'Académie a-t-elle été longtemps indécise sur le plan qu'elle
devrait adopter. Pendant de longues années, des trésors d'érudition s'amassèrent sur
les différentes parties de l'œuvre, sans qu'on pût s'entendre sur les dimensions de
l'ensemble. Quatremère de Quincy, En. Ouirinus Visconti, Le Sueur, Huyot, Berton,
Girodet, Méhul, Raoul-Rochette, s'empressèrent tour à tour d'apporter à cette entre-
prise les ressources de leur vaste savoir. Les matériaux s'accumulaient, l'ordre ne
venait pas... 11 est enfin venu.
Le projet primitif avait été de joindre à tous les mots qui composent la langue des
arts tous les noms qui ont été pour l'art des sources d'inspiration, et d'épuiser, au
grand bénéfice des artistes, les détails biographiques relatifs à ces noms. Ainsi com-
prise, l'œuvre devenait immense, et l'édifice, vu ses dimensions colossales, menaçait
d'être interminable. L'Académie a donc fait sagement d'en restreindre les proportions.
Elle a sacrifié résolûment les noms d'artistes, et n'a admis, outre les mots relatifs à
l'enseignement, à la pratique, k la théorie, à la désignation, à la philosophie, à l'his-
toire, aux coutumes et aux cérémonies des beaux-arts, que les noms de dieux et de
héros qui ont servi de types à l'art classique, ainsi que les noms de villes qui, par
leurs monuments, ont exercé une notable influence sur la culture des arts. Mais pour-
quoi, dès que vous admettez les noms qui dominent les arts dans le monde mytholo-
gique, ne pas adopter également ceux qui leur servent de guide dans le monde
biblique et dans le monde chrétien? Pourquoi sacrifier ainsi ce qui vit et ce dont nous
vivons à ce qui n'est plus qu'une lettre morte et qu'un enseignement purement acadé-
mique? Pourquoi, par exemple, à la lettre A, donner les noms d'Ampélus et de la
chèvre Amallkée, et omettre celui d'Adam? Sans doute il est bon de connaître les