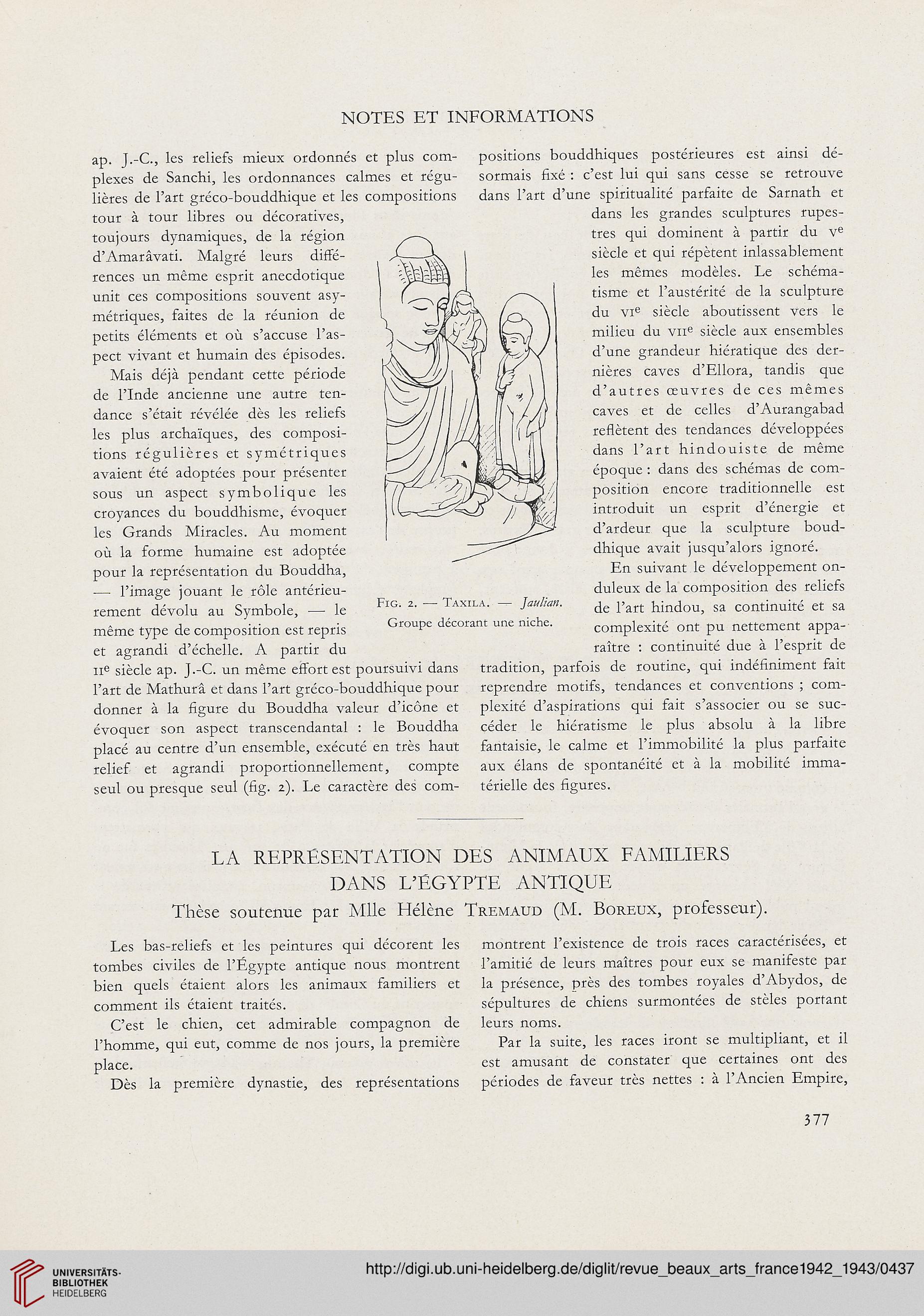NOTES ET INFORMATIONS
ap. J.-C., les reliefs mieux ordonnés et plus com-
plexes de Sanchi, les ordonnances calmes et régu-
lières de l’art gréco-bouddhique et les compositions
tour à tour libres ou décoratives,
toujours dynamiques, de la région
d’Amarâvati. Malgré leurs diffé-
rences un même esprit anecdotique
unit ces compositions souvent asy-
métriques, faites de la réunion de
petits éléments et où s’accuse l’as-
pect vivant et humain des épisodes.
Mais déjà pendant cette période
de l’Inde ancienne une autre ten-
dance s’était révélée dès les reliefs
les plus archaïques, des composi-
tions régulières et symétriques
avaient été adoptées pour présenter
sous un aspect symbolique les
croyances du bouddhisme, évoquer
les Grands Miracles. Au moment
où la forme humaine est adoptée
pour la représentation du Bouddha,
— l’image jouant le rôle antérieu-
rement dévolu au Symbole, — le
même type de composition est repris
et agrandi d’échelle. A partir du
11e siècle ap. J.-C. un même effort est poursuivi dans
l’art de Mathurâ et dans l’art gréco-bouddhique pour
donner à la figure du Bouddha valeur d’icône et
évoquer son aspect transcendantal : le Bouddha
placé au centre d’un ensemble, exécuté en très haut
relief et agrandi proportionnellement, compte
seul ou presque seul (fig. 2). Le caractère des com-
positions bouddhiques postérieures est ainsi dé-
sormais fixé : c’est lui qui sans cesse se retrouve
dans l’art d’une spiritualité parfaite de Sarnath et
dans les grandes sculptures rupes-
tres qui dominent à partir du ve
siècle et qui répètent inlassablement
les mêmes modèles. Le schéma-
tisme et l’austérité de la sculpture
du VIe siècle aboutissent vers le
milieu du vne siècle aux ensembles
d’une grandeur hiératique des der-
nières caves d’Ellora, tandis que
d’autres œuvres de ces mêmes
caves et de celles d’Aurangabad
reflètent des tendances développées
dans l’art hindouiste de même
époque : dans des schémas de com-
position encore traditionnelle est
introduit un esprit d’énergie et
d’ardeur que la sculpture boud-
dhique avait jusqu’alors ignoré.
En suivant le développement on-
duleux de la composition des reliefs
de l’art hindou, sa continuité et sa
complexité ont pu nettement appa-
raître : continuité due à l’esprit de
tradition, parfois de routine, qui indéfiniment fait
reprendre motifs, tendances et conventions ; com-
plexité d’aspirations qui fait s’associer ou se suc-
céder le hiératisme le plus absolu à la libre
fantaisie, le calme et l’immobilité la plus parfaite
aux élans de spontanéité et à la mobilité imma-
térielle des figures.
Fig. 2. — Taxila. — Jaulian.
Groupe décorant une niche.
LA REPRÉSENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS
DANS L’ÉGYPTE ANTIQUE
Thèse soutenue par Mlle Hélène Tremaud (M. Boreux, professeur).
Les bas-reliefs et les peintures qui décorent les
tombes civiles de l’Égypte antique nous montrent
bien quels étaient alors les animaux familiers et
comment ils étaient traités.
C’est le chien, cet admirable compagnon de
l’homme, qui eut, comme de nos jours, la première
place.
Dès la première dynastie, des représentations
montrent l’existence de trois races caractérisées, et
l’amitié de leurs maîtres pour eux se manifeste par
la présence, près des tombes royales d’Abydos, de
sépultures de chiens surmontées de stèles portant
leurs noms.
Par la suite, les races iront se multipliant, et il
est amusant de constater que certaines ont des
périodes de faveur très nettes : à l’Ancien Empire,
377
ap. J.-C., les reliefs mieux ordonnés et plus com-
plexes de Sanchi, les ordonnances calmes et régu-
lières de l’art gréco-bouddhique et les compositions
tour à tour libres ou décoratives,
toujours dynamiques, de la région
d’Amarâvati. Malgré leurs diffé-
rences un même esprit anecdotique
unit ces compositions souvent asy-
métriques, faites de la réunion de
petits éléments et où s’accuse l’as-
pect vivant et humain des épisodes.
Mais déjà pendant cette période
de l’Inde ancienne une autre ten-
dance s’était révélée dès les reliefs
les plus archaïques, des composi-
tions régulières et symétriques
avaient été adoptées pour présenter
sous un aspect symbolique les
croyances du bouddhisme, évoquer
les Grands Miracles. Au moment
où la forme humaine est adoptée
pour la représentation du Bouddha,
— l’image jouant le rôle antérieu-
rement dévolu au Symbole, — le
même type de composition est repris
et agrandi d’échelle. A partir du
11e siècle ap. J.-C. un même effort est poursuivi dans
l’art de Mathurâ et dans l’art gréco-bouddhique pour
donner à la figure du Bouddha valeur d’icône et
évoquer son aspect transcendantal : le Bouddha
placé au centre d’un ensemble, exécuté en très haut
relief et agrandi proportionnellement, compte
seul ou presque seul (fig. 2). Le caractère des com-
positions bouddhiques postérieures est ainsi dé-
sormais fixé : c’est lui qui sans cesse se retrouve
dans l’art d’une spiritualité parfaite de Sarnath et
dans les grandes sculptures rupes-
tres qui dominent à partir du ve
siècle et qui répètent inlassablement
les mêmes modèles. Le schéma-
tisme et l’austérité de la sculpture
du VIe siècle aboutissent vers le
milieu du vne siècle aux ensembles
d’une grandeur hiératique des der-
nières caves d’Ellora, tandis que
d’autres œuvres de ces mêmes
caves et de celles d’Aurangabad
reflètent des tendances développées
dans l’art hindouiste de même
époque : dans des schémas de com-
position encore traditionnelle est
introduit un esprit d’énergie et
d’ardeur que la sculpture boud-
dhique avait jusqu’alors ignoré.
En suivant le développement on-
duleux de la composition des reliefs
de l’art hindou, sa continuité et sa
complexité ont pu nettement appa-
raître : continuité due à l’esprit de
tradition, parfois de routine, qui indéfiniment fait
reprendre motifs, tendances et conventions ; com-
plexité d’aspirations qui fait s’associer ou se suc-
céder le hiératisme le plus absolu à la libre
fantaisie, le calme et l’immobilité la plus parfaite
aux élans de spontanéité et à la mobilité imma-
térielle des figures.
Fig. 2. — Taxila. — Jaulian.
Groupe décorant une niche.
LA REPRÉSENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS
DANS L’ÉGYPTE ANTIQUE
Thèse soutenue par Mlle Hélène Tremaud (M. Boreux, professeur).
Les bas-reliefs et les peintures qui décorent les
tombes civiles de l’Égypte antique nous montrent
bien quels étaient alors les animaux familiers et
comment ils étaient traités.
C’est le chien, cet admirable compagnon de
l’homme, qui eut, comme de nos jours, la première
place.
Dès la première dynastie, des représentations
montrent l’existence de trois races caractérisées, et
l’amitié de leurs maîtres pour eux se manifeste par
la présence, près des tombes royales d’Abydos, de
sépultures de chiens surmontées de stèles portant
leurs noms.
Par la suite, les races iront se multipliant, et il
est amusant de constater que certaines ont des
périodes de faveur très nettes : à l’Ancien Empire,
377