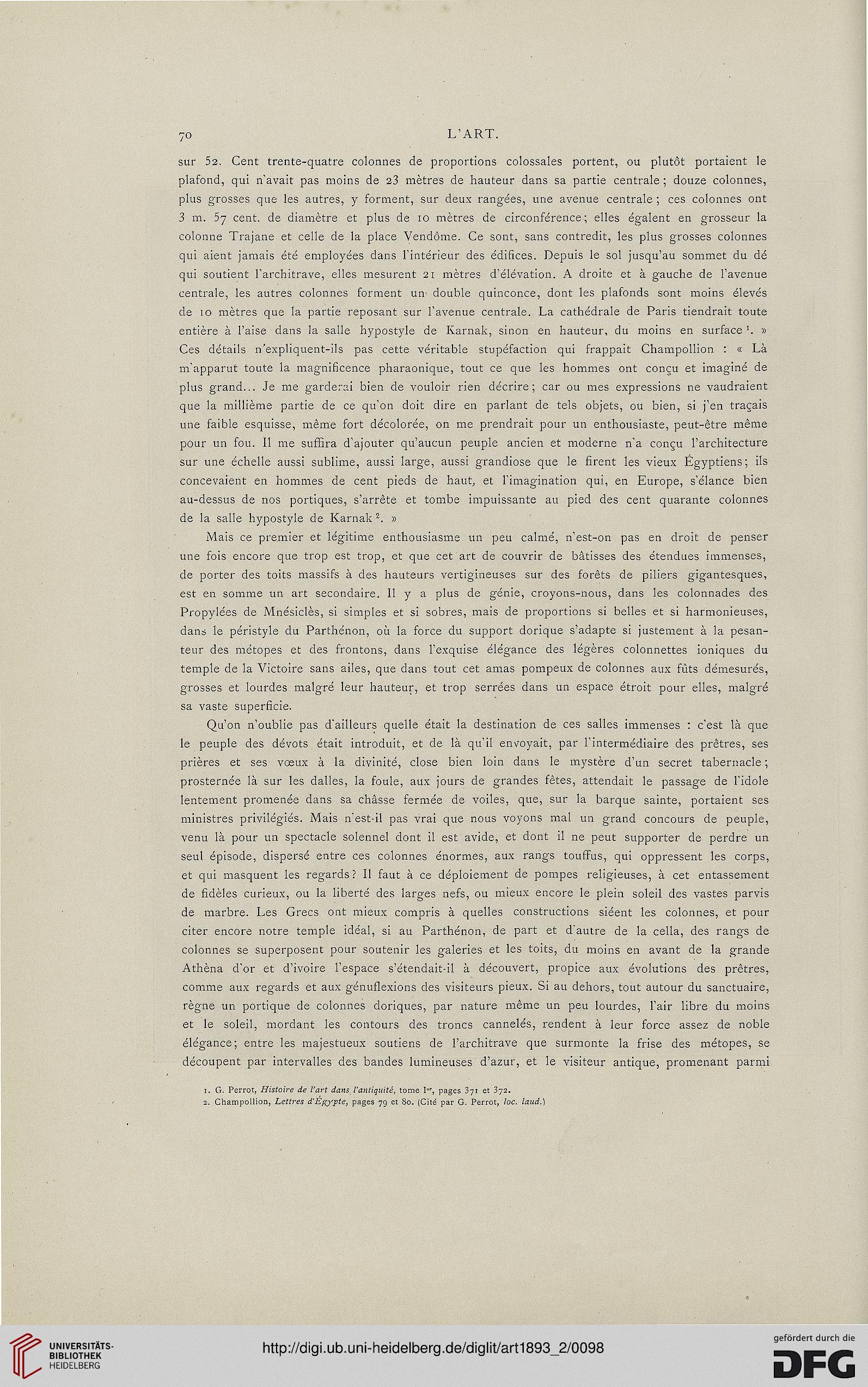7o L'ART.
sur 52. Cent trente-quatre colonnes de proportions colossales portent, ou plutôt portaient le
plafond, qui n'avait pas moins de 23 mètres de hauteur dans sa partie centrale ; douze colonnes,
plus grosses que les autres, y forment, sur deux rangées, une avenue centrale; ces colonnes ont
3 m. 5y cent, de diamètre et plus de io mètres de circonférence; elles égalent en grosseur la
colonne Trajane et celle de la place Vendôme. Ce sont, sans contredit, les plus grosses colonnes
qui aient jamais été employées dans l'intérieur des édifices. Depuis le sol jusqu'au sommet du dé
qui soutient l'architrave, elles mesurent 21 mètres d'élévation. A droite et à gauche de l'avenue
centrale, les autres colonnes forment un double quinconce, dont les plafonds sont moins élevés
de 10 mètres que la partie reposant sur l'avenue centrale. La cathédrale de Paris tiendrait toute
entière à l'aise dans la salle hypostyle de Karnak, sinon en hauteur, du moins en surface '. »
Ces détails n'expliquent-ils pas cette véritable stupéfaction qui frappait Champollion : « Là
m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce que les hommes ont conçu et imaginé de
plus grand... Je me garderai bien de vouloir rien décrire; car ou mes expressions ne vaudraient
que la millième partie de ce qu'on doit dire en parlant de tels objets, ou bien, si j'en traçais
une faible esquisse, même fort décolorée, on me prendrait pour un enthousiaste, peut-être même
pour un fou. Il me suffira d'ajouter qu'aucun peuple ancien et moderne n'a conçu l'architecture
sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens; ils
concevaient en hommes de cent pieds de haut, et l'imagination qui, en Europe, s'élance bien
au-dessus de nos portiques, s'arrête et tombe impuissante au pied des cent quarante colonnes
de la salle hypostyle de Karnak 2. »
Mais ce premier et légitime enthousiasme un peu calmé, n'est-on pas en droit de penser
une fois encore que trop est trop, et que cet art de couvrir de bâtisses des étendues immenses,
de porter des toits massifs à des hauteurs vertigineuses sur des forêts de piliers gigantesques,
est en somme un art secondaire. Il y a plus de génie, croyons-nous, dans les colonnades des
Propylées de Mnésiclès, si simples et si sobres, mais de proportions si belles et si harmonieuses,
dans le péristyle du Parthénon, où la force du support dorique s'adapte si justement à la pesan-
teur des métopes et des frontons, dans l'exquise élégance des légères colonnettes ioniques du
temple de la Victoire sans ailes, que dans tout cet amas pompeux de colonnes aux fûts démesurés,
grosses et lourdes malgré leur hauteur, et trop serrées dans un espace étroit pour elles, malgré
sa vaste superficie.
Qu'on n'oublie pas d'ailleurs quelle était la destination de ces salles immenses : c'est là que
le peuple des dévots était introduit, et de là qu'il envoyait, par l'intermédiaire des prêtres, ses
prières et ses vœux à la divinité, close bien loin dans le mystère d'un secret tabernacle ;
prosternée là sur les dalles, la foule, aux jours de grandes fêtes, attendait le passage de l'idole
lentement promenée dans sa châsse fermée de voiles, que, sur la barque sainte, portaient ses
ministres privilégiés. Mais n'est-il pas vrai que nous voyons mal un grand concours de peuple,
venu là pour un spectacle solennel dont il est avide, et dont il ne peut supporter de perdre un
seul épisode, dispersé entre ces colonnes énormes, aux rangs touffus, qui oppressent les corps,
et qui masquent les regards? Il faut à ce déploiement de pompes religieuses, à cet entassement
de fidèles curieux, ou la liberté des larges nefs, ou mieux encore le plein soleil des vastes parvis
de marbre. Les Grecs ont mieux compris à quelles constructions siéent les colonnes, et pour
citer encore notre temple idéal, si au Parthénon, de part et d'autre de la cella, des rangs de
colonnes se superposent pour soutenir les galeries et les toits, du moins en avant de la grande
Athèna d'or et d'ivoire l'espace s'étendait-il à découvert, propice aux évolutions des prêtres,
comme aux regards et aux génuflexions des visiteurs pieux. Si au dehors, tout autour du sanctuaire,
règne un portique de colonnes doriques, par nature même un peu lourdes, l'air libre du moins
et le soleil, mordant les contours des troncs cannelés, rendent à leur force assez de noble
élégance; entre les majestueux soutiens de l'architrave que surmonte la frise des métopes, se
découpent par intervalles des bandes lumineuses d'azur, et le visiteur antique, promenant parmi
1. G. Perrot, Histoire de l'art dans l'antiquité, tome I°r, pages 3ji et 372.
2. Champollion, Lettres d'Egypte, pages 79 et 80. (Cité par G. Perrot, loc. laud.)
sur 52. Cent trente-quatre colonnes de proportions colossales portent, ou plutôt portaient le
plafond, qui n'avait pas moins de 23 mètres de hauteur dans sa partie centrale ; douze colonnes,
plus grosses que les autres, y forment, sur deux rangées, une avenue centrale; ces colonnes ont
3 m. 5y cent, de diamètre et plus de io mètres de circonférence; elles égalent en grosseur la
colonne Trajane et celle de la place Vendôme. Ce sont, sans contredit, les plus grosses colonnes
qui aient jamais été employées dans l'intérieur des édifices. Depuis le sol jusqu'au sommet du dé
qui soutient l'architrave, elles mesurent 21 mètres d'élévation. A droite et à gauche de l'avenue
centrale, les autres colonnes forment un double quinconce, dont les plafonds sont moins élevés
de 10 mètres que la partie reposant sur l'avenue centrale. La cathédrale de Paris tiendrait toute
entière à l'aise dans la salle hypostyle de Karnak, sinon en hauteur, du moins en surface '. »
Ces détails n'expliquent-ils pas cette véritable stupéfaction qui frappait Champollion : « Là
m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce que les hommes ont conçu et imaginé de
plus grand... Je me garderai bien de vouloir rien décrire; car ou mes expressions ne vaudraient
que la millième partie de ce qu'on doit dire en parlant de tels objets, ou bien, si j'en traçais
une faible esquisse, même fort décolorée, on me prendrait pour un enthousiaste, peut-être même
pour un fou. Il me suffira d'ajouter qu'aucun peuple ancien et moderne n'a conçu l'architecture
sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens; ils
concevaient en hommes de cent pieds de haut, et l'imagination qui, en Europe, s'élance bien
au-dessus de nos portiques, s'arrête et tombe impuissante au pied des cent quarante colonnes
de la salle hypostyle de Karnak 2. »
Mais ce premier et légitime enthousiasme un peu calmé, n'est-on pas en droit de penser
une fois encore que trop est trop, et que cet art de couvrir de bâtisses des étendues immenses,
de porter des toits massifs à des hauteurs vertigineuses sur des forêts de piliers gigantesques,
est en somme un art secondaire. Il y a plus de génie, croyons-nous, dans les colonnades des
Propylées de Mnésiclès, si simples et si sobres, mais de proportions si belles et si harmonieuses,
dans le péristyle du Parthénon, où la force du support dorique s'adapte si justement à la pesan-
teur des métopes et des frontons, dans l'exquise élégance des légères colonnettes ioniques du
temple de la Victoire sans ailes, que dans tout cet amas pompeux de colonnes aux fûts démesurés,
grosses et lourdes malgré leur hauteur, et trop serrées dans un espace étroit pour elles, malgré
sa vaste superficie.
Qu'on n'oublie pas d'ailleurs quelle était la destination de ces salles immenses : c'est là que
le peuple des dévots était introduit, et de là qu'il envoyait, par l'intermédiaire des prêtres, ses
prières et ses vœux à la divinité, close bien loin dans le mystère d'un secret tabernacle ;
prosternée là sur les dalles, la foule, aux jours de grandes fêtes, attendait le passage de l'idole
lentement promenée dans sa châsse fermée de voiles, que, sur la barque sainte, portaient ses
ministres privilégiés. Mais n'est-il pas vrai que nous voyons mal un grand concours de peuple,
venu là pour un spectacle solennel dont il est avide, et dont il ne peut supporter de perdre un
seul épisode, dispersé entre ces colonnes énormes, aux rangs touffus, qui oppressent les corps,
et qui masquent les regards? Il faut à ce déploiement de pompes religieuses, à cet entassement
de fidèles curieux, ou la liberté des larges nefs, ou mieux encore le plein soleil des vastes parvis
de marbre. Les Grecs ont mieux compris à quelles constructions siéent les colonnes, et pour
citer encore notre temple idéal, si au Parthénon, de part et d'autre de la cella, des rangs de
colonnes se superposent pour soutenir les galeries et les toits, du moins en avant de la grande
Athèna d'or et d'ivoire l'espace s'étendait-il à découvert, propice aux évolutions des prêtres,
comme aux regards et aux génuflexions des visiteurs pieux. Si au dehors, tout autour du sanctuaire,
règne un portique de colonnes doriques, par nature même un peu lourdes, l'air libre du moins
et le soleil, mordant les contours des troncs cannelés, rendent à leur force assez de noble
élégance; entre les majestueux soutiens de l'architrave que surmonte la frise des métopes, se
découpent par intervalles des bandes lumineuses d'azur, et le visiteur antique, promenant parmi
1. G. Perrot, Histoire de l'art dans l'antiquité, tome I°r, pages 3ji et 372.
2. Champollion, Lettres d'Egypte, pages 79 et 80. (Cité par G. Perrot, loc. laud.)