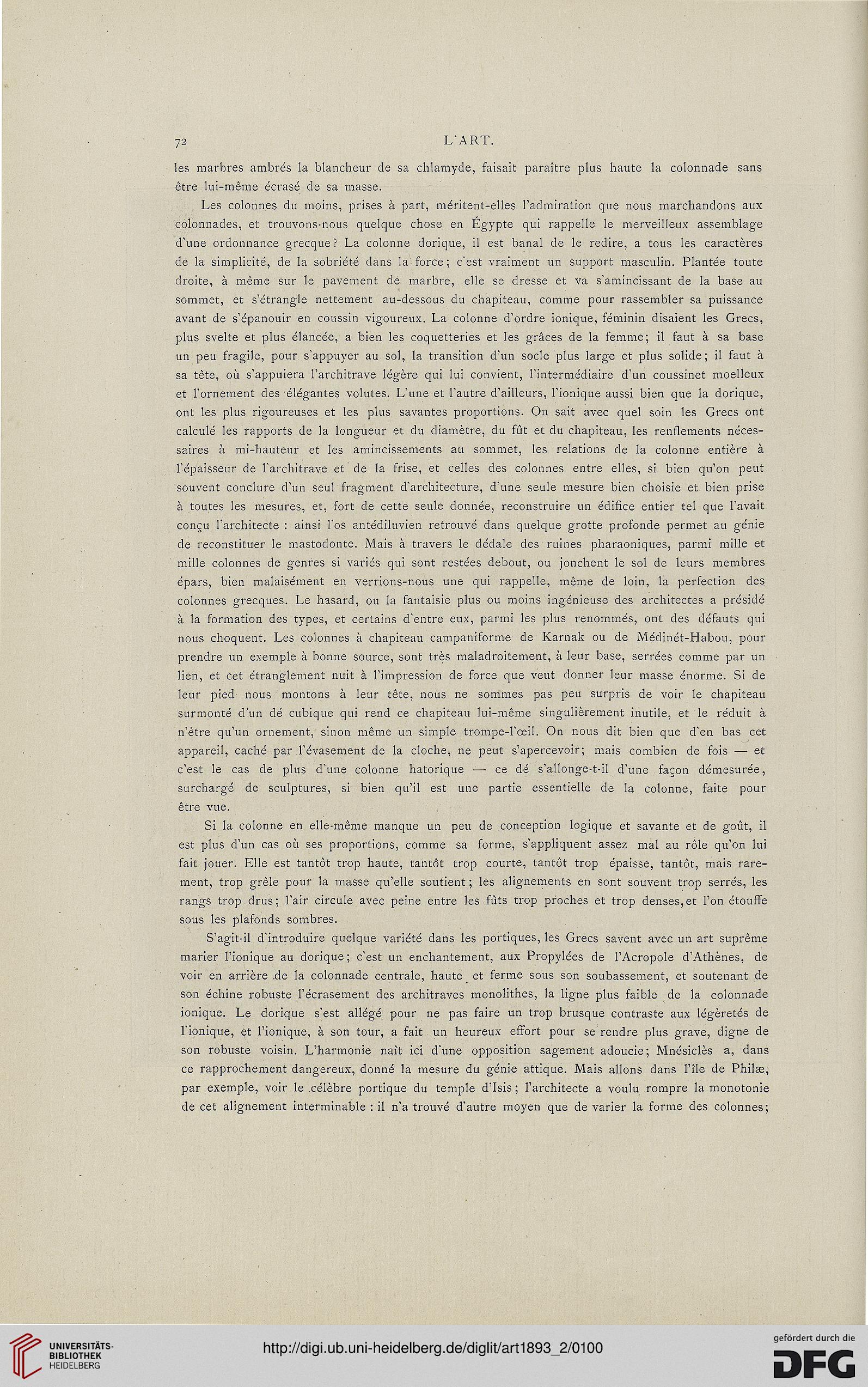72 L'ART.
les marbres ambrés la blancheur de sa chlamyde, faisait paraître plus haute la colonnade sans
être lui-même écrasé de sa masse.
Les colonnes du moins, prises à part, méritent-elles l'admiration que nous marchandons aux
colonnades, et trouvons-nous quelque chose en Egypte qui rappelle le merveilleux assemblage
d'une ordonnance grecque? La colonne dorique, il est banal de le redire, a tous les caractères
de la simplicité, de la sobriété dans la force; c'est vraiment un support masculin. Plantée toute
droite, à même sur le pavement de marbre, elle se dresse et va s'amincissant de la base au
sommet, et s'étrangle nettement au-dessous du chapiteau, comme pour rassembler sa puissance
avant de s'épanouir en coussin vigoureux. La colonne d'ordre ionique, féminin disaient les Grecs,
plus svelte et plus élancée, a bien les coquetteries et les grâces de la femme; il faut à sa base
un peu fragile, pour s'appuyer au sol, la transition d'un socle plus large et plus solide; il faut à
sa tète, où s'appuiera l'architrave légère qui lui convient, l'intermédiaire d'un coussinet moelleux
et l'ornement des élégantes volutes. L'une et l'autre d'ailleurs, l'ionique aussi bien que la dorique,
ont les plus rigoureuses et les plus savantes proportions. On sait avec quel soin les Grecs ont
calculé les rapports de la longueur et du diamètre, du fût et du chapiteau, les renflements néces-
saires à mi-hauteur et les amincissements au sommet, les relations de la colonne entière à
l'épaisseur de l'architrave et de la frise, et celles des colonnes entre elles, si bien qu'on peut
souvent conclure d'un seul fragment d'architecture, d'une seule mesure bien choisie et bien prise
à toutes les mesures, et, fort de cette seule donnée, reconstruire un édifice entier tel que l'avait
conçu l'architecte : ainsi l'os antédiluvien retrouvé dans quelque grotte profonde permet au génie
de reconstituer le mastodonte. Mais à travers le dédale des ruines pharaoniques, parmi mille et
mille colonnes de genres si variés qui sont restées debout, ou jonchent le sol de leurs membres
épars, bien malaisément en verrions-nous une qui rappelle, même de loin, la perfection des
colonnes grecques. Le hasard, ou la fantaisie plus ou moins ingénieuse des architectes a présidé
à la formation des types, et certains d'entre eux, parmi les plus renommés, ont des défauts qui
nous choquent. Les colonnes à chapiteau campaniforme de Karnak ou de Médinét-Habou, pour
prendre un exemple à bonne source, sont très maladroitement, à leur base, serrées comme par un
lien, et cet étranglement nuit à l'impression de force que veut donner leur masse énorme. Si de
leur pied nous montons à leur tête, nous ne sommes pas peu surpris de voir le chapiteau
surmonté d'un clé cubique qui rend ce chapiteau lui-même singulièrement inutile, et le réduit à
n'être qu'un ornement, sinon même un simple trompe-l'oeil. On nous dit bien que d'en bas cet
appareil, caché par l'évasement de la cloche, ne peut s'apercevoir; mais combien de fois — et
c'est le cas de plus d'une colonne hatorique — ce dé s'allonge-t-il d'une façon démesurée,
surchargé de sculptures, si bien qu'il est une partie essentielle de la colonne, faite pour
être vue.
Si la colonne en elle-même manque un peu de conception logique et savante et de goût, il
est plus d'un cas où ses proportions, comme sa forme, s'appliquent assez mal au rôle qu'on lui
fait jouer. Elle est tantôt trop haute, tantôt trop courte, tantôt trop épaisse, tantôt, mais rare-
ment, trop grêle pour la masse qu'elle soutient ; les alignements en sont souvent trop serrés, les
rangs trop drus; l'air circule avec peine entre les fûts trop proches et trop denses,et l'on étouffe
sous les plafonds sombres.
S'agit-il d'introduire quelque variété dans les portiques, les Grecs savent avec un art suprême
marier l'ionique au dorique; c'est un enchantement, aux Propylées de l'Acropole d'Athènes, de
voir en arrière .de la colonnade centrale, haute et ferme sous son soubassement, et soutenant de
son échine robuste l'écrasement des architraves monolithes, la ligne plus faible de la colonnade
ionique. Le dorique s'est allégé pour ne pas faire un trop brusque contraste aux légèretés de
l'ionique, et l'ionique, à son tour, a fait un heureux effort pour se rendre plus grave, digne de
son robuste voisin. L'harmonie naît ici d'une opposition sagement adoucie; Mnésiclès a, dans
ce rapprochement dangereux, donné la mesure du génie attique. Mais allons dans l'île de Philœ,
par exemple, voir le célèbre portique du temple d'Isis ; l'architecte a voulu rompre la monotonie
de cet alignement interminable : il n'a trouvé d'autre moyen que de varier la forme des colonnes;
les marbres ambrés la blancheur de sa chlamyde, faisait paraître plus haute la colonnade sans
être lui-même écrasé de sa masse.
Les colonnes du moins, prises à part, méritent-elles l'admiration que nous marchandons aux
colonnades, et trouvons-nous quelque chose en Egypte qui rappelle le merveilleux assemblage
d'une ordonnance grecque? La colonne dorique, il est banal de le redire, a tous les caractères
de la simplicité, de la sobriété dans la force; c'est vraiment un support masculin. Plantée toute
droite, à même sur le pavement de marbre, elle se dresse et va s'amincissant de la base au
sommet, et s'étrangle nettement au-dessous du chapiteau, comme pour rassembler sa puissance
avant de s'épanouir en coussin vigoureux. La colonne d'ordre ionique, féminin disaient les Grecs,
plus svelte et plus élancée, a bien les coquetteries et les grâces de la femme; il faut à sa base
un peu fragile, pour s'appuyer au sol, la transition d'un socle plus large et plus solide; il faut à
sa tète, où s'appuiera l'architrave légère qui lui convient, l'intermédiaire d'un coussinet moelleux
et l'ornement des élégantes volutes. L'une et l'autre d'ailleurs, l'ionique aussi bien que la dorique,
ont les plus rigoureuses et les plus savantes proportions. On sait avec quel soin les Grecs ont
calculé les rapports de la longueur et du diamètre, du fût et du chapiteau, les renflements néces-
saires à mi-hauteur et les amincissements au sommet, les relations de la colonne entière à
l'épaisseur de l'architrave et de la frise, et celles des colonnes entre elles, si bien qu'on peut
souvent conclure d'un seul fragment d'architecture, d'une seule mesure bien choisie et bien prise
à toutes les mesures, et, fort de cette seule donnée, reconstruire un édifice entier tel que l'avait
conçu l'architecte : ainsi l'os antédiluvien retrouvé dans quelque grotte profonde permet au génie
de reconstituer le mastodonte. Mais à travers le dédale des ruines pharaoniques, parmi mille et
mille colonnes de genres si variés qui sont restées debout, ou jonchent le sol de leurs membres
épars, bien malaisément en verrions-nous une qui rappelle, même de loin, la perfection des
colonnes grecques. Le hasard, ou la fantaisie plus ou moins ingénieuse des architectes a présidé
à la formation des types, et certains d'entre eux, parmi les plus renommés, ont des défauts qui
nous choquent. Les colonnes à chapiteau campaniforme de Karnak ou de Médinét-Habou, pour
prendre un exemple à bonne source, sont très maladroitement, à leur base, serrées comme par un
lien, et cet étranglement nuit à l'impression de force que veut donner leur masse énorme. Si de
leur pied nous montons à leur tête, nous ne sommes pas peu surpris de voir le chapiteau
surmonté d'un clé cubique qui rend ce chapiteau lui-même singulièrement inutile, et le réduit à
n'être qu'un ornement, sinon même un simple trompe-l'oeil. On nous dit bien que d'en bas cet
appareil, caché par l'évasement de la cloche, ne peut s'apercevoir; mais combien de fois — et
c'est le cas de plus d'une colonne hatorique — ce dé s'allonge-t-il d'une façon démesurée,
surchargé de sculptures, si bien qu'il est une partie essentielle de la colonne, faite pour
être vue.
Si la colonne en elle-même manque un peu de conception logique et savante et de goût, il
est plus d'un cas où ses proportions, comme sa forme, s'appliquent assez mal au rôle qu'on lui
fait jouer. Elle est tantôt trop haute, tantôt trop courte, tantôt trop épaisse, tantôt, mais rare-
ment, trop grêle pour la masse qu'elle soutient ; les alignements en sont souvent trop serrés, les
rangs trop drus; l'air circule avec peine entre les fûts trop proches et trop denses,et l'on étouffe
sous les plafonds sombres.
S'agit-il d'introduire quelque variété dans les portiques, les Grecs savent avec un art suprême
marier l'ionique au dorique; c'est un enchantement, aux Propylées de l'Acropole d'Athènes, de
voir en arrière .de la colonnade centrale, haute et ferme sous son soubassement, et soutenant de
son échine robuste l'écrasement des architraves monolithes, la ligne plus faible de la colonnade
ionique. Le dorique s'est allégé pour ne pas faire un trop brusque contraste aux légèretés de
l'ionique, et l'ionique, à son tour, a fait un heureux effort pour se rendre plus grave, digne de
son robuste voisin. L'harmonie naît ici d'une opposition sagement adoucie; Mnésiclès a, dans
ce rapprochement dangereux, donné la mesure du génie attique. Mais allons dans l'île de Philœ,
par exemple, voir le célèbre portique du temple d'Isis ; l'architecte a voulu rompre la monotonie
de cet alignement interminable : il n'a trouvé d'autre moyen que de varier la forme des colonnes;