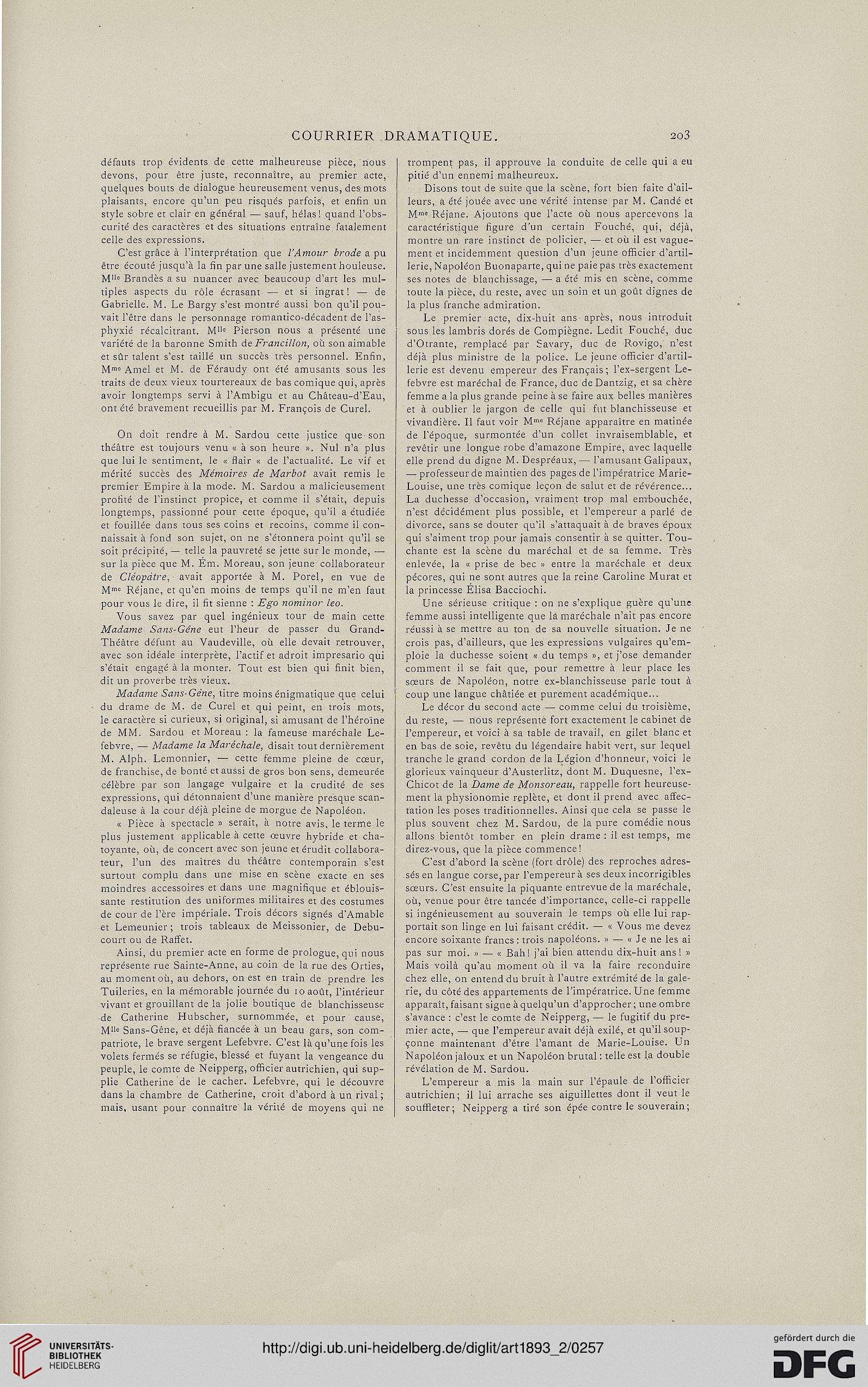COURRIER DRAMATIQUE.
203
défauts trop évidents de cette malheureuse pièce, nous
devons, pour être juste, reconnaître, au premier acte,
quelques bouts de dialogue heureusement venus, des mots
plaisants, encore qu'un peu risqués parfois, et enfin un
style sobre et clair en général — sauf, hélas ! quand l'obs-
curité des caractères et des situations entraîne fatalement
celle des expressions.
C'est grâce à l'interprétation que l'Amour brode a pu
être écouté jusqu'à la fin par une salle justement houleuse.
M,le Brandès a su nuancer avec beaucoup d'art les mul-
tiples aspects du rôle écrasant — et si ingrat ! — de
Gabrielle. M. Le Bargy s'est montré aussi bon qu'il pou-
vait l'être dans le personnage romantico-décadent de l'as-
phyxié récalcitrant. M"e Pierson nous a présenté une
variété de la baronne Smith de Francillon, où son aimable
et sûr talent s'est taillé un succès très personnel. Enfin,
Mme Amel et M. de Féraudy ont été amusants sous les
traits de deux vieux tourtereaux de bas comique qui, après
avoir longtemps servi à l'Ambigu et au Chàteau-d'Eau,
ont été bravement recueillis par M. François de Curel.
On doit rendre à M. Sardou cette justice que son
théâtre est toujours venu « à son heure ». Nul n'a plus
que lui le sentiment, le « flair « de l'actualité. Le vif et
mérité succès des Mémoires de Marbot avait remis le
premier Empire à la mode. M. Sardou a malicieusement
profité de l'instinct propice, et comme il s'était, depuis
longtemps, passionné pour cette époque, qu'il a étudiée
et fouillée dans tous ses coins et recoins, comme il con-
naissait à fond son sujet, on ne s'étonnera point qu'il se
soit précipité, — telle la pauvreté se jette sur le monde, —
sur la pièce que M. Ém. Moreau, son jeune collaborateur
de Cléopàtre, avait apportée à M. Porel, en vue de
Mme Réjane, et qu'en moins de temps qu'il ne m'en faut
pour vous le dire, il fit sienne : Ego nominor leo.
Vous savez par quel ingénieux tour de main cette
Madame Sans-Gène eut l'heur de passer du Grand-
Théâtre défunt au Vaudeville, où elle devait retrouver,
avec son idéale interprète, l'actif et adroit imprésario qui
s'était engagé à la monter. Tout est bien qui finit bien,
dit un proverbe très vieux.
Madame Sans-Gène, titre moins énigmatique que celui
du drame de M. de Curel et qui peint, en trois mots,
le caractère si curieux, si original, si amusant de l'héroïne
de MM. Sardou et Moreau : la fameuse maréchale Le-
febvre, — Madame la Maréchale, disait tout dernièrement
M. Alph. Lemonnier, — cette femme pleine de cœur,
de franchise, de bonté et aussi de gros bon sens, demeurée
célèbre par son langage vulgaire et la crudité de ses
expressions, qui détonnaient d'une manière presque scan-
daleuse à la cour déjà pleine de morgue de Napoléon.
« Pièce à spectacle » serait, à notre avis, le terme le
plus justement applicable à cette œuvre hybride et cha-
toyante, où, de concert avec son jeune et érudit collabora-
teur, l'un des maîtres du théâtre contemporain s'est
surtout complu dans une mise en scène exacte en ses
moindres accessoires et dans une magnifique et éblouis-
sante restitution des uniformes militaires et des costumes
de cour de l'ère impériale. Trois décors signés d'Amable
et Lemeunier ; trois tableaux de Meissonier, de Debu-
court ou de Raffet.
Ainsi, du premier acte en forme de prologue, qui nous
représente rue Sainte-Anne, au coin de la rue des Orties,
au moment où, au dehors, on est en train de prendre les
Tuileries, en la mémorable journée du ioaoût, l'intérieur
vivant et grouillant de la jolie boutique de blanchisseuse
de Catherine Hubscher, surnommée, et pour cause,
M;Ile Sans-Gêne, et déjà fiancée à un beau gars, son com-
patriote, le brave sergent Lefebvre. C'est là qu'une fois les
volets fermés se réfugie, blessé et fuyant la vengeance du
peuple, le comte de Neipperg, officier autrichien, qui sup-
plie Catherine de le cacher. Lefebvre, qui le découvre
dans la chambre de Catherine, croit d'abord à un rival ;
mais, usant pour connaître la vérité de moyens qui ne
trompent pas, il approuve la conduite de celle qui a eu
pitié d'un ennemi malheureux.
Disons tout de suite que la scène, fort bien faite d'ail-
leurs, a été jouée avec une vérité intense par M. Candé et
Mme Réjane. Ajoutons que l'acte où nous apercevons la
caractéristique figure d'un certain Fouché, qui, déjà,
montre un rare instinct de policier, — et où il est vague-
ment et incidemment question d'un jeune officier d'artil-
lerie, Napoléon Buonaparte, qui ne paie pas très exactement
ses notes de blanchissage, — a été mis en scène, comme
toute la pièce, du reste, avec un soin et un goût dignes de
la plus franche admiration.
Le premier acte, dix-huit ans après, nous introduit
sous les lambris dorés de Compiègne. Ledit Fouché, duc
d'Otrante, remplacé par Savary, duc de Rovigo, n'est
déjà plus ministre de la police. Le jeune officier d'artil-
lerie est devenu empereur des Français; l'ex-sergent Le-
febvre est maréchal de France, duc deDantzig, et sa chère
femme a la plus grande peine à se faire aux belles manières
et à oublier le jargon de celle qui fut blanchisseuse et
vivandière. Il faut voir Mme Réjane apparaître en matinée
de l'époque, surmontée d'un collet invraisemblable, et
revêtir une longue robe d'amazone Empire, avec laquelle
elle prend du digne M. Despréaux, — l'amusant Galipaux,
— professeur de maintien des pages de l'impératrice Marie-
Louise, une très comique leçon de salut et de révérence...
La duchesse d'occasion, vraiment trop mal embouchée,
n'est décidément plus possible, et l'empereur a parlé de
divorce, sans se douter qu'il s'attaquait à de braves époux
qui s'aiment trop pour jamais consentir à se quitter. Tou-
chante est la scène du maréchal et de sa femme. Très
enlevée, la « prise de bec » entre la maréchale et deux
pécores, qui ne sont autres que la reine Caroline Murât et
la princesse Elisa Bacciochi.
Une sérieuse critique : on ne s'explique guère qu'une
femme aussi intelligente que la maréchale n'ait pas encore
réussi à se mettre au ton de sa nouvelle situation. Je ne
crois pas, d'ailleurs, que les expressions vulgaires qu'em-
ploie la duchesse soient « du temps », et j'ose demander
comment il se fait que, pour remettre à leur place les
sœurs de Napoléon, notre ex-blanchisseuse parle tout à
coup une langue châtiée et purement académique...
Le décor du second acte —• comme celui du troisième,
du reste, — nous représente fort exactement le cabinet de
l'empereur, et voici à sa table de travail, en gilet blanc et
en bas de soie, revêtu du légendaire habit vert, sur lequel
tranche le grand cordon de la Légion d'honneur, voici le
glorieux vainqueur d'Austerlitz, dont M. Duquesne, l'ex-
Chicot de la Dame de Monsoreau, rappelle fort heureuse-
ment la physionomie replète, et dont il prend avec affec-
tation les poses traditionnelles. Ainsi que cela se passe le
plus souvent chez M. Sardou, de la pure comédie nous
allons bientôt tomber en plein drame : il est temps, me
direz-vous, que la pièce commence!
C'est d'abord la scène (fort drôle) des reproches adres-
sés en langue corse, par l'empereur à ses deux incorrigibles
sœurs. C'est ensuite la piquante entrevue de la maréchale,
où, venue pour être tancée d'importance, celle-ci rappelle
si ingénieusement au souverain le temps où elle lui rap-
portait son linge en lui faisant crédit. — « Vous me devez
encore soixante francs: trois napoléons. » — « Je ne les ai
pas sur moi. » — « Bah! j'ai bien attendu dix-huit ans! »
Mais voilà qu'au moment où il va la faire reconduire
chez elle, on entend du bruit à l'autre extrémité de la gale-
rie, du côté des appartements de l'impératrice. Une femme
apparaît, faisant signe à quelqu'un d'approcher ; une ombre
s'avance : c'est le comte de Neipperg, — le fugitif du pre-
mier acte, — que l'empereur avait déjà exilé, et qu'il soup-
çonne maintenant d'être l'amant de Marie-Louise. Un
Napoléon jaloux et un Napoléon brutal : telle est la double
révélation de M. Sardou.
L'empereur a mis la main sur l'épaule de l'officier
autrichien; il lui arrache ses aiguillettes dont il veut le
souffleter; Neipperg a tiré son épée contre le souverain;
203
défauts trop évidents de cette malheureuse pièce, nous
devons, pour être juste, reconnaître, au premier acte,
quelques bouts de dialogue heureusement venus, des mots
plaisants, encore qu'un peu risqués parfois, et enfin un
style sobre et clair en général — sauf, hélas ! quand l'obs-
curité des caractères et des situations entraîne fatalement
celle des expressions.
C'est grâce à l'interprétation que l'Amour brode a pu
être écouté jusqu'à la fin par une salle justement houleuse.
M,le Brandès a su nuancer avec beaucoup d'art les mul-
tiples aspects du rôle écrasant — et si ingrat ! — de
Gabrielle. M. Le Bargy s'est montré aussi bon qu'il pou-
vait l'être dans le personnage romantico-décadent de l'as-
phyxié récalcitrant. M"e Pierson nous a présenté une
variété de la baronne Smith de Francillon, où son aimable
et sûr talent s'est taillé un succès très personnel. Enfin,
Mme Amel et M. de Féraudy ont été amusants sous les
traits de deux vieux tourtereaux de bas comique qui, après
avoir longtemps servi à l'Ambigu et au Chàteau-d'Eau,
ont été bravement recueillis par M. François de Curel.
On doit rendre à M. Sardou cette justice que son
théâtre est toujours venu « à son heure ». Nul n'a plus
que lui le sentiment, le « flair « de l'actualité. Le vif et
mérité succès des Mémoires de Marbot avait remis le
premier Empire à la mode. M. Sardou a malicieusement
profité de l'instinct propice, et comme il s'était, depuis
longtemps, passionné pour cette époque, qu'il a étudiée
et fouillée dans tous ses coins et recoins, comme il con-
naissait à fond son sujet, on ne s'étonnera point qu'il se
soit précipité, — telle la pauvreté se jette sur le monde, —
sur la pièce que M. Ém. Moreau, son jeune collaborateur
de Cléopàtre, avait apportée à M. Porel, en vue de
Mme Réjane, et qu'en moins de temps qu'il ne m'en faut
pour vous le dire, il fit sienne : Ego nominor leo.
Vous savez par quel ingénieux tour de main cette
Madame Sans-Gène eut l'heur de passer du Grand-
Théâtre défunt au Vaudeville, où elle devait retrouver,
avec son idéale interprète, l'actif et adroit imprésario qui
s'était engagé à la monter. Tout est bien qui finit bien,
dit un proverbe très vieux.
Madame Sans-Gène, titre moins énigmatique que celui
du drame de M. de Curel et qui peint, en trois mots,
le caractère si curieux, si original, si amusant de l'héroïne
de MM. Sardou et Moreau : la fameuse maréchale Le-
febvre, — Madame la Maréchale, disait tout dernièrement
M. Alph. Lemonnier, — cette femme pleine de cœur,
de franchise, de bonté et aussi de gros bon sens, demeurée
célèbre par son langage vulgaire et la crudité de ses
expressions, qui détonnaient d'une manière presque scan-
daleuse à la cour déjà pleine de morgue de Napoléon.
« Pièce à spectacle » serait, à notre avis, le terme le
plus justement applicable à cette œuvre hybride et cha-
toyante, où, de concert avec son jeune et érudit collabora-
teur, l'un des maîtres du théâtre contemporain s'est
surtout complu dans une mise en scène exacte en ses
moindres accessoires et dans une magnifique et éblouis-
sante restitution des uniformes militaires et des costumes
de cour de l'ère impériale. Trois décors signés d'Amable
et Lemeunier ; trois tableaux de Meissonier, de Debu-
court ou de Raffet.
Ainsi, du premier acte en forme de prologue, qui nous
représente rue Sainte-Anne, au coin de la rue des Orties,
au moment où, au dehors, on est en train de prendre les
Tuileries, en la mémorable journée du ioaoût, l'intérieur
vivant et grouillant de la jolie boutique de blanchisseuse
de Catherine Hubscher, surnommée, et pour cause,
M;Ile Sans-Gêne, et déjà fiancée à un beau gars, son com-
patriote, le brave sergent Lefebvre. C'est là qu'une fois les
volets fermés se réfugie, blessé et fuyant la vengeance du
peuple, le comte de Neipperg, officier autrichien, qui sup-
plie Catherine de le cacher. Lefebvre, qui le découvre
dans la chambre de Catherine, croit d'abord à un rival ;
mais, usant pour connaître la vérité de moyens qui ne
trompent pas, il approuve la conduite de celle qui a eu
pitié d'un ennemi malheureux.
Disons tout de suite que la scène, fort bien faite d'ail-
leurs, a été jouée avec une vérité intense par M. Candé et
Mme Réjane. Ajoutons que l'acte où nous apercevons la
caractéristique figure d'un certain Fouché, qui, déjà,
montre un rare instinct de policier, — et où il est vague-
ment et incidemment question d'un jeune officier d'artil-
lerie, Napoléon Buonaparte, qui ne paie pas très exactement
ses notes de blanchissage, — a été mis en scène, comme
toute la pièce, du reste, avec un soin et un goût dignes de
la plus franche admiration.
Le premier acte, dix-huit ans après, nous introduit
sous les lambris dorés de Compiègne. Ledit Fouché, duc
d'Otrante, remplacé par Savary, duc de Rovigo, n'est
déjà plus ministre de la police. Le jeune officier d'artil-
lerie est devenu empereur des Français; l'ex-sergent Le-
febvre est maréchal de France, duc deDantzig, et sa chère
femme a la plus grande peine à se faire aux belles manières
et à oublier le jargon de celle qui fut blanchisseuse et
vivandière. Il faut voir Mme Réjane apparaître en matinée
de l'époque, surmontée d'un collet invraisemblable, et
revêtir une longue robe d'amazone Empire, avec laquelle
elle prend du digne M. Despréaux, — l'amusant Galipaux,
— professeur de maintien des pages de l'impératrice Marie-
Louise, une très comique leçon de salut et de révérence...
La duchesse d'occasion, vraiment trop mal embouchée,
n'est décidément plus possible, et l'empereur a parlé de
divorce, sans se douter qu'il s'attaquait à de braves époux
qui s'aiment trop pour jamais consentir à se quitter. Tou-
chante est la scène du maréchal et de sa femme. Très
enlevée, la « prise de bec » entre la maréchale et deux
pécores, qui ne sont autres que la reine Caroline Murât et
la princesse Elisa Bacciochi.
Une sérieuse critique : on ne s'explique guère qu'une
femme aussi intelligente que la maréchale n'ait pas encore
réussi à se mettre au ton de sa nouvelle situation. Je ne
crois pas, d'ailleurs, que les expressions vulgaires qu'em-
ploie la duchesse soient « du temps », et j'ose demander
comment il se fait que, pour remettre à leur place les
sœurs de Napoléon, notre ex-blanchisseuse parle tout à
coup une langue châtiée et purement académique...
Le décor du second acte —• comme celui du troisième,
du reste, — nous représente fort exactement le cabinet de
l'empereur, et voici à sa table de travail, en gilet blanc et
en bas de soie, revêtu du légendaire habit vert, sur lequel
tranche le grand cordon de la Légion d'honneur, voici le
glorieux vainqueur d'Austerlitz, dont M. Duquesne, l'ex-
Chicot de la Dame de Monsoreau, rappelle fort heureuse-
ment la physionomie replète, et dont il prend avec affec-
tation les poses traditionnelles. Ainsi que cela se passe le
plus souvent chez M. Sardou, de la pure comédie nous
allons bientôt tomber en plein drame : il est temps, me
direz-vous, que la pièce commence!
C'est d'abord la scène (fort drôle) des reproches adres-
sés en langue corse, par l'empereur à ses deux incorrigibles
sœurs. C'est ensuite la piquante entrevue de la maréchale,
où, venue pour être tancée d'importance, celle-ci rappelle
si ingénieusement au souverain le temps où elle lui rap-
portait son linge en lui faisant crédit. — « Vous me devez
encore soixante francs: trois napoléons. » — « Je ne les ai
pas sur moi. » — « Bah! j'ai bien attendu dix-huit ans! »
Mais voilà qu'au moment où il va la faire reconduire
chez elle, on entend du bruit à l'autre extrémité de la gale-
rie, du côté des appartements de l'impératrice. Une femme
apparaît, faisant signe à quelqu'un d'approcher ; une ombre
s'avance : c'est le comte de Neipperg, — le fugitif du pre-
mier acte, — que l'empereur avait déjà exilé, et qu'il soup-
çonne maintenant d'être l'amant de Marie-Louise. Un
Napoléon jaloux et un Napoléon brutal : telle est la double
révélation de M. Sardou.
L'empereur a mis la main sur l'épaule de l'officier
autrichien; il lui arrache ses aiguillettes dont il veut le
souffleter; Neipperg a tiré son épée contre le souverain;