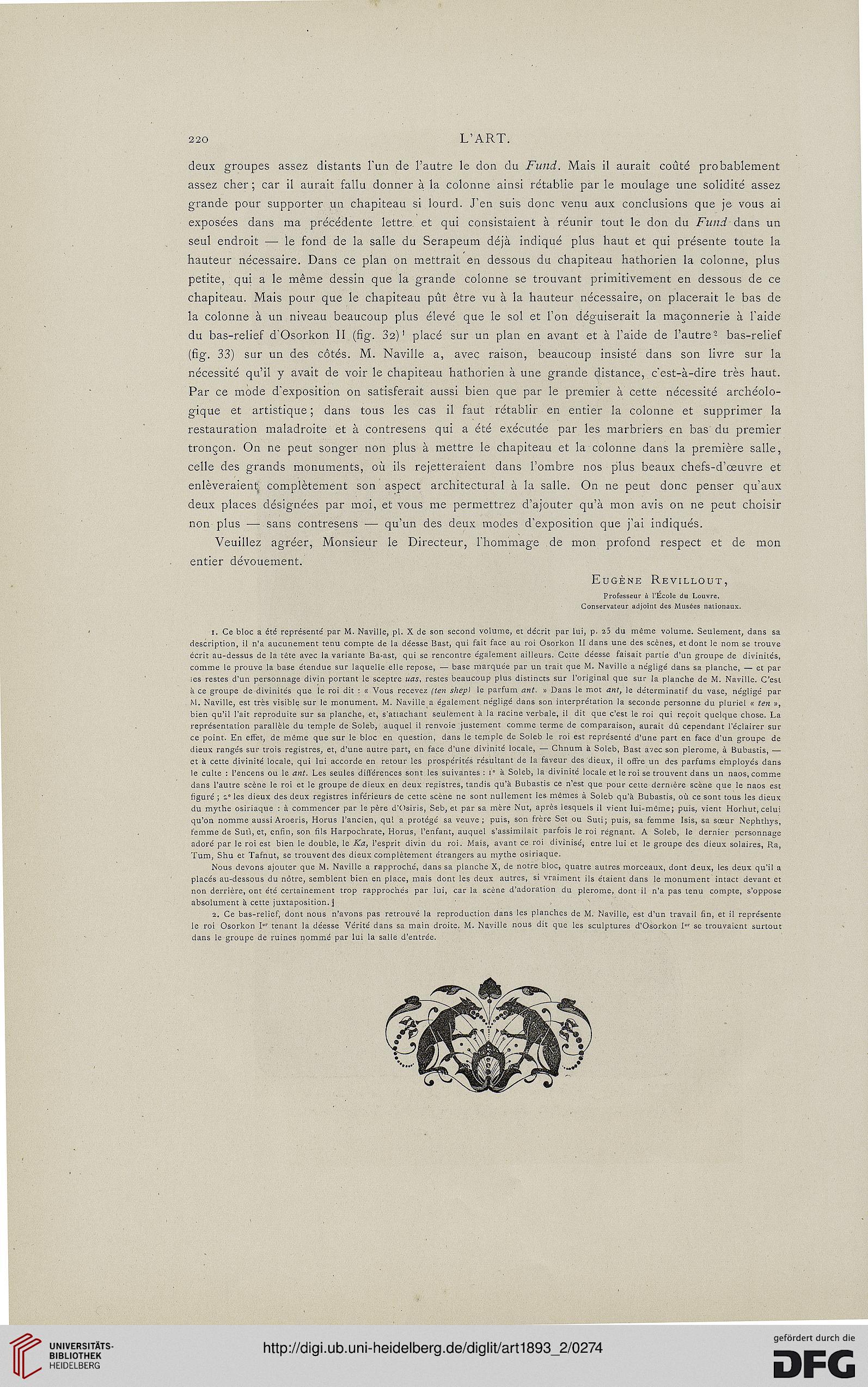deux groupes assez distants l'un de l'autre le don du Fund. Mais il aurait coûté probablement
assez cher; car il aurait fallu donner à la colonne ainsi rétablie parle moulage une solidité assez
grande pour supporter un chapiteau si lourd. J'en suis donc venu aux conclusions que je vous ai
exposées dans ma précédente lettre et qui consistaient à réunir tout le don du Fund dans un
seul endroit — le fond de la salle du Serapeum déjà indiqué plus haut et qui présente toute la
hauteur nécessaire. Dans ce plan on mettrait en dessous du chapiteau hathorien la colonne, plus
petite, qui a le même dessin que la grande colonne se trouvant primitivement en dessous de ce
chapiteau. Mais pour que le chapiteau pût être vu à la hauteur nécessaire, on placerait le bas de
la colonne à un niveau beaucoup plus élevé que le sol et Ton déguiserait la maçonnerie à l'aide
du bas-relief d'Osorkon II (fig. 32)' placé sur un plan en avant et à l'aide de l'autre2 bas-relief
(fig. 33) sur un des côtés. M. Naville a, avec raison, beaucoup insisté clans son livre sur la
nécessité qu'il y avait de voir le chapiteau hathorien à une grande distance, c'est-à-dire très haut.
Par ce mode d'exposition on satisferait aussi bien que par le premier à cette nécessité archéolo-
gique et artistique ; dans tous les cas il faut rétablir en entier la colonne et supprimer la
restauration maladroite et à contresens qui a été exécutée par les marbriers en bas du premier
tronçon. On ne peut songer non plus à mettre le chapiteau et la colonne dans la première salle,
celle des grands monuments, où ils rejetteraient dans l'ombre nos plus beaux chefs-d'œuvre et
enlèveraient complètement son aspect architectural à la salle. On ne peut donc penser qu'aux
deux places désignées par moi, et vous me permettrez d'ajouter qu'à mon avis on ne peut choisir
non plus — sans contresens ■— qu'un des deux modes d'exposition que j'ai indiqués.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'hommage de mon profond respect et de mon
entier dévouement.
Eugène Revillout,
Professeur à l'École du Louvre.
Conservateur adjoint des Musées nationaux.
1. Ce bloc a été représenté par M. Naville, pl. X de son second volume, et décrit par lui, p. i5 du môme volume. Seulement, dans sa
description, il n'a aucunement tenu compte de la déesse Bast, qui fait face au roi Osorkon II dans une des scènes, et dont le nom se trouve
écrit au-dessus de la tête avec la variante Ba-ast, qui se rencontre également ailleurs. Cette déesse faisait partie d'un groupe de divinités,
comme le prouve la base étendue sur laquelle elle repose, — base marquée par un trait que M. Naville a négligé dans sa planche, — et par
les restes d'un personnage divin portant le sceptre uas, restes beaucoup plus distincts sur l'original que sur la planche de M. Naville. C'est
à ce groupe de divinités que le roi dit : « Vous recevez (ten shepl le parfum ant. » Dans le mot ant, le déterminatif du vase, négligé par
M. Naville, est très visible sur le monument. M. Naville a également négligé dans son interprétation la seconde personne du pluriel « ten »,
bien qu'il l'ait reproduite sur sa planche, et, s'attachant seulement à la racine verbale, il dit que c'est le roi qui reçoit quelque chose. La
représentation parallèle du temple de Soleb, auquel il renvoie justement comme terme de comparaison, aurait dû cependant l'éclairer sur
ce point. En effet, de même que sur le bloc en question, dans le temple de Soleb le roi est représenté d'une part en face d'un groupe de
dieux rangés sur trois registres, et, d'une autre part, en face d'une divinité locale, — Chnum à Soleb, Bast avec son pierome, à Bubastis, —
et à cette divinité locale, qui lui accorde en retour les prospérités résultant de la faveur des dieux, il offre un des parfums ernployés dans
le culte : l'encens ou le ant. Les seules différences sont les suivantes : i° à Soleb, la divinité locale et le roi se trouvent dans un naos, comme
dans l'autre scène le roi et le groupe de dieux en deux registres, tandis qu'à Bubastis ce n'est que pour cette dernière scène que le naos est
figuré ; c° les dieux dés deux registres inférieurs de cette scène ne sont nullement les mêmes à Soleb qu'à Bubastis, où ce sont tous les dieux
du mythe osiriaque : à commencer par le père d'Osiris, Seb, et par sa mère Nut, après lesquels il vient lui-même; puis, vient Horhut, celui
qu'on nomme aussi Aroeris, Horus l'ancien, qu! a protégé sa veuve; puis, son frère Set ou Suti; puis, sa femme Isis, sa sœur Ncphthys,
femme de Suti, et, enfin, son fils Harpochrate, Horus, l'enfant, auquel s'assimilait parfois le roi régnant. A Soleb, le dernier personnage
adoré par le roi est bien le double, le Ka, l'esprit divin du roi. Mais, avant ce roi divinisé, entre lui et le groupe des dieux solaires, Ra,
Tum, Shu et Tafnut, se trouvent des dieux complètement étrangers au mythe osiriaque.
Nous devons ajouter que M. Naville a rapproché, dans sa planche X, de notre bloc, quatre autres morceaux, dont deux, les deux qu'il a
placés au-dessous du nôtre, semblent bien en place, mais dont les deux autres, si vraiment ils étaient dans le monument intact devant et
non derrière, ont été certainement trop rapprochés par lui, car la scène d'adoration du pierome, dont il n'a pas tenu compte, s'oppose
absolument à cette juxtaposition, j
2. Ce bas-relief, dont nous n'avons pas retrouvé la reproduction dans les planches de M. Naville, est d'un travail fin, et il représente
le roi Osorkon I"1' tenant la déesse Vérité dans sa main droite. M. Naville nous dit que les sculptures d'Osorkon 1°'' se trouvaient surtout
dans le groupe de ruines nommé par lui la salle d'entrée.
assez cher; car il aurait fallu donner à la colonne ainsi rétablie parle moulage une solidité assez
grande pour supporter un chapiteau si lourd. J'en suis donc venu aux conclusions que je vous ai
exposées dans ma précédente lettre et qui consistaient à réunir tout le don du Fund dans un
seul endroit — le fond de la salle du Serapeum déjà indiqué plus haut et qui présente toute la
hauteur nécessaire. Dans ce plan on mettrait en dessous du chapiteau hathorien la colonne, plus
petite, qui a le même dessin que la grande colonne se trouvant primitivement en dessous de ce
chapiteau. Mais pour que le chapiteau pût être vu à la hauteur nécessaire, on placerait le bas de
la colonne à un niveau beaucoup plus élevé que le sol et Ton déguiserait la maçonnerie à l'aide
du bas-relief d'Osorkon II (fig. 32)' placé sur un plan en avant et à l'aide de l'autre2 bas-relief
(fig. 33) sur un des côtés. M. Naville a, avec raison, beaucoup insisté clans son livre sur la
nécessité qu'il y avait de voir le chapiteau hathorien à une grande distance, c'est-à-dire très haut.
Par ce mode d'exposition on satisferait aussi bien que par le premier à cette nécessité archéolo-
gique et artistique ; dans tous les cas il faut rétablir en entier la colonne et supprimer la
restauration maladroite et à contresens qui a été exécutée par les marbriers en bas du premier
tronçon. On ne peut songer non plus à mettre le chapiteau et la colonne dans la première salle,
celle des grands monuments, où ils rejetteraient dans l'ombre nos plus beaux chefs-d'œuvre et
enlèveraient complètement son aspect architectural à la salle. On ne peut donc penser qu'aux
deux places désignées par moi, et vous me permettrez d'ajouter qu'à mon avis on ne peut choisir
non plus — sans contresens ■— qu'un des deux modes d'exposition que j'ai indiqués.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'hommage de mon profond respect et de mon
entier dévouement.
Eugène Revillout,
Professeur à l'École du Louvre.
Conservateur adjoint des Musées nationaux.
1. Ce bloc a été représenté par M. Naville, pl. X de son second volume, et décrit par lui, p. i5 du môme volume. Seulement, dans sa
description, il n'a aucunement tenu compte de la déesse Bast, qui fait face au roi Osorkon II dans une des scènes, et dont le nom se trouve
écrit au-dessus de la tête avec la variante Ba-ast, qui se rencontre également ailleurs. Cette déesse faisait partie d'un groupe de divinités,
comme le prouve la base étendue sur laquelle elle repose, — base marquée par un trait que M. Naville a négligé dans sa planche, — et par
les restes d'un personnage divin portant le sceptre uas, restes beaucoup plus distincts sur l'original que sur la planche de M. Naville. C'est
à ce groupe de divinités que le roi dit : « Vous recevez (ten shepl le parfum ant. » Dans le mot ant, le déterminatif du vase, négligé par
M. Naville, est très visible sur le monument. M. Naville a également négligé dans son interprétation la seconde personne du pluriel « ten »,
bien qu'il l'ait reproduite sur sa planche, et, s'attachant seulement à la racine verbale, il dit que c'est le roi qui reçoit quelque chose. La
représentation parallèle du temple de Soleb, auquel il renvoie justement comme terme de comparaison, aurait dû cependant l'éclairer sur
ce point. En effet, de même que sur le bloc en question, dans le temple de Soleb le roi est représenté d'une part en face d'un groupe de
dieux rangés sur trois registres, et, d'une autre part, en face d'une divinité locale, — Chnum à Soleb, Bast avec son pierome, à Bubastis, —
et à cette divinité locale, qui lui accorde en retour les prospérités résultant de la faveur des dieux, il offre un des parfums ernployés dans
le culte : l'encens ou le ant. Les seules différences sont les suivantes : i° à Soleb, la divinité locale et le roi se trouvent dans un naos, comme
dans l'autre scène le roi et le groupe de dieux en deux registres, tandis qu'à Bubastis ce n'est que pour cette dernière scène que le naos est
figuré ; c° les dieux dés deux registres inférieurs de cette scène ne sont nullement les mêmes à Soleb qu'à Bubastis, où ce sont tous les dieux
du mythe osiriaque : à commencer par le père d'Osiris, Seb, et par sa mère Nut, après lesquels il vient lui-même; puis, vient Horhut, celui
qu'on nomme aussi Aroeris, Horus l'ancien, qu! a protégé sa veuve; puis, son frère Set ou Suti; puis, sa femme Isis, sa sœur Ncphthys,
femme de Suti, et, enfin, son fils Harpochrate, Horus, l'enfant, auquel s'assimilait parfois le roi régnant. A Soleb, le dernier personnage
adoré par le roi est bien le double, le Ka, l'esprit divin du roi. Mais, avant ce roi divinisé, entre lui et le groupe des dieux solaires, Ra,
Tum, Shu et Tafnut, se trouvent des dieux complètement étrangers au mythe osiriaque.
Nous devons ajouter que M. Naville a rapproché, dans sa planche X, de notre bloc, quatre autres morceaux, dont deux, les deux qu'il a
placés au-dessous du nôtre, semblent bien en place, mais dont les deux autres, si vraiment ils étaient dans le monument intact devant et
non derrière, ont été certainement trop rapprochés par lui, car la scène d'adoration du pierome, dont il n'a pas tenu compte, s'oppose
absolument à cette juxtaposition, j
2. Ce bas-relief, dont nous n'avons pas retrouvé la reproduction dans les planches de M. Naville, est d'un travail fin, et il représente
le roi Osorkon I"1' tenant la déesse Vérité dans sa main droite. M. Naville nous dit que les sculptures d'Osorkon 1°'' se trouvaient surtout
dans le groupe de ruines nommé par lui la salle d'entrée.