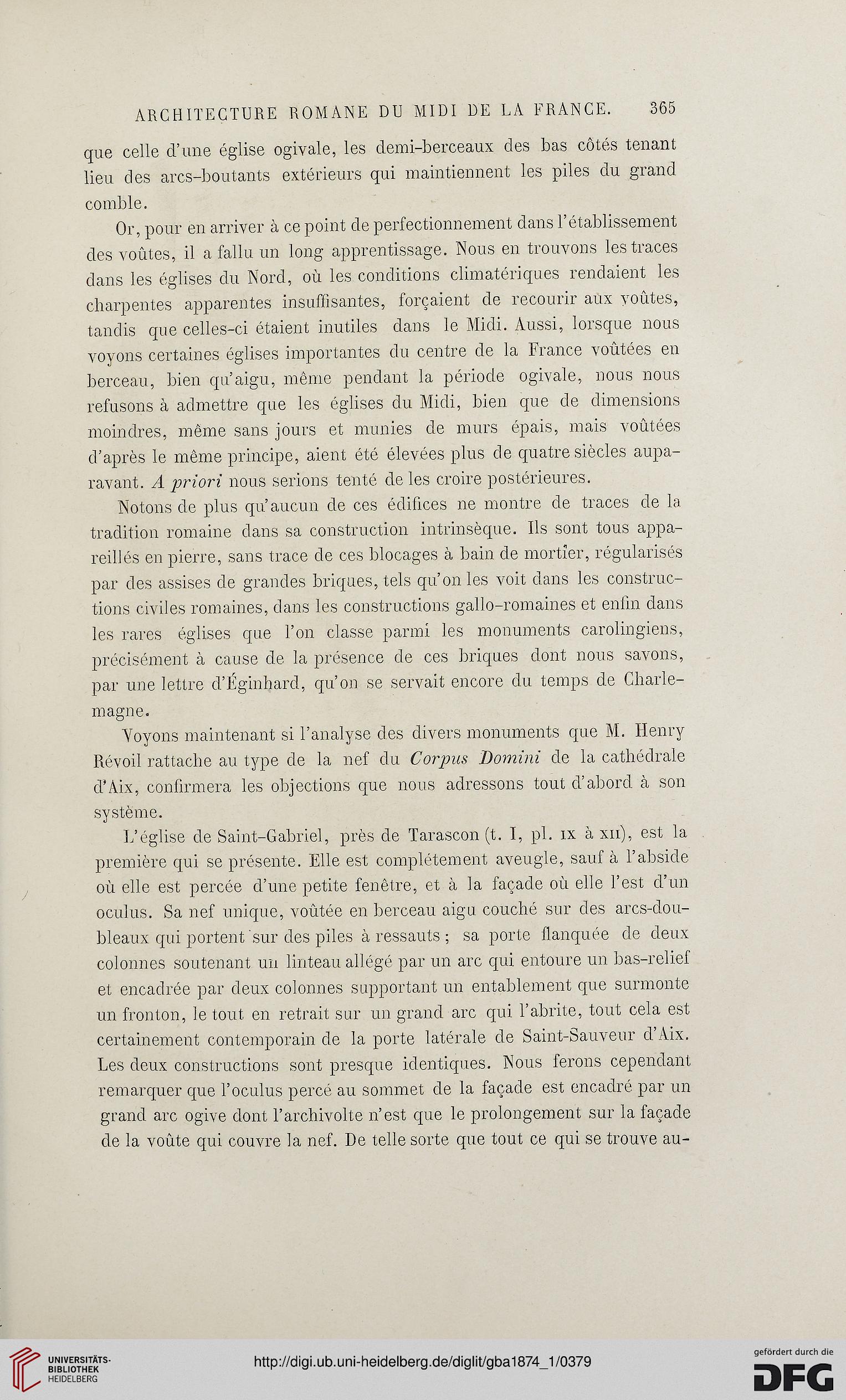ARCHITECTURE ROMANE DU MIDI DE LA FRANCE.
365
que celle d’une église ogivale, les demi-berceaux des bas côtés tenant
lieu des arcs-boutants extérieurs qui maintiennent les piles du grand
comble.
Or, pour en arriver à ce point de perfectionnement dans l’établissement
des voûtes, il a fallu un long apprentissage. Nous en trouvons les traces
dans les églises du Nord, où les conditions climatériques rendaient les
charpentes apparentes insuffisantes, forçaient de recourir aux voûtes,
tandis que celles-ci étaient inutiles dans le Midi. Aussi, lorsque nous
voyons certaines églises importantes du centre de la France voûtées en
berceau, bien qu’aigu, même pendant la période ogivale, nous nous
refusons à admettre que les églises du Midi, bien que de dimensions
moindres, même sans jours et munies de murs épais, mais voûtées
d’après le même principe, aient été élevées plus de quatre siècles aupa-
ravant. A priori nous serions tenté de les croire postérieures.
Notons de plus qu’aucun de ces édifices ne montre de traces de la
tradition romaine dans sa construction intrinsèque. Ils sont tous appa-
reillés en pierre, sans trace de ces blocages à bain de mortier, régularisés
par des assises de grandes briques, tels qu’on les voit dans les construc-
tions civiles romaines, dans les constructions gallo-romaines et enfin dans
les rares églises que l’on classe parmi les monuments carolingiens,
précisément à cause de la présence de ces briques dont nous savons,
par une lettre d’Eginhard, qu’on se servait encore du temps de Charle-
magne.
Voyons maintenant si l’analyse des divers monuments que M. Henry
Révoil rattache au type de la nef du Corpus Domini de la cathédrale
d’Aix, confirmera les objections que nous adressons tout d’abord à son
système.
L’église de Saint-Gabriel, près de Tarascon (t. I, pl. ix à xii), est la
première qui se présente. Elle est complètement aveugle, sauf à l’abside
où elle est percée d’une petite fenêtre, et à la façade où elle l’est d’un
oculus. Sa nef unique, voûtée en berceau aigu couché sur des arcs-do u-
bleaux qui portent sur des piles à ressauts ; sa porte flanquée de deux
colonnes soutenant un linteau allégé par un arc qui entoure un bas-relief
et encadrée par deux colonnes supportant un entablement que surmonte
un fronton, le tout en retrait sur un grand arc qui l’abrite, tout cela est
certainement contemporain de la porte latérale de Saint-Sauveur d’Aix.
Les deux constructions sont presque identiques. Nous ferons cependant
remarquer que l’oculus percé au sommet de la façade est encadré par un
grand arc ogive dont l’archivolte n’est que le prolongement sur la façade
de la voûte qui couvre la nef. De telle sorte que tout ce qui se trouve au-
365
que celle d’une église ogivale, les demi-berceaux des bas côtés tenant
lieu des arcs-boutants extérieurs qui maintiennent les piles du grand
comble.
Or, pour en arriver à ce point de perfectionnement dans l’établissement
des voûtes, il a fallu un long apprentissage. Nous en trouvons les traces
dans les églises du Nord, où les conditions climatériques rendaient les
charpentes apparentes insuffisantes, forçaient de recourir aux voûtes,
tandis que celles-ci étaient inutiles dans le Midi. Aussi, lorsque nous
voyons certaines églises importantes du centre de la France voûtées en
berceau, bien qu’aigu, même pendant la période ogivale, nous nous
refusons à admettre que les églises du Midi, bien que de dimensions
moindres, même sans jours et munies de murs épais, mais voûtées
d’après le même principe, aient été élevées plus de quatre siècles aupa-
ravant. A priori nous serions tenté de les croire postérieures.
Notons de plus qu’aucun de ces édifices ne montre de traces de la
tradition romaine dans sa construction intrinsèque. Ils sont tous appa-
reillés en pierre, sans trace de ces blocages à bain de mortier, régularisés
par des assises de grandes briques, tels qu’on les voit dans les construc-
tions civiles romaines, dans les constructions gallo-romaines et enfin dans
les rares églises que l’on classe parmi les monuments carolingiens,
précisément à cause de la présence de ces briques dont nous savons,
par une lettre d’Eginhard, qu’on se servait encore du temps de Charle-
magne.
Voyons maintenant si l’analyse des divers monuments que M. Henry
Révoil rattache au type de la nef du Corpus Domini de la cathédrale
d’Aix, confirmera les objections que nous adressons tout d’abord à son
système.
L’église de Saint-Gabriel, près de Tarascon (t. I, pl. ix à xii), est la
première qui se présente. Elle est complètement aveugle, sauf à l’abside
où elle est percée d’une petite fenêtre, et à la façade où elle l’est d’un
oculus. Sa nef unique, voûtée en berceau aigu couché sur des arcs-do u-
bleaux qui portent sur des piles à ressauts ; sa porte flanquée de deux
colonnes soutenant un linteau allégé par un arc qui entoure un bas-relief
et encadrée par deux colonnes supportant un entablement que surmonte
un fronton, le tout en retrait sur un grand arc qui l’abrite, tout cela est
certainement contemporain de la porte latérale de Saint-Sauveur d’Aix.
Les deux constructions sont presque identiques. Nous ferons cependant
remarquer que l’oculus percé au sommet de la façade est encadré par un
grand arc ogive dont l’archivolte n’est que le prolongement sur la façade
de la voûte qui couvre la nef. De telle sorte que tout ce qui se trouve au-