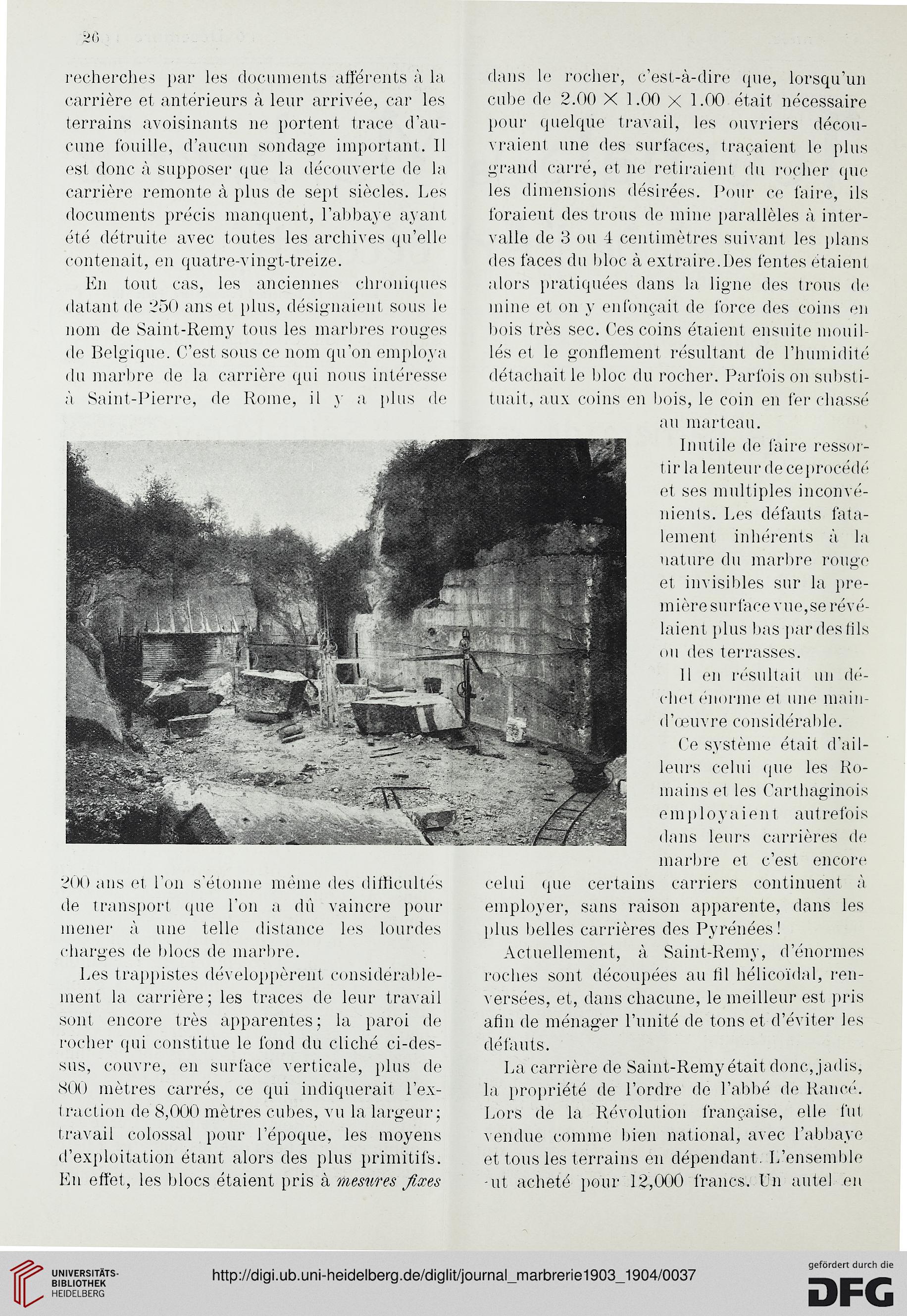2<>
recherches par les documents afférents à la
carrière et antérieurs à leur arrivée, car les
terrains avoisinants ne portent trace d'au-
cune fouille, d'aucun sondage important. 11
est donc à supposer que la découverte de la
carrière remonte à plus de sept siècles. Les
documents précis manquent, l'abbaye ayant
été détruite avec toutes les archives qu'elle
contenait, en quatre-vingt-treize.
En tout cas, les anciennes chroniques
datant de 250 ans et plus, désignaient sous le
nom de Saint-Remy tous les marbres rouges
de Belgique. C'est sous ce nom qu'on employa
du marbre de la carrière qui nous intéresse
à Saint-Pierre, de Rome, il y a plus de
200 ans et l'on s'étonne même des difficultés
de transport (pie l'on a dii vaincre pour
mener à une telle distance les lourdes
charges de blocs de marbre.
Les trappistes développèrent considérable-
ment la carrière; les traces de leur travail
sont encore très apparentes; la paroi de
rocher qui constitue le fond du cliché ci-des-
sus, couvre, en surface verticale, plus de
SOO mètres carrés, ce qui indiquerait l'ex-
traction de 8,000 mètres cubes, vu la largeur;
travail colossal pour l'époque, les moyens
d'exploitation étant alors des plus primitifs.
En effet, les blocs étaient pris à mesures fixes
dans le rocher, c'est-à-dire que, lorsqu'un
cube de 2.00 X 1.00 x 1.00 était nécessaire
pour quelque travail, les ouvriers décou-
vraient une des surfaces, traçaient le plus
grand carré, et ne retiraient du rocher que
les dimensions désirées. Pour ce faire, ils
foraient des trous de mine parallèles à inter-
valle de 3 ou 4 centimètres suivant les plans
des faces du bloc à extraire.Des fentes étaient
alors pratiquées dans la ligne des trous de
mine et on y enfonçait de force des coins en
bois très sec. Ces coins étaient ensuite mouil-
lés et le gonflement résultant de l'humidité
détachait le bloc du rocher. Parfois on substi-
ait, aux coins en bois, le coin en fer chassé
au marteau.
Inutile de faire ressor-
tir la lenteur de ceprocédé
et ses multiples inconvé-
nients. Les défauts fata-
lement inhérents à la
nature du marbre rouge
et invisibles sur la pre-
mière surface vue,se révé-
laient plus bas par des fils
ou des terrasses.
11 en résultait un dé-
chet énorme et une main-
d'œuvre considérable.
Ce système était d'ail-
leurs celui que les Ro-
mains et les Carthaginois
employaient autrefoi s
dans leurs carrières de
marbre et c'est encore
celui (pie certains carriers continuent à
employer, sans raison apparente, dans les
plus belles carrières des Pyrénées!
Actuellement, à Saint-Remy, d'énormes
roches sont découpées au lil hélicoïdal, ren-
versées, et, dans chacune, le meilleur est pris
afin de ménager l'unité de tons et d'éviter les
défauts.
La carrière de Saint-Remy était donc, jadis,
la propriété de l'ordre de l'abbé de Rancé.
Lors de la Révolution française, elle fut
vendue comme bien national, avec l'abbaye
et tous les terrains en dépendant. L'ensemble
-ut acheté pour 12,000 francs. Un autel en
recherches par les documents afférents à la
carrière et antérieurs à leur arrivée, car les
terrains avoisinants ne portent trace d'au-
cune fouille, d'aucun sondage important. 11
est donc à supposer que la découverte de la
carrière remonte à plus de sept siècles. Les
documents précis manquent, l'abbaye ayant
été détruite avec toutes les archives qu'elle
contenait, en quatre-vingt-treize.
En tout cas, les anciennes chroniques
datant de 250 ans et plus, désignaient sous le
nom de Saint-Remy tous les marbres rouges
de Belgique. C'est sous ce nom qu'on employa
du marbre de la carrière qui nous intéresse
à Saint-Pierre, de Rome, il y a plus de
200 ans et l'on s'étonne même des difficultés
de transport (pie l'on a dii vaincre pour
mener à une telle distance les lourdes
charges de blocs de marbre.
Les trappistes développèrent considérable-
ment la carrière; les traces de leur travail
sont encore très apparentes; la paroi de
rocher qui constitue le fond du cliché ci-des-
sus, couvre, en surface verticale, plus de
SOO mètres carrés, ce qui indiquerait l'ex-
traction de 8,000 mètres cubes, vu la largeur;
travail colossal pour l'époque, les moyens
d'exploitation étant alors des plus primitifs.
En effet, les blocs étaient pris à mesures fixes
dans le rocher, c'est-à-dire que, lorsqu'un
cube de 2.00 X 1.00 x 1.00 était nécessaire
pour quelque travail, les ouvriers décou-
vraient une des surfaces, traçaient le plus
grand carré, et ne retiraient du rocher que
les dimensions désirées. Pour ce faire, ils
foraient des trous de mine parallèles à inter-
valle de 3 ou 4 centimètres suivant les plans
des faces du bloc à extraire.Des fentes étaient
alors pratiquées dans la ligne des trous de
mine et on y enfonçait de force des coins en
bois très sec. Ces coins étaient ensuite mouil-
lés et le gonflement résultant de l'humidité
détachait le bloc du rocher. Parfois on substi-
ait, aux coins en bois, le coin en fer chassé
au marteau.
Inutile de faire ressor-
tir la lenteur de ceprocédé
et ses multiples inconvé-
nients. Les défauts fata-
lement inhérents à la
nature du marbre rouge
et invisibles sur la pre-
mière surface vue,se révé-
laient plus bas par des fils
ou des terrasses.
11 en résultait un dé-
chet énorme et une main-
d'œuvre considérable.
Ce système était d'ail-
leurs celui que les Ro-
mains et les Carthaginois
employaient autrefoi s
dans leurs carrières de
marbre et c'est encore
celui (pie certains carriers continuent à
employer, sans raison apparente, dans les
plus belles carrières des Pyrénées!
Actuellement, à Saint-Remy, d'énormes
roches sont découpées au lil hélicoïdal, ren-
versées, et, dans chacune, le meilleur est pris
afin de ménager l'unité de tons et d'éviter les
défauts.
La carrière de Saint-Remy était donc, jadis,
la propriété de l'ordre de l'abbé de Rancé.
Lors de la Révolution française, elle fut
vendue comme bien national, avec l'abbaye
et tous les terrains en dépendant. L'ensemble
-ut acheté pour 12,000 francs. Un autel en