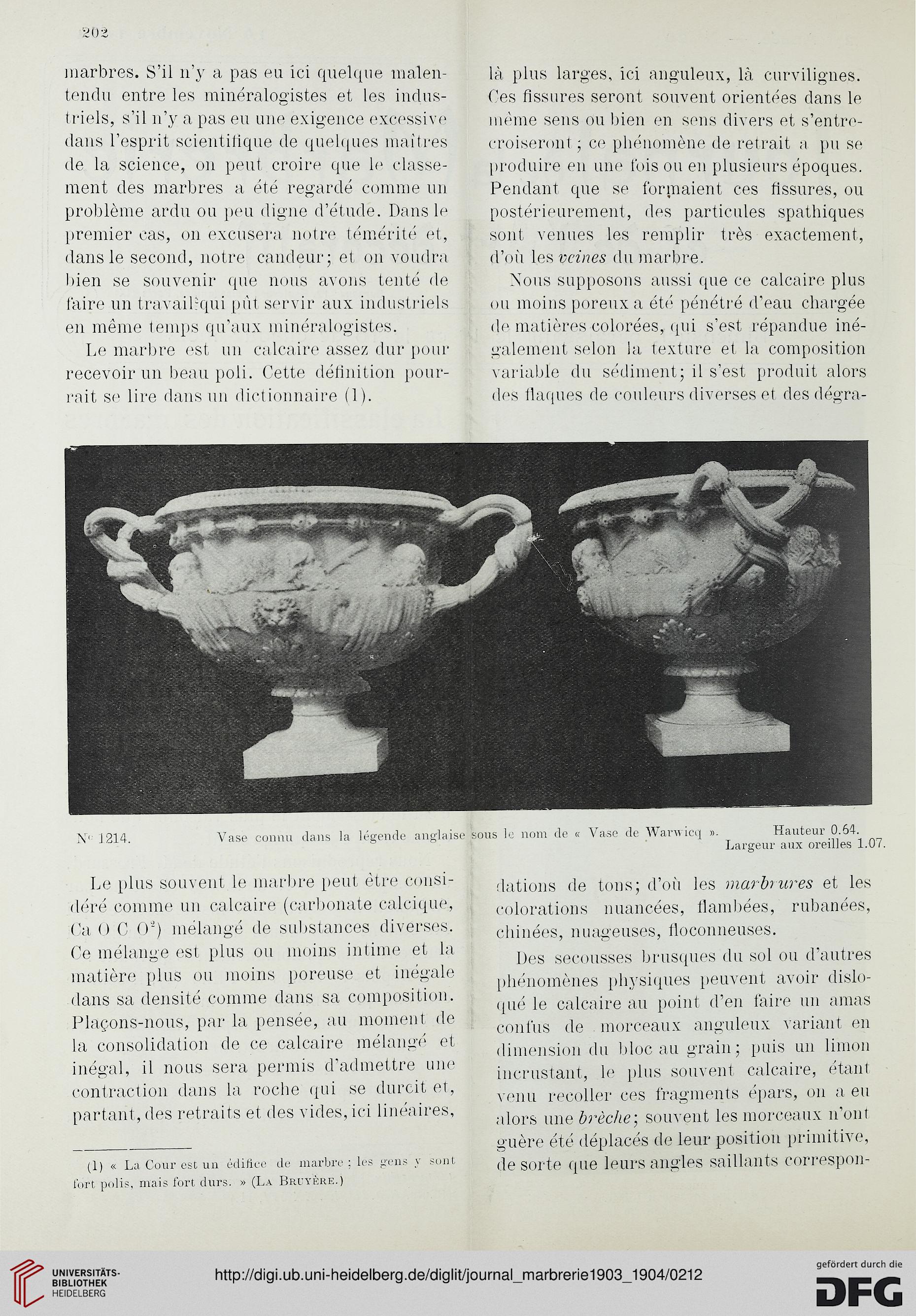202
marbres. S'il n'y a pas eu ici quelque malen-
tendu entre les minéralogistes et les indus-
triels, s'il n'y a pas eu une exigence excessive
dans l'esprit scientifique de quelques maîtres
de la science, on peut croire que le classe-
ment des marbres a été regardé comme un
problème ardu ou peu digne d'étude. Dans le
premier cas, on excusera notre témérité et,
dans le second, notre candeur; et on voudra
bien se souvenir (pie nous avons tenté de
taire un travailrqui put servir aux industriels
en même temps qu'aux minéralogistes.
Le marbre est un calcaire assez dur pour
recevoir un beau poli. Cette définition pour-
rait se lire dans un dictionnaire (1).
là plus larges, ici anguleux, là curvilignes.
Ces fissures seront souvent orientées dans le
même sens ou bien en sens divers et, s'entre-
croiseront ; ce phénomène de retrait a pu se
produire en une l'ois ou en plusieurs époques.
Pendant que se formaient ces tissures, ou
postérieurement, des particules spathiques
sont venues les remplir très exactement,
d'où les veines du marbre.
Nous supposons aussi que ce calcaire plus
ou moins poreux a été pénétré d'eau chargée
de matières colorées, qui s'est répandue iné-
galement selon la texture et la composition
variable du sédiment; il s'est produit alors
des flaques de couleurs diverses et des dégra-
N( J214. Vase connu dans la légende anglaise
Le plus souvent le marbre peut être consi-
déré comme un calcaire (carbonate calcique,
Ca 0 C O'2) mélangé de substances diverses.
Ce mélange est plus ou moins intime et la
matière plus ou moins poreuse et inégale
dans sa densité comme dans sa composition.
Plaçons-nous, par la pensée, au moment de
la consolidation de ce calcaire mélangé et
inégal, il nous sera permis d'admettre une
contraction dans la roche qui se durcit et,
partant, des retraits et des vides, ici linéaires,
(1) « La Cour est un édifice de marbre ; les gens y sont
fort polis, mais fort durs. » (La Bruyère.)
ious le nom de « Vase de Warwicq ». Hauteur 0.64.
Largeur aux oreilles 1.07.
dations de tons; d'où les marbrures et les
colorations nuancées, flambées, rubanées,
chinées, nuageuses, floconneuses.
Des secousses brusques du sol ou d'autres
phénomènes physiques peuvent avoir dislo-
qué le calcaire au point d'en faire un amas
confus de morceaux anguleux variant en
dimension du bloc au grain; puis un limon
incrustant, le plus souvent calcaire, étant
venu recoller ces fragments épars, on a eu
alors une brèche; souvent les morceaux n'ont
guère été déplacés de leur position primitive,
de sorte que leurs angles saillants correspon-
marbres. S'il n'y a pas eu ici quelque malen-
tendu entre les minéralogistes et les indus-
triels, s'il n'y a pas eu une exigence excessive
dans l'esprit scientifique de quelques maîtres
de la science, on peut croire que le classe-
ment des marbres a été regardé comme un
problème ardu ou peu digne d'étude. Dans le
premier cas, on excusera notre témérité et,
dans le second, notre candeur; et on voudra
bien se souvenir (pie nous avons tenté de
taire un travailrqui put servir aux industriels
en même temps qu'aux minéralogistes.
Le marbre est un calcaire assez dur pour
recevoir un beau poli. Cette définition pour-
rait se lire dans un dictionnaire (1).
là plus larges, ici anguleux, là curvilignes.
Ces fissures seront souvent orientées dans le
même sens ou bien en sens divers et, s'entre-
croiseront ; ce phénomène de retrait a pu se
produire en une l'ois ou en plusieurs époques.
Pendant que se formaient ces tissures, ou
postérieurement, des particules spathiques
sont venues les remplir très exactement,
d'où les veines du marbre.
Nous supposons aussi que ce calcaire plus
ou moins poreux a été pénétré d'eau chargée
de matières colorées, qui s'est répandue iné-
galement selon la texture et la composition
variable du sédiment; il s'est produit alors
des flaques de couleurs diverses et des dégra-
N( J214. Vase connu dans la légende anglaise
Le plus souvent le marbre peut être consi-
déré comme un calcaire (carbonate calcique,
Ca 0 C O'2) mélangé de substances diverses.
Ce mélange est plus ou moins intime et la
matière plus ou moins poreuse et inégale
dans sa densité comme dans sa composition.
Plaçons-nous, par la pensée, au moment de
la consolidation de ce calcaire mélangé et
inégal, il nous sera permis d'admettre une
contraction dans la roche qui se durcit et,
partant, des retraits et des vides, ici linéaires,
(1) « La Cour est un édifice de marbre ; les gens y sont
fort polis, mais fort durs. » (La Bruyère.)
ious le nom de « Vase de Warwicq ». Hauteur 0.64.
Largeur aux oreilles 1.07.
dations de tons; d'où les marbrures et les
colorations nuancées, flambées, rubanées,
chinées, nuageuses, floconneuses.
Des secousses brusques du sol ou d'autres
phénomènes physiques peuvent avoir dislo-
qué le calcaire au point d'en faire un amas
confus de morceaux anguleux variant en
dimension du bloc au grain; puis un limon
incrustant, le plus souvent calcaire, étant
venu recoller ces fragments épars, on a eu
alors une brèche; souvent les morceaux n'ont
guère été déplacés de leur position primitive,
de sorte que leurs angles saillants correspon-